Ouverture contre impuissance : la crise frontalière européenne de 2015-2017
Hugo Brady
28/06/2021
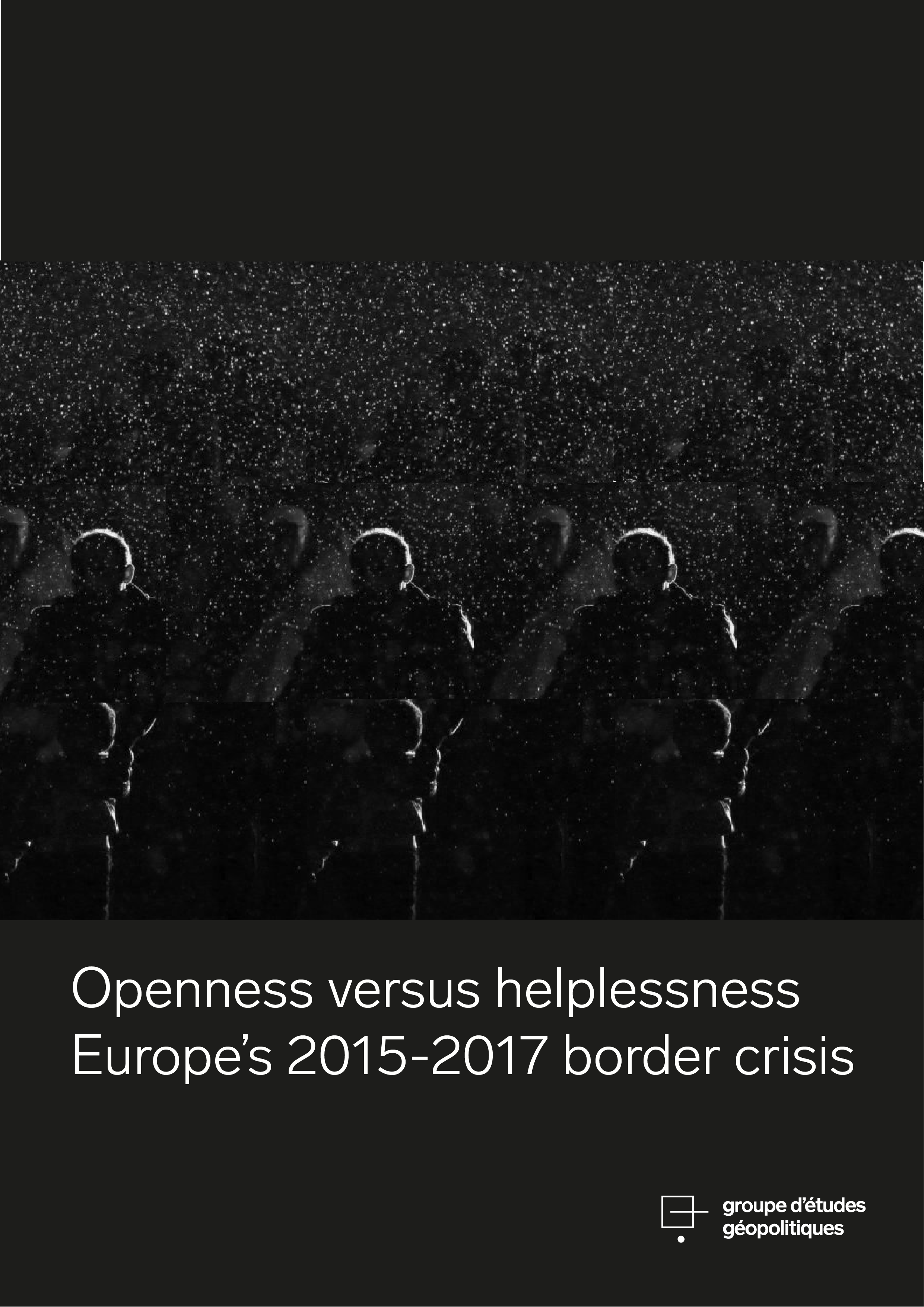
28/06/2021
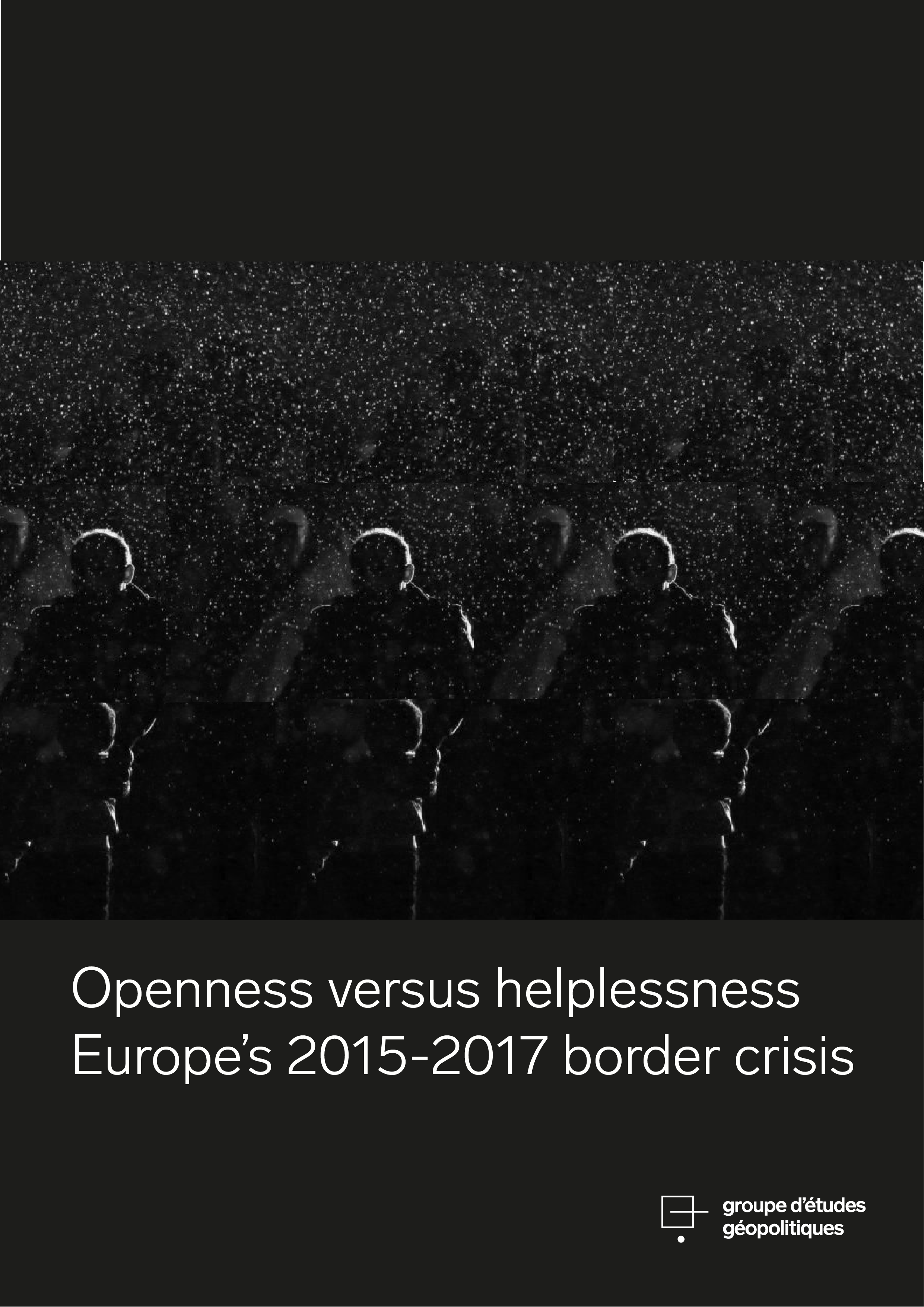
 Voir tous les articles
Voir tous les articles
Ouverture contre impuissance : la crise frontalière européenne de 2015-2017
Prologue 1
Nous sommes le 20 octobre 2015. Dans les ports turcs d’Izmir et de Bodrum, les passeurs s’affolent et se précipitent le long du littoral pour pousser des milliers de personnes dans des canots pneumatiques et des embarcations de fortune vers la mer Égée.
L’île grecque de Kos se trouve à moins d’un kilomètre. Conformément aux règles internationales de recherche et de sauvetage (SAR), les patrouilles maritimes épuisées de l’Union européenne recueillent les voyageurs clandestins et les débarquent en toute hâte à Kos ainsi que sur les îles voisines de Chios, Lesbos, Samos et Leros. La quasi-totalité de ces personnes demandent l’asile en tant que réfugiés de guerre syriens, qu’ils soient afghans, irakiens, pakistanais, marocains ou originaires d’Afrique subsaharienne.
Ils se voient remettre des titres de voyage griffonnés à la hâte, font un trajet en bateau vers la Grèce continentale et, de là, sont parqués dans des bus pour un long parcours qui les mènera jusqu’à la frontière nord-macédonienne. Par la « route des Balkans », ils quittent et réintègrent l’Union européenne, en passant par l’Autriche et la Hongrie, le plus souvent à destination de l’Allemagne ou de la Suède. Les SMS sur les smartphones des migrants semblent confirmer les promesses des passeurs : ceux qui sont suffisamment déterminés pour faire le voyage reçoivent de l’argent et un logement gratuit dans le nord de l’Europe. Ce que les Suisses donnent aux demandeurs d’asile en une seule année équivaut au salaire d’une vie entière en Afghanistan. Un grand cri s’élève de l’assemblée, à la fois plein d’espoir, de frustration amère et de l’énergie du désespoir. ALLE-MAGNE ! ALLE-MAGNE ! ALLE-MAGNE !
Indépendamment de leur appartenance ethnique ou de leur origine, les voyageurs se déplacent en cohorte car ils partent du principe que les autorités ne sont pas en mesure d’arrêter des groupes de 1 000 personnes ou plus. Ils ont raison. La Macédoine du Nord déclare l’état d’urgence nationale en août lorsque 112 000 personnes franchissent sa frontière avec la Grèce. En septembre, 150 000 autres personnes traversent la frontière, incitant la Hongrie à fermer sa frontière avec la Serbie. Encouragée par les félicitations et les bouteilles d’eau distribuées par la population Serbe, la masse fait demi-tour et se dirige vers la Croatie. La Croatie achemine l’afflux directement vers la Slovénie, porte d’entrée de la zone de circulation sans passeport de l’Union. Les Slovènes envoient leur armée à la frontière et limitent le nombre de personnes autorisées à 2 500 par jour. Faisant du pays un véritable goulot d’étranglement à mesure que le nombre d’immigrants augmente, les Slovènes doivent finalement renoncer aux contrôles. Près d’un quart de million de personnes entrent en octobre, de nationalités et d’intentions inconnues, car aucun contrôle sérieux n’est effectué au point d’entrée en Grèce ou ailleurs. La situation est hors de contrôle. Sur tout le continent, les images télévisées des migrants en marche déclenchent une multitude de réactions épidermiques et paniquées.
La situation est hors de contrôle. Sur tout le continent, les images télévisées des migrants en marche déclenchent une multitude de réactions épidermiques et paniquées.
Hugo Brady
Les gouvernements des pays situés le long de la route migratoire craignent que les migrants ne s’installent chez eux et rivalisent d’ingéniosité pour les faire transiter le plus rapidement possible. Des mesures d’urgence sont prises en maintenant l’illusion de répondre à l’afflux de migrants tout en limitant les efforts humanitaires au strict minimum. Lorsque les frontières en viendront inévitablement à se refermer quelque part en Europe du Nord, les communautés les plus pauvres des Balkans se retrouveront avec un grand nombre de réfugiés, principalement des hommes originaires du Moyen-Orient et d’Afrique, qu’ils n’auront ni les ressources ni le désir d’intégrer. Ces considérations sont également celles d’Alexis Tsipras, le premier ministre grec. En se servant du discours humanitaire comme d’un bouclier, Tsipras refuse l’aide européenne en matière d’enregistrement et de filtrage qui pourrait au moins permettre de rétablir un semblant d’ordre au point d’entrée. Le leader de Syriza craint que son pays, en faillite, ne se transforme en ce qu’il appellera plus tard un « entrepôt d’âmes ». Au grand désespoir de ses collègues européens, M. Tsipras reste hermétique et fait en sorte que les migrants traversent la Grèce aussi vite que possible.
Même l’hiver ne laisse aucun répit aux passeurs, qui continuent à pousser de plus en plus de personnes désespérées dans les mers déchaînées. En aval, la Croix-Rouge internationale tire la sonnette d’alarme : l’Europe aura des vies sur la conscience si les migrants – dont beaucoup n’ont jamais vu la neige – restent bloqués dans les montagnes des Balkans…
Introduction
« Nous ne pouvons plus permettre que la solidarité et la naïveté soient équivalentes, que l’ouverture soit synonyme d’impuissance, que la liberté signifie le chaos. Et par là, je fais bien sûr référence à la situation à nos frontières. » Donald Tusk, président du Conseil européen, lors du congrès du Parti populaire européen à Madrid, le 22 octobre 2015.
Octobre 2015 a été le nadir d’une crise frontalière de trois ans au cours de laquelle les idéaux européens d’ouverture et d’humanité se sont heurtés aux terribles réalités de la migration maritime de masse et du déplacement forcé de personnes. Cette situation d’urgence est intervenue peu de temps après la crise de la zone euro et a révélé que le système de frontières et d’asile de l’Union, robuste sur le papier, était en fait dépourvu de contenu. Comme la crise de l’euro, la crise migratoire a duré plus longtemps que nécessaire, a pris l’allure d’une prophétie autoréalisatrice et s’est muée en bras de fer politique européen opposant les principes au pragmatisme : un terrain propice à l’opposition frontale des visions du monde. Comme ce fut le cas pour la monnaie unique, les différentes solutions proposées ont fait l’objet de vives critiques, tout à la fois qualifiées de « parfaitement naïves » ou « étonnamment immorales ».
Comme la crise de l’euro, la crise migratoire a duré plus longtemps que nécessaire, a pris l’allure d’une prophétie autoréalisatrice et s’est muée en bras de fer politique européen opposant les principes au pragmatisme : un terrain propice à l’opposition frontale des visions du monde.
Hugo Brady
Dès le début, cette séquence politique et historique a été largement influencée par une coalition d’acteurs qui ont insisté sur le fait qu’il n’y avait pas d’alternative à la répartition obligatoire des demandeurs d’asile entre les pays de l’Union, bien que ce concept n’ait jamais été évoqué ou expérimenté auparavant. Cet aréopage comprenait la plupart des pays méditerranéens, une Commission européenne et un Parlement européen ambitieusement intégrationnistes, une chancelière allemande acculée et ses alliés, une agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) tentant d’étendre l’espace de protection international, et des militants pour des frontières ouvertes partisans d’une approche centralisée.
Pour beaucoup d’entre eux, les motivations comptaient plus que le résultat et permettaient de poser un précédent pour la réalisation d’un tel système à l’avenir. Mais leur héritage est douloureux ; il comprend notamment une nouvelle fracture politique au sein de l’Union et un espace Schengen peut-être définitivement endommagé, dans lequel les contrôles aux frontières intérieures restent en place près d’une demie décennie plus tard. Il ne faut pas non plus sous-estimer le coup porté à la légitimité populaire de l’Union, alors déjà confrontée à la menace terroriste des extrémistes islamistes et à la perspective imminente du Brexit. En définitive, ces éléments ont beaucoup compté.
Malgré tout cela, l’Union a réalisé un exploit remarquable pour mettre fin à la plus grande crise migratoire maritime de son histoire. Elle l’a fait en dépit de ses propres divisions internes, toujours très vives, malgré le peu d’outils à sa disposition pour mener à bien cette tâche, et malgré sa vulnérabilité géographique et juridique face à un phénomène mondialisé de trafic de migrants. Cette réussite se mesure à l’aune du fait qu’il est désormais difficile de se souvenir du sentiment de peur apocalyptique qui régnait en Europe en 2015 et au début de 2016, lorsque plus de 1,2 millions de personnes originaires du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie du Sud sont arrivées de façon irrégulière sur les côtes européennes (voir graphiques I et II). Si les souvenirs de migrants défilant au bord des autoroutes ou d’enfants noyés sur les plages se sont estompés, au même titre que le désespoir et l’indignation qui les accompagnaient, c’est parce que l’Europe a fini par endiguer les flux et rétablir l’ordre. La clé a été de résister à la pression des solutions extrêmes : l’ouverture totale des frontières, porteuse de haine et de chaos, ou le retour aux frontières nationales qui aurait causé l’effondrement du marché unique européen. Au lieu de cela, l’Union s’est réorganisée, par étapes, autour de la protection de ses frontières extérieures, en tirant tardivement les leçons d’autres crises comparables.
Dans cette note de travail, nous examinerons les facteurs internes et externes qui ont conduit à la crise afin de retracer ses principales phases, notamment à l’aune des débats qui ont fait rage entre les dirigeants européens à partir d’avril 2015. Nous analyserons ensuite la réponse européenne, puis nous tenterons d’établir une classification des réactions des petits États face aux flux migratoires et aux bouleversements politiques qu’ils ont engendrés. Enfin, quelques pistes de réflexion seront proposées sur les conséquences et l’héritage de cette crise.
2. La crise : origines et évolution
Ce que certains commentateurs ont qualifié de « 11 septembre européen » 2 était essentiellement une crise maritime. D’une ampleur sans précédent dans l’histoire moderne, cet épisode présente des parallèles évidents avec certains événements historiques tels que la crise des boat-people venus d’Asie du Sud-Est continentale à la fin des années 1970, la fuite des Cubains vers les États-Unis dans les années 1980 et 1990, ou encore les diverses tentatives de l’Australie pour endiguer les arrivées en provenance d’Asie du Sud-Est depuis 2001. Ce qui distingue le cas de l’Europe, c’est l’Union européenne elle-même et les spécificités de trois de ses régimes juridiques.
Tout d’abord, l’Union est unique au monde car les pays à l’intérieur de ses frontières sont souverains mais il n’existe aucun contrôle de passeport entre eux. Cette situation résulte de la création de l’espace Schengen en 1995 et d’une frontière extérieure commune, étendue à la Grèce en 2000 et à la plupart des pays d’Europe centrale et de l’Est en 2007.
Deuxièmement, l’exécutif de l’Union – la Commission européenne – n’a aucun pouvoir d’intervention sur la frontière extérieure. L’ouverture des frontières intérieures repose donc sur l’hypothèse que les pays refuseront l’entrée sur leur propre partie de la frontière extérieure aux étrangers qui n’ont pas de motif valable et évalueront la validité des demandes d’asile politique présentées par les arrivants en situation régulière. Depuis 2003, l’interprétation par l’Union des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention de Genève 3 , connue sous le nom de régime d’asile européen commun 4 , définit la manière dont les demandeurs d’asile doivent être accueillis et interrogés, mais laisse d’autres questions, comme celle de l’assistance économique à octroyer, largement à la discrétion des États membres 5 . Le principe fondamental qui sous-tend cet édifice – énoncé dans le règlement européen dit de Dublin – est que le pays européen dans lequel un demandeur d’asile entre en premier est responsable du traitement de sa demande, jusqu’à un an après son arrivée. Par conséquent, si un demandeur d’asile arrive en Italie et demande une aide économique en Norvège six mois plus tard, les autorités norvégiennes ont le droit de renvoyer cette personne en Italie pour que sa demande soit évaluée 6 . Si la demande est ensuite rejetée, comme c’est le cas pour au moins 50 % d’entre elles, l’Italie est chargée de renvoyer le demandeur dans son pays d’origine 7 (et la règle fonctionne dans l’autre sens pour l’Italie si, par exemple, le pays d’entrée est la Norvège).
Troisièmement, chaque pays de l’Union est partie à la Convention européenne des droits de l’homme. En 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt dit « Hirsi », mettant fin à la pratique de l’Italie qui consistait à refouler les bateaux de passeurs avant qu’ils ne puissent atteindre ses eaux territoriales 8 . Cet arrêt a permis aux migrants en situation irrégulière recueillis par des navires en haute mer d’accéder systématiquement à la procédure d’asile européenne, qui nécessite des heures d’entretiens et un long processus de décision et qui comprend la possibilité de faire appel. La Cour est parvenue à ce résultat en obligeant les navires battant pavillon européen à débarquer les personnes secourues dans les eaux internationales vers le port européen le plus proche, afin de vérifier si l’une des personnes à bord pourrait être éligible au statut de réfugié. Aucun autre signataire de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés n’interprète ses obligations de cette manière. Ce droit n’existe pas, par exemple, dans les eaux internationales au large des côtes canadiennes ou dans les Caraïbes, où les autorités américaines déterminent rapidement le statut sur le pont en vérifiant la condition d’une « crainte fondée de persécution ». En Méditerranée centrale, les cartels de passeurs de Libye et de Tunisie ont vite compris que chaque navire européen près de leurs côtes était désormais potentiellement un taxi flottant vers l’Europe. Cette révolution juridique a coïncidé avec l’effondrement de la Libye dans l’anarchie après la chute du régime de Kadhafi en 2011, et le déclenchement de la guerre civile syrienne l’année suivante. Le décor était planté pour la descente aux enfers de Schengen 9 .
Au début, le nombre de migrants interceptés restait tolérable. En 2012, 13 000 sont arrivés, recueillis bon gré mal gré par des navires marchands ou par les garde-côtes italiens. Cependant, le 3 octobre 2013, 366 Africains firent naufrage et se noyèrent au large de la minuscule île italienne de Lampedusa, le point d’entrée européen le plus proche de la côte nord-africaine. Horrifiés, les Italiens commencèrent à effectuer des patrouilles systématiques dans les eaux internationales deux jours plus tard. Sous le nom de code « Opération Mare Nostrum », ces patrouilles prirent la forme d’une vaste mission « militaro-humanitaire », dotée de moyens aériens et navals importants, dont un hôpital flottant. A tout point de vue, un tel déploiement de moyens publics était important et décisif. Cependant, cette réponse revenait à tomber dans le piège tendu par les cartels de passeurs 10 . Dans les mois qui suivirent cette première opération, les arrivées explosèrent pour atteindre plus de 170 000 personnes. Il en va tragiquement de même pour les décès : plus de 3 000, contre 644 l’année précédente. Entassés dans des bateaux de fortune aux côtés des Africains de l’Ouest et des Érythréens, les Syriens saisissaient l’opportunité du régime d’exemption de visa entre la Turquie et la Libye comme une porte dérobée vers l’Europe.
Confronté à l’impossibilité d’abandonner publiquement une mission de sauvetage, le gouvernement italien – conduit par son nouveau premier ministre Matteo Renzi – avait besoin d’une porte de sortie. La solution de Renzi était d’européaniser le problème en amenant l’Union à prendre en charge les patrouilles. Le 31 octobre 2014, « Mare Nostrum » fut suspendue pour être remplacée par l’opération « Triton », gérée par Frontex, l’agence européenne des frontières 11 . Secourus par la nouvelle opération menée par l’Italie et Malte avec l’aide matérielle et humaine de plus de dix pays de l’Union, les migrants étaient toujours débarqués dans les ports italiens. L’important était que le passage d’une mission navale à une mission frontalière permette aux Italiens de soulager leurs patrouilles et de les ramener dans leurs eaux territoriales.
Mais les passeurs avaient ferré l’Italie comme un poisson et n’allaient pas laisser le pays s’échapper aussi facilement. Le message envoyé par « Mare Nostrum » était clair : l’Europe ne renverrait pas les arrivées irrégulières, ce qui revenait à dire qu’elle les accueillerait. A partir du mois d’août 2014, les ONG commencèrent à naviguer dans la zone de patrouille internationale, la première étant « Migrant Offshore Aid Station » (MOAS). Les ONG se rendaient jusque dans les eaux libyennes pour récupérer les migrants poussés à la mer, puis retournaient dans les eaux italiennes pour confier les personnes secourues aux autorités. Les ONG représentaient ainsi une part de plus en plus importante des débarquements et déployèrent une flotte de 14 navires, souvent équipés de drones et d’autres moyens techniques pour sonder la mer à la recherche d’embarcations à la dérive. Malgré toutes ces patrouilles supplémentaires, le plus grand désastre restait à venir. En avril 2015, deux cargos rouillés chavirèrent à quelques jours d’intervalle près des eaux libyennes, entraînant la mort de 1 200 personnes.
Jusqu’alors, les dirigeants de l’UE avaient résisté aux pressions italiennes pour faire des opérations de sauvetage en mer un problème européen. Les frontières, les demandeurs d’asile, l’immigration, tous ces sujets étaient extrêmement sensibles et devaient être laissés aux soins des ministres de l’intérieur. Bien qu’ils soient évidemment importants, ces sujets n’étaient pas l’affaire des chefs. Les hommes et les femmes forts du Conseil européen, le plus haut organe de décision de l’UE, étaient complètement étrangers à ces thématiques 12 . Mais les désastres du mois d’avril montrèrent que l’insistance de l’Italie ne pouvait être ignorée plus longtemps. Donald Tusk, président du Conseil européen et premier ministre de Pologne jusqu’en 2014, décida de réunir en urgence les dirigeants européens le 23 avril. Tusk était profondément réticent à l’idée de laisser l’Union s’engager plus qu’elle ne l’était déjà dans les pièges des passeurs. Étant avant tout un fin communicant, il pensait que les passeurs et les migrants avaient besoin d’entendre, et rapidement, le message sans ambiguïté que l’Europe arrêterait le service de taxi. Tout autre plan d’action signifiait une accélération de la crise : plus de bateaux, plus de morts, et plus de chaos à l’intérieur de l’UE. Mais son approche directe allait à l’encontre de la pratique établie de l’Union qui consiste à s’attaquer aux défis insolubles dans une ambiance d’ »ambiguïté constructive » et d’exhaustivité apaisante.
Tusk était profondément réticent à l’idée de laisser l’Union s’engager plus qu’elle ne l’était déjà dans les pièges des passeurs. Étant avant tout un fin communicant, il pensait que les passeurs et les migrants avaient besoin d’entendre, et rapidement, le message sans ambiguïté que l’Europe arrêterait le service de taxi.
Hugo Brady
Le Conseil européen du mois d’avril se tint dans une grande confusion politique. Certains conseillers suggéraient à leurs dirigeants – notamment à ceux de l’Allemagne – que les règles européennes en matière d’asile ne laissent tout simplement aucune marge de manœuvre pour éviter que les entrées irrégulières n’augmentent massivement. Ce fatalisme juridique, combiné au fait que les dirigeants ne connaissaient pas les questions en jeu, alimenta un sentiment d’impuissance. Le mois d’avril ouvrit alors une longue valse de deux ans entre les mesures rigoureuses nécessaires pour répondre à la crise d’une part, et les pressions pour y répondre en accord avec les « valeurs européennes » d’autre part. Luuk van Middelaar, auteur et penseur politique, a caractérisé cette tension en reprenant celle conceptualisée par Max Weber dans Le Savant et le Politique (1919), entre ce que Weber appelle l’éthique de la responsabilité (selon laquelle « nous devons répondre des conséquences prévisibles de nos actes ») et l’éthique de conviction (selon laquelle « le chrétien fait son devoir et s’en remet à Dieu en ce qui concerne le résultat de l’action ») 13 . En l’absence de bonnes options, la crise en cours forçait les dirigeants de l’Union à mimer devant les caméras l’une ou l’autre de ces deux éthiques.
Le sommet tripla les ressources disponibles pour l’opération Triton, la Grande Bretagne allant même jusqu’à mettre un navire de guerre à disposition, le HMS Bulwark. Les dirigeants européens étendirent le territoire couvert par l’opération Triton jusqu’au point de rupture, permettant en pratique à Frontex de mener des opérations de recherche et de sauvetage comme Mare Nostrum auparavant. Ils savaient que le nombre d’arrivées, et certainement aussi le nombre de morts, allait continuer d’augmenter, mais ils « s’en remirent à Dieu ». Parallèlement à cela, les dirigeants esquissèrent un plan pour soulager l’Italie par des « relocalisations temporaires », c’est-à-dire par la répartition des demandeurs d’asile dans toute l’Union, en adoptant une clause d’exception au règlement de Dublin 14 .
Contrairement à l’opinion généralement répandue, les personnes sur les bateaux n’étaient pas des Libyens. La Libye était déjà depuis plusieurs décennies un pays de destination pour les travailleurs d’Afrique subsaharienne, qui occupaient la majorité des emplois agricoles et de service sur le marché du travail des pays riches en pétrole (et qui, même en période de prospérité, pouvaient être victimes d’une culture endémique de servitude par contrat ou pour dettes – ce qu’on appelle en d’autres termes l’esclavage). L’État et la société post-Kadhafi étaient déchirés entre des factions hostiles basées à Tripoli et à Tobruk. Les travailleurs migrants de la Libye d’antan n’eurent plus personne vers qui se tourner, mis à part les passeurs ; de même, les Européens n’eurent plus personne vers qui se tourner dans l’administration libyenne. Alors que cet état de choses perdurait, on ne pouvait logiquement que travailler pour se préparer à faire face à l’afflux de l’autre côté de la Méditerranée. Mais à ce stade, peu nombreux étaient ceux qui suspectaient que la Commission européenne mettrait le partage obligatoire des arrivées irrégulières – un concept de niche, tout au mieux – au centre de la réponse européenne à la crise. Aux yeux de certains, la répartition des demandeurs d’asile entre pays était une solution sans précédent, qui n’aiderait en rien à faire baisser le nombre de migrants, et qui équivalait, du point de vue du contrôle aux frontières, à dérouler le tapis rouge devant l’industrie mondiale des cartels de passeurs.
Avançant que les migrants devaient entrer par la porte principale plutôt que « par les fenêtres de derrière », Jean-Claude Juncker, président de la Commission à partir du mois de novembre précédent, proposa en mai 2015 la relocalisation de 40 000 demandeurs d’asile pour réduire la pression sur les États en première ligne, l’Italie et la Grèce 15 . Vieux routier de l’Union et premier ministre du Luxembourg jusqu’à récemment, Juncker voulait que tous les États membres participent sur la base d’une « clé de répartition », c’est-à-dire un ensemble de critères techniques comme ceux utilisés par l’Allemagne pour répartir équitablement ses réfugiés entre les différents Länder de la République fédérale. Dans la droite ligne du « charisme technocratique » 16 propre à la Commission, le président Juncker pensa que cette solution serait le bon symbole d’une Europe unie dans la crise.
Les dirigeants européens, y compris la chancelière allemande Angela Merkel, avaient convenu lors de la tenue du Conseil européen en avril que les relocalisations depuis l’Italie et la Grèce seraient organisés sur une base volontaire, et que les États volontaires s’engageraient sur le nombre de migrants qu’ils pourraient chacun prendre en charge. Mais pour Juncker, un mécanisme volontaire passait à côté de l’idée que l’Union est une famille où tout le monde doit participer lorsque les circonstances sont exceptionnelles. Son plan de transfert de 40 000 demandeurs d’asile était déjà raillé sans pitié dans les médias pour sa modération, à une époque où ce nombre représentait les arrivées mensuelles en Italie. Il pensa également que la pression croissante de l’opinion publique pour que Bruxelles « fasse quelque chose » voulait dire que ses propositions devaient innover, en imposant par exemple un mécanisme de solidarité obligatoire à l’échelle de l’Union et reposant sur la clé de répartition (un concept dont Tusk fit remarquer à Juncker qu’il était un « oxymore », ce que ce dernier finit par reconnaître en disant qu’un tel effort « ne pouvait pas être contraint … il doit venir du cœur » 17 ).
Lors d’un sommet qui se tenait par une nuit de juin, le président de la Commission et Renzi laissèrent éclater une juste colère lorsque plusieurs dirigeants d’Europe centrale et d’Europe de l’Est affirmèrent obstinément qu’ils n’accepteraient jamais de quotas obligatoires. Ces États faisaient savoir qu’ils n’étaient pas des pays de destination pour les migrants. Si l’adhésion à l’Union comprenait l’obligation de devenir des sociétés multiculturelles, c’était une nouvelle dont ils n’étaient pas au courant. Membres de l’Union depuis un peu plus d’une dizaine d’années à cette époque, les États de l’Est considéraient le plan de la Commission avec la plus grande méfiance et le voyaient comme un début d’ingérence dans les politiques nationales en matière d’immigration. Au lieu d’un plan d’action clair pour arrêter les bateaux, les obscurantistes de Bruxelles suggéraient un système bizarre pour envoyer des étrangers dans des pays où l’on ne voulait pas d’eux et où eux-mêmes ne voulaient pas aller. De plus, une fois établi le principe selon lequel Bruxelles pourrait décider qui peut migrer dans quel pays, où cela conduirait-il ?
Membres de l’Union depuis un peu plus d’une dizaine d’années à cette époque, les États de l’Est considéraient le plan de la Commission avec la plus grande méfiance et le voyaient comme un début d’ingérence dans les politiques nationales en matière d’immigration. Au lieu d’un plan d’action clair pour arrêter les bateaux, les obscurantistes de Bruxelles suggéraient un système bizarre pour envoyer des étrangers dans des pays où l’on ne voulait pas d’eux et où eux-mêmes ne voulaient pas aller.
Hugo Brady
Alors que les acteurs principaux vivaient clairement dans des univers mentaux différents, les faits sur le terrain étaient en train de changer. Premier ministre controversé de Hongrie et opposant le plus virulent au système des quotas, Viktor Orbán envoya le 22 juin 2015 une lettre d’alerte à Tusk et Juncker. Un grand nombre de migrants commençaient à arriver en Hongrie. Orbán déclarait que son pays avait enregistré le plus grand nombre d’entrées irrégulières dans l’Union jusqu’à présent cette année-là et que la route des Balkans subissait maintenant une pression au moins aussi forte que la route méditerranéenne. Les Syriens, en sécurité en Turquie mais inquiets pour l’éducation de leurs enfants, ne venaient plus en passant par la Libye mais payaient des passeurs pour entrer directement en Grèce. En conséquence, les chiffres étaient en baisse en Méditerranée mais en très forte hausse à l’est de l’Europe. En août, les arrivées dans les îles grecques avaient été multipliées par cinq et les autorités locales maintenaient le silence sur ce qui se passait après le débarquement.
La Grèce était depuis longtemps le maillon faible de l’espace Schengen. Le pays avait rejoint la zone de libre-circulation en 2000 et devait en théorie appliquer les règles de Dublin. Mais dès le départ, la Grèce montra le même comportement de fraude qui caractérisait son appartenance à la zone euro 18 . Malgré les demandes de la Commission, la Grèce refusa de construire un système d’asile comme ceux attendus dans les pays de l’ouest, en faisant sien le raisonnement que personne ne pouvait demander l’asile s’il n’y avait personne à qui demander. Comme l’Italie, la Grèce poussait régulièrement les migrants entrés de façon irrégulière vers le nord, de manière à éviter le casse-tête d’établir leur statut. Les autres membres de l’espace Schengen débattaient pour savoir si cette administration chaotique était intentionnellement malveillante ou incroyablement faible. Avec ses frontières parmi les plus centrales et les plus difficiles à contrôler au monde, l’approche cynique de la Grèce était un facteur d’attraction majeur.
Lorsque la crise des bateaux a éclaté, l’État grec n’était pas en mesure de faire quoi que ce soit pour faire face à ce nouvel afflux dans les îles. La Grèce n’avait toujours pas de système d’asile ni d’infrastructures d’accueil adaptées. De plus, le pays était en plein milieu d’une immense crise économique et la confrontation avec ses créditeurs au mois de juillet précédent l’avait poussé à un programme d’austérité extrêmement rigoureux. Alors que les garde-côtes grecs acceptaient l’aide de Frontex pour les opérations de sauvetage en mer, les autorités du pays ne voulaient pas discuter d’un plan pour reprendre le contrôle de la situation générale. Un tel plan signifiait la mise en place d’un système d’enregistrement convenable, le filtrage des migrants et la fin de la politique de « laisser-passer » de Tsipras. La Commission pensait que seule la carotte du système de relocalisation pouvait conduire Athènes à agir de façon responsable, puisque l’acceptation du système impliquait une part de supervision des procédures de demande d’asile grecques (plus tard, en octobre 2015, lorsque la situation devint complètement hors de contrôle, Juncker essaya tardivement de durcir la politique de la Commission en disant à la Grèce et aux migrants qui arrivaient : « pas d’enregistrement, pas de droits » 19 ).
Tsipras n’était pas le seul à être confronté à des choix difficiles. Depuis plus de deux ans maintenant, tous les mois, des dizaines de milliers de migrants remontaient l’Italie et les Balkans pour demander l’asile en Europe du Nord, principalement en Allemagne et en Suède. Angela Merkel, chancelière allemande depuis 2005, était par nature d’une prudence presque pathologique. Mais elle savait aussi mener ses affaires au Conseil européen avec une détermination brutale, lorsque la situation l’exigeait. Sa première réaction était de considérer que l’Allemagne, de loin le premier pays d’accueil de demandeurs d’asile depuis plusieurs années, en avait déjà accueilli assez. Le pays était à ce moment-là en train de sévir contre une vague de fausses demandes de la part d’Albanais désireux de profiter des avantages sociaux liés au statut de demandeur d’asile. Merkel se souvenait également que lors de la dernière grande crise des migrants en Europe, dans les années 1990, l’Allemagne avait été en grande partie « laissée seule » pour absorber la plupart des mouvements de population provoqués par l’éclatement violent de l’ex-Yougoslavie.
D’un autre côté, la chancelière sentait le désir instinctif de ses compatriotes de venir en aide aux réfugiés syriens. Certes, les nombres élevés d’arrivées journalières étaient inquiétants. Mais la population accueillait les migrants dans les stations de train avec de l’eau, de la nourriture, des vêtements, et souvent des applaudissements. L’accueil spontané de ceux qui fuyaient la guerre rendait les Allemands fiers de leur pays, un sentiment que le fardeau de leur passé leur avait souvent interdit. Sans jamais faire tout à fait confiance à leurs propres instincts, ils se tournaient maintenant vers la figure affectueusement surnommée « Mutti » (maman) pour définir comment la nation répondrait à la situation. Merkel pensa à la façon dont l’Allemagne se souviendrait de cet épisode 50 ans plus tard. Puis, elle plongea dans l’inconnu et suivit les impératifs de la Sondermoral (la morale spéciale), une forme hyperbolique de l’éthique de la conviction. Vers la fin du mois d’août, elle dit à son pays « Wir schaffen das » : « Nous y arriverons », ce qui voulait dire : « Nous allons traverser cette épreuve ». La décision de Merkel, quelle qu’en soit la noblesse, fut aussi certainement influencée par des conseils internes qui lui affirmaient qu’il n’y avait pas d’option juridiquement solide pour mettre fin aux arrivées de masse.
L’accueil spontané de ceux qui fuyaient la guerre rendait les Allemands fiers de leur pays, un sentiment que le fardeau de leur passé leur avait souvent interdit.
Hugo Brady
Les historiens débattront des paroles de la chancelière, adressées à l’opinion publique allemande dans le but de gagner du temps, peut-être des années. Il n’y a pas à douter que sa déclaration fut passionnément re-visionnée sur des écrans de smartphone et de télévision dans des tentes de fortune et des salons de thé en Turquie, en Jordanie, au Liban, en Irak, au Pakistan, en Afghanistan et en Syrie. Des millions de personnes désespérées – pauvres ou non, en danger ou non, au Moyen-Orient ou non – ont interprété ces paroles comme une déclaration que l’Europe leur était ouverte, ou comme la formulation explicite par le plus puissant des dirigeants européens d’une invitation qui n’était jusque-là que supposée ou espérée. Les passeurs se jetèrent sur la déclaration pour alimenter leur propagande. Merkel alla ensuite encore plus loin et décida de suspendre la règle de Dublin du premier pays d’arrivée, ouvrant la voie vers l’Allemagne aux Syriens qui feraient le voyage (sur ce point, la Sondermoral a pris le pas sur la règle de droit). On peut soutenir que cela consistait seulement à reconnaître la réalité des faits et que les flux allaient de toute façon monter en flèche. Mais la chancelière restera toujours associée à la hausse record de l’afflux qui suivit, avec 10 000 personnes traversant chaque jour à pied la frontière extérieure et des scènes insolites telles que des groupes d’Afghans essayant de venir en Europe à vélo depuis la Russie. Deux semaines après sa déclaration, le 14 septembre 2015, l’Allemagne devenait le premier pays dans la crise à réintroduire des contrôles aux frontières au sein de l’espace Schengen. Une fois passé le moment de positivité, la prudence innée de Merkel reprenait le dessus. Comme Renzi et Mare Nostrum, elle avait maintenant besoin d’une porte de sortie.
Toutefois, à première vue, la chancelière semblait avoir parfaitement lu les signaux politiques. Le 2 septembre passaient à la télévision les terribles images du corps de Alan Kurdi, un petit garçon syrien de trois ans, innocent et paisible comme un enfant qui dort, échoué sur une plage turque, la face plongée dans la mer Egée. Prenant appui sur la vague générale de chagrin et d’indignation, Juncker releva le nombre de relocalisations obligatoires de demandeurs d’asile à 120 000 sur deux ans, en plus des 40 000 prévues au départ. Merkel apporta tout son soutien à Juncker et rallia les États membres modérés à la cause de la Commission. Le 22 septembre, le Luxembourg – qui occupait alors la présidence tournante de l’Union –, soumit la question de façon controversée au vote des ministres de l’intérieur, faisant ainsi passer le projet par-dessus les objections de la Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Roumanie. La Pologne vota en faveur du projet mais le parti Plateforme civique alors au gouvernement – mené par Tusk pendant sept ans avant qu’il ne devienne président du Conseil européen – fut battu aux élections du mois suivant par des nationalistes radicaux qui ont immédiatement inversé la tendance (la Finlande – qui hésitait entre les positions en faveur et contre les relocalisations obligatoires – s’est abstenue).
Après le vote, les responsables expérimentés qui pensaient que la relocalisation temporaire était tout au plus une distraction inutile ont alors ressenti un soulagement coupable. Au moins, espéraient-ils, c’en était fini de l’amertume et des postures morales, et les États membres pourraient enfin entamer une discussion sérieuse sur la fin de la crise. Cependant, un Conseil européen d’urgence qui se tint le lendemain était beaucoup trop tôt pour qu’ait lieu une sorte de catharsis, comme Tusk le nota ironiquement dans sa déclaration précédant le sommet : « personne ne sera mis en minorité » (Conseil européen, 2015b). Les Européens de l’Est protestèrent que leur dignité avait été blessée, clamant qu’ils contesteraient la décision de relocalisation devant les tribunaux au motif que Bruxelles n’avait pas le droit de décider à leur place qui pourrait entrer dans leur pays. Pendant ce temps, la crise s’intensifiait avec plus de 2 millions de Syriens en Turquie, environ 1 million en Jordanie et 1 autre million au Liban, ainsi que 4 millions de déplacés internes en Syrie même. Les Syriens partaient parce que les conditions de vie en Jordanie et au Liban se dégradaient, et parce que ceux en Turquie voulaient un meilleur avenir pour leurs enfants. La lassitude des bailleurs de fonds devant le conflit syrien de 2014 signifiait que les organismes internationaux en première ligne pour répondre à la crise humanitaire verraient leurs financements réduits. Cette vision à court terme accéléra les mouvements massifs de population. En conséquence, les dirigeants convinrent de mobiliser immédiatement 1 milliard d’euros pour nourrir les réfugiés sur les routes à travers le Programme alimentaire mondial des Nations Unis (Conseil européen, 2015c) et d’accroître les capacités du HCR pour venir en aide à la Jordanie et au Liban et stabiliser les populations déplacées.
Le résultat de ce sommet plein de bons sentiments dissimulait le fait que les dirigeants de l’Union, pressés par Tusk et par d’autres, commençaient enfin à avancer sur le sujet de la protection des frontières. Des visites de haut niveau furent programmées dans les pays des Balkans de l’ouest, en Grèce et en Turquie, qui reçurent cet automne-là de nombreuses ambassades de la part des pays concernés de l’Union ; ils reçurent également Frans Timmermans, l’adjoint de Juncker, et Tusk lui-même. Le pays clé était la Macédoine du Nord. Ce n’était qu’à condition que celle-ci ferme sa frontière avec la Grèce que les migrants, les passeurs, les pays de première ligne et les pays voisins entendraient le message que les Européens en avaient vraiment assez. Les Macédoniens du Nord et leurs voisins Serbes se dépêchèrent alors de tirer parti d’un bref moment d’opportunité politique, avant qu’une fermeture de frontière quelque part le long de la route ne ferme leur fenêtre d’opportunité.
La Turquie, pays qui accueille le plus de réfugiés au monde, était en position de force. Elle partageait une frontière avec la Syrie et avait réussi de façon impressionnante à fixer plus de 2 millions de Syriens sur son territoire, associant la générosité d’un pays développé à la flexibilité d’un pays en développement 20 . Contrairement à l’opinion généralement répandue, les réfugiés n’ont pas un droit d’entrer dans le pays qu’ils veulent, quel qu’il soit. Le seul droit associé à leur statut est un droit de non-refoulement, c’est-à-dire le droit de ne pas être repoussés vers les territoires où ils étaient en danger. Dans cette conception, la Turquie était un pays sans danger ; cela voulait dire qu’une négociation pouvait avoir lieu. Ahmet Davutoğlu, premier ministre de Turquie à cette époque, comprenait cela. Il attendit que le camp européen lui fasse des propositions et lança des attaques rhétoriques pour jouer sur les nerfs de ses homologues en laissant par exemple son ministre de l’intérieur, Süleyman Soylu, menacer « d’étouffer l’Europe » en envoyant chaque jour 15 000 migrants irréguliers de l’autre côté de la frontière 21 .
En réalité, les fonctionnaires de la Commission étaient déjà occupés à préparer un train de mesures grâce auxquelles la Turquie pourrait recevoir 3 milliards d’euros destinés à nourrir et éduquer la population syrienne. De plus, l’Union reprendrait les négociations bloquées sur l’adhésion de la Turquie et faciliterait l’entrée de ses citoyens dans l’espace Schengen. Lors d’une réunion en marge du G20 du mois de novembre, Tusk et Juncker durent supporter la jubilation de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui leur adressa une sévère réprimande qui fuita un peu plus tard sur un site d’information peu connu. Cela conduisit Tusk à soutenir qu’il était important d’envoyer le signal que l’Europe n’était pas désespérée à ce point ; autrement, les Turcs risquaient de pousser trop loin leur avantage. Pendant que les Grecs faisaient encore de l’obstruction, l’idée d’une fermeture coordonnée des frontières depuis l’Autriche jusqu’à la Macédoine du Nord fit son apparition. Tusk, qui connaissait bien les pays des Balkans, fit une tournée dans cette région en octobre pour se faire rassurer par les dirigeants locaux sur le fait que « pas un moustique ne passerait » 22 si les Européens donnaient des instructions claires et apportaient leur aide. Comprenant que le jeu était maintenant terminé, la Grèce fit formellement une demande d’intervention de l’Union en décembre en espérant pouvoir bénéficier d’une relocalisation ex post pour les 60 000 migrants encore présents sur son territoire, des milliers d’autres arrivant chaque jour au cours de l’hiver.
La fermeture des frontières dans les Balkans était prévue pour la réunion informelle du Conseil européen de la fin du mois de février 2016. Tusk présenta des conclusions qui appelaient à « rompre avec la politique du laissez-passer » (Conseil européen, 2016 8d). Dans le paragraphe 2 du communiqué du sommet, l’instruction tant attendue était non seulement transmise, mais elle fut aussi bien reçue. Quelques jours plus tard, la route des Balkans commençait à se refermer et le nombre d’arrivées déclina considérablement : de 70 000 en janvier 2016 à 30 000 au mois de mars. Mais il y avait désormais une divergence d’opinions entre les Européens sur la question de savoir ce qu’il fallait faire des Syriens, qui comptaient encore pour 30 à 50% des arrivées. Tusk pensait que dès lors qu’ils étaient en sécurité en Turquie, les tentatives des Syriens pour rejoindre l’Europe en masse pouvaient être arrêtées en bonne conscience. Ils ne fuyaient pas la guerre directement et ils étaient par conséquent des migrants économiques irréguliers, et non des demandeurs d’asile. Le 3 mars, à Athènes, Tusk put enfin faire la déclaration qu’il avait voulue faire un an plus tôt : « Ne venez pas en Europe. Ne croyez pas les passeurs. Ne risquez pas vos vies et votre argent. Tout cela ne sert à rien.«
La route des Balkans était maintenant fermée. Mais seul un accord avec la Turquie pouvait mettre fin à la crise de façon définitive. Pendant ce temps, la Willkommenskultur s’essoufflait en Allemagne après que les célébrations du Nouvel An dans tout le pays furent troublées par des phénomènes spontanés d’agression sexuelle par des hommes d’origine moyen-orientale et nord-africaine. Dans une situation inconfortable sur le plan politique, Merkel ne pouvait pas prendre le risque d’un désistement des turques. Nouvellement conseillée par le haut fonctionnaire du ministère de l’intérieur Jan Hecker, elle a perdu patience pour les institutions bruxelloises dont elle désespérait et qu’elle trouvait trop molles et trop cérébrales. A la dernière minute, la chancelière et son allié Mark Rutte, premier ministre hollandais, jouèrent le tout pour le tout. La veille d’une réunion à Bruxelles en vue de signer l’accord quasiment finalisé entre l’Union et la Turquie pour empêcher les nouveaux départs des côtes turques, Rutte offrit unilatéralement à Davutoğlu le double de l’arrangement financier (6 milliards d’euros) et proposa en plus un système d’échange de réfugiés par lequel « l’Europe » relocaliserait un Syrien pour chaque demandeur d’asile renvoyé en Turquie depuis les îles grecques 23 (une idée laborieuse pour contourner les réserves de certains États membres quant au refoulement de vrais réfugiés, y compris ceux qui transitent par des pays sûrs). Les Turcs, ravis, acceptèrent volontiers de présenter ce plan augmenté comme le leur. Préoccupé par l’établissement d’un précédent qui pourrait en inspirer d’autres à faire du chantage à l’Union, Tusk fut contraint d’accepter, puisque l’offre ne pouvait pas être déclinée sans mettre en danger l’accord initial. Les autres dirigeants étaient furieux. Merkel et Rutte avaient secrètement concédé de meilleures conditions à la Turquie dans leur dos. J. W. Beaujean, l’homologue néerlandais de Hecker et co-conspirateur dans cette affaire, décrirait plus tard cette initiative comme une « innovation disruptive ».
Dans une situation inconfortable sur le plan politique, Merkel ne pouvait pas prendre le risque d’un désistement des turques. Nouvellement conseillée par le haut fonctionnaire du ministère de l’intérieur Jan Hecker, elle a perdu patience pour les institutions bruxelloises dont elle désespérait et qu’elle trouvait trop molles et trop cérébrales.
Hugo Brady
Tusk calma les dirigeants européens, tandis que ses hauts fonctionnaires faisaient le point avec la Commission sur la façon dont la Grèce serait aidée à mettre en œuvre l’accord, ce qui comprenait l’envoi de centaines d’agents invités de l’Union pour aider au filtrage et aux renvois vers la Turquie. Le HCR et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) furent contraints au dernier moment de venir en aide aux autorités grecques, ce qui leur déplaisait instinctivement parce que les nouveaux arrangements semblaient remettre en cause le principe sacré de l’asile territorial. Le HCR riposta en veillant à ce que les procédures d’asile dans les îles comprennent une possibilité d’appel à deux niveaux, ce qui contredisait complètement l’intention initiale de mettre en place un « traitement accéléré » pour éliminer rapidement les demandes inadmissibles. Cependant, le 18 mars 2016, Davutoğlu signa la Déclaration UE-Turquie (Conseil européen, 2016b). En avril, le nombre d’arrivées retomba à 4 000 pour tout le mois. La phase aiguë de la crise était terminée.
L’Europe put souffler un peu pour la première fois depuis des mois. Mais les arrivées de bateaux et les « mouvements secondaires » depuis l’Italie (c’est-à-dire les mouvements vers d’autres pays de l’Union) se poursuivaient. Le nombre d’arrivées ne fut jamais aussi élevé que sur la route des Balkans et posait beaucoup moins de problèmes sur le plan moral parce que, contrairement à l’opinion généralement répandue, les Syriens arrêtèrent d’aller en Libye après 2015 24 . La grande majorité des arrivées en Méditerranée étaient celles de migrants économiques ouest-africains. Après une nouvelle hausse à la fin de l’année 2016, les dirigeants de l’Union se réunirent à Malte au mois de février suivant. La situation n’était plus aussi sombre qu’au mois d’avril précédent. La Libye avait retrouvé un semblant d’autorité centrale sous l’impulsion d’un nouveau gouvernement d’union nationale. Il s’avérait également que les garde-côtes libyens étaient toujours opérationnels malgré le conflit. Des renseignements supplémentaires révélèrent que les départs de masse n’avaient lieu que depuis une petite partie de la côte libyenne, la plus proche de la Tunisie, autour des villes de Zuwara et Sabratha.
Ces éléments étaient de bon augure. Cependant, le vrai changement fut apporté par un ministre de l’intérieur italien particulièrement rusé, Marco Minniti. L’ancien chef des renseignements et ex-eurocommuniste connaissait la politique interne des tribus libyennes sur le bout des doigts. Citant Deng Xiaoping 25 , Minniti conclut un accord avec les municipalités côtières libyennes pour qu’elles rejettent les passeurs en échange d’une aide de grande envergure. Il commença également à exiger des ONG qu’elles respectent un code de conduite. Certaines d’entre elles se comportaient moins comme des organisations humanitaires que comme des prétendues justicières, en cherchant la confrontation avec les autorités, en les attaquant dans les médias et en collaborant implicitement avec les passeurs. En tout état de cause, l’Union accepta de financer et d’aider à mettre en œuvre l’accord avec les municipalités libyennes et accepta également, en échange de l’arrêt des départs irréguliers, de former et d’équiper les garde-côtes libyens. Le résultat de cette politique fut que le nombre mensuel d’interceptions tomba sous la barre des 5 000 en août 2017 et resta sous ce seuil.
Analyser la réponse de l’Europe
« Il y a un an, au début de la crise migratoire, certains ont accepté comme un fait que la vague migratoire était trop importante pour être arrêtée. L’une des conséquences a été la suspension des règles de Schengen et de Dublin, ce qui a conduit à l’ouverture de notre territoire à une immigration incontrôlée. Mettre fin à cette tendance dangereuse nécessitait un changement de paradigme. Par conséquent, il y a plusieurs mois, j’ai proposé que nous fassions l’hypothèse inverse, à savoir, que la vague migratoire était trop importante pour ne pas être arrêtée. Notre priorité devrait donc être d’avoir une bonne politique migratoire. L’Union européenne et ses États membres devraient retrouver la capacité de décider qui franchit ses frontières, où et quand. » 26
La bataille pour la réponse de l’Europe à la crise des frontières était principalement une confrontation entre des colombes à tendance intégrationniste et des faucons à tendance réaliste. Chacun des deux camps avait ses propres nuances, des modérés aux plus intransigeants, qui allaient provoquer et faire réagir les opposants du camp adverse : les conservateurs « avec un petit c » contre les libéraux internationalistes ; les nativistes contre les one-worlders. Le camp des faucons rassemblait principalement Tusk, l’Autriche (après 2016), le Danemark, les pays baltes, les pays dits du V4 27 (République tchèque, Hongrie, Pologne, Slovaquie), pratiquement tous les ministres de l’intérieur et quelques responsables de diverses institutions de l’Union non dénués de bon sens, notamment la Direction générale « Justice et affaires intérieures » de la Commission 28 .
La bataille pour la réponse de l’Europe à la crise des frontières était principalement une confrontation entre des colombes à tendance intégrationniste et des faucons à tendance réaliste. Chacun des deux camps avait ses propres nuances, des modérés aux plus intransigeants, qui allaient provoquer et faire réagir les opposants du camp adverse.
Hugo Brady
Longtemps critique à l’égard de la porosité des frontières extérieures de l’espace Schengen, la France était certainement un faucon de cœur. Le premier ministre français, Manuel Valls, remettait ouvertement en question la politique de Merkel, rappelait en grognant que « ce n’est pas la France qui a dit ‘Venez’ ». Mais à cause de la nécessité pour la France de rester proche de l’Allemagne pour obtenir un accord sur un nouveau paradigme économique dans la zone euro, son gouvernement socialiste garda une attitude de sphinx impénétrable par la suite. De la même façon, l’Espagne, bien qu’en étant formellement du côté des colombes, était aussi un faucon de cœur, ou bien elle était neutre, dans la mesure où elle n’a jamais vraiment cru que la relocalisation était la bonne réponse aux pressions migratoires, et dans la mesure où elle comptait sur ses arrangements particuliers avec les pays ouest-africains et le Maroc pour empêcher les départs de bateaux.
Ce qui n’est généralement pas très bien compris est que les désaccords entre colombes et faucons concernaient tout autant la manière de procéder et le séquençage que le contenu des mesures à prendre. Dans la vision du monde des faucons, Schengen et Dublin avaient été conçus comme des systèmes opérationnels de contrôle des frontières pour compenser de manière effective la protection perdue des anciennes frontières nationales, et non pour être retransformés en systèmes de distribution de demandeurs d’asile ou pour flatter les consciences progressistes de Bruxelles. De plus, l’aspect répétitif du phénomène des arrivées de bateaux signifiait que la communication de l’Union devait être parfaitement transparente : l’Europe ne tolérerait pas des arrivées de masse spontanées ; donc les bateaux n’étaient pas les bienvenus. A l’époque des communications numériques de masse, le message devait être aussi ferme que cela ; autrement la crise n’en finirait plus. Pendant ce temps, discrètement, les Européens augmenteraient leurs contributions à l’assistance humanitaire et à l’aide au développement pour prendre en charge les réfugiés et pour accélérer la reconstruction des zones de conflit, en espérant que le reste du monde se réveillerait également pour prêter main forte. Tusk essaya de mettre ce dernier point à l’agenda international lors de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2015 en caractérisant la question des réfugiés Syriens de « crise d’envergure mondiale ». Son plaidoyer fut accueilli dans un silence assourdissant par la communauté internationale, et les États pétroliers du Golfe, par exemple, brillèrent par leur refus d’accueillir ou d’aider les Syriens.
Les colombes, menées par l’Allemagne, la Suède et les dirigeants de la Commission européenne et soutenues par le Parlement européen, le HCR et par les milieux européens de la politique étrangère, considéraient qu’une telle approche était contraire à l’identité et aux valeurs de l’Union en tant que projet de paix. Le message humanitaire devait être le message dominant, et la politique phare de cette conception devait être la relocalisation. En attendant, c’était les efforts pour contrôler les frontières extérieures, détestables mais nécessaires, qui devaient être menés discrètement. Etant donné que la légitimité européenne repose en grande partie sur son soft power (le pouvoir d’attraction plutôt que l’attrait du pouvoir), cette analyse paraissait tout à fait solide. Mais sa grande faiblesse résidait dans le fait que le message politique extrêmement bienveillant et positif serait bien sûr interprété par les passeurs et les migrants comme voulant dire : « Venez ».
Alors que les faucons, pragmatiques et pessimistes, ne se laissaient pas impressionner par les gestes politiques et restaient instinctivement hostiles à l’égard des visions grandioses, les colombes étaient enflammées par un volontarisme optimiste et déterminées à engager les structures de l’Union à la poursuite d’idéaux progressistes. Les faucons modérés craignaient réellement que le chaos s’abatte sur l’Union en propulsant des extrémistes eurosceptiques au pouvoir, comme cela semblait possible à l’époque avec les élections de l’année suivante en France et aux Pays-Bas ; ou que le reste de l’Europe centrale et de l’Est suive la voie de la Pologne et de la Hongrie. Puis, comme si les tensions n’étaient pas encore assez fortes, on apprit ensuite qu’au moins deux des terroristes de l’États islamique ayant pris part aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris qui firent 130 morts étaient entrés en Europe via Leros, en se faisant passer pour des réfugiés (dans un rassemblement de partis d’extrême-droite à Coblence, en Allemagne, Marine Le Pen voulait tirer la conclusion effrayante de ces événements et déclarer la fin de la démocratie libérale : « leur monde finit, le nôtre commence »). Les colombes étaient inflexibles, et quoi qu’il arrivât, elles n’adopteraient tout simplement jamais le langage hostile des populistes à l’égard des demandeurs d’asile. Elles souhaitaient plutôt se concentrer sur le développement des capacités d’accueil dans les pays peu disposés de la route des Balkans – camps de fortune, hébergement pour une nuit, etc. – pour essayer d’endiguer le flux, le rendre plus ordonné et mieux gérable.
Les faucons craignaient les manifestations d’amateurisme ou la vertu ostentatoire et bien intentionnée d’un grand nombre de figures de l’Union à Bruxelles qui, à un stade aussi avancé de la crise, ne comprenaient toujours pas la gravité de la situation. Ironiquement, les faucons modérés se concentraient plutôt sur la communication extérieure, à destination des migrants, des passeurs et des puissances étrangères qui essayaient de profiter de la crise pour affaiblir fatalement l’Union, tandis que les colombes internationalistes regardaient vers l’intérieur, en cherchant à sensibiliser le public européen à une nouvelle ère de migrations mondiales présentées comme inévitables. Les européens de l’Est en particulier détestaient presque autant cet argument de « l’inévitabilité » qu’ils détestaient les prétentions de la Commission à organiser un mouvement de populations de migrants à travers tout le continent. Ils comparaient sévèrement ce genre de discours et ces velléités de centralisation aux régimes communistes totalitaires sous lesquels ils avaient vécu pendant 40 ans. Avaient-ils donc rejoint l’Europe pour être attirés une fois de plus dans des rêveries utopiques, qui étaient cette fois celles des enfants de classe moyenne de Bruxelles ? D’après leur expérience, les dogmes politiques enveloppés dans des idéaux de fraternité universelle tournaient souvent au cauchemar.
Les européens de l’Est en particulier détestaient presque autant cet argument de « l’inévitabilité » qu’ils détestaient les prétentions de la Commission à organiser un mouvement de populations de migrants à travers tout le continent.
Hugo Brady
Les colombes ne pensaient pas aux facteurs d’attraction, au trafic d’êtres humains et aux boat-people, elles n’en parlaient pas non plus. Elles concevaient tout l’épisode au moyen d’un vocabulaire purement humanitaire et comme un moment de vérité pour la réputation de l’Europe en tant que porte-étendard des idéaux progressistes. Elles mobilisèrent la notion de responsabilité collective européenne pour le colonialisme – un sentiment étranger aux européens de l’Est – et avancèrent que les bateaux et leurs occupants étaient une réponse au déclin démographique du continent (en un sens, elles avaient raison sur ce point : environ 100 000 enfants syriens naissent tous les ans en Turquie dans d’immenses camps de réfugiés, ce qui fera croître la population du pays d’un million en une décennie). Il est absolument essentiel de comprendre aussi que la Commission européenne est un acteur humanitaire mondial majeur, avec un bilan qui remonte à la fin des années 1950 et à la création du Fonds européen de développement en même temps que des Communautés européennes. En revanche, en 2015, la Commission n’avait eu à gérer le système de Schengen que depuis quelques années, depuis le remaniement des règles d’évaluation de la zone de libre-circulation en 2011. Pendant la crise, cet héritage déséquilibré pencha nettement en faveur de ses instincts humanitaires et explique pourquoi Bruxelles était plus à l’aise pour dépenser ses énergies dans la coordination des efforts humanitaires en Grèce et dans les Balkans et dans la recherche de solutions adaptées aux personnes secourues en Méditerranée centrale.
Par-dessus tout, les colombes voulaient être « du bon côté de l’histoire », pour reprendre une expression qui était souvent utilisée à cette époque. Le même argument était souvent repris par la puissante Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen, qui gardait une position sans compromis sur la relocalisation et qui essaya en mars 2017 de forcer les gouvernements à délivrer des visas humanitaires à toute personne venant du Moyen-Orient pour faire une demande d’asile en Europe. Mais le problème était qu’un changement de politique comme celui-ci, avec des conséquences majeures pour les sociétés européennes, n’avait à peu près aucun effet sur les perspectives de réélection des députés en mai 2019. Les électeurs n’avaient absolument aucune idée de ce que faisait le Parlement.
Les colombes pensaient que le continent était trop fermé et dépourvu de voies légales pour l’entrée des migrants. Les faucons, nouvellement initiés aux hypocrisies gestionnaires de Schengen et de Dublin, étaient choqués d’apprendre que leurs pays n’avaient apparemment aucune frontière efficace avec l’Afghanistan, l’Irak ou la Syrie. Pour les faucons, l’Europe était un territoire commun à chérir et à protéger, et c’est d’ailleurs ce qui la définissait principalement en tant que communauté politique. Pour les colombes, l’Europe était le symbole de valeurs universelles qui ne doivent être trahies à aucun prix. Pour les faucons, les valeurs européennes signifiaient : « ouverture des frontières pour les Européens » ; pour les colombes, elles signifiaient : « ouverture des frontières pour tous » (ce conflit interne sur la nature fondamentale de l’Union – entre une vision plus républicaine et une autre vision universaliste – se retrouve dans d’autres domaines, comme en politique étrangère ou dans le droit constitutionnel européen). Les deux camps étaient certains que la suite des événements leur donnerait raison. Aucun des deux camps ne doutait que le sien était le camp de la responsabilité, du réalisme et de l’intérêt de l’Europe.
Angela Merkel fit une brillante manœuvre de triangulation entre ces deux univers mentaux. Sans le vouloir, elle était devenue la figure de l’Ouest libéral dans un monde de plus en plus sombre, elle était célébrée par les médias internationaux et avait été nommée « personnalité de l’année » par le Time Magazine en 2015 pour ses prises de position en faveur des réfugiés. Au même moment, elle manœuvrait pour mettre fin aux flux de personnes grâce à un accord entre l’Union et la Turquie, pour lequel l’Union essuierait les critiques des libéraux qui dénonçaient un « dirty deal« . Pendant un temps, elle était intouchable. Le nouvel an 2016 mit brutalement fin au sentiment positif. Ces événements étranges et inquiétants inspirèrent une joie malsaine, Schadenfreude, à ceux qui pensaient que l’approche de Merkel révélait au mieux une naïveté affligeante, ou au pire une forme d’impérialisme, en prônant des sentiments d’humanité qui s’alignaient comme par magie avec les intérêts allemands.
Merkel répéta à plusieurs reprises l’argument astucieux selon lequel elle ne pouvait pas comprendre comment un continent riche de 500 millions d’habitants ne pouvait pas se partager l’accueil d’un million de Syriens. Mais cet argument cachait la réalité, notamment les nombreux problèmes opérationnels liés à la relocalisation, mais aussi le fait que même si elle était parfaitement mise en œuvre, cette relocalisation ne permettrait pas à elle seule de réduire la pression migratoire sur les pays de première ligne : en soi, la relocalisation était même un autre facteur d’attraction vers ces pays (sur ce point, les colombes sont en désaccord et pensent que la relocalisation vers un pays différent de la destination originellement prévue remet en cause le modèle économique des passeurs et constitue par conséquent une forme de contrôle aux frontières en accord avec les idéaux humanitaires).
Répartir des étrangers sans papiers entre plusieurs administrations est peut-être facile sur le papier. Mettre en place des procédures de filtrage efficaces en Grèce et en Italie pour y parvenir, c’est une autre paire de manches. La longueur des procédures d’asile associée à la lenteur des systèmes juridiques méditerranéens faisaient en sorte que le système ne pouvait pas fonctionner avec des réfugiés dont les récits avaient été vérifiés, comme c’est le cas dans la procédure de réinstallation des Nations Unies, mais seulement avec ceux qui prétendaient être des réfugiés. Les demandeurs d’asile détruisent régulièrement leurs documents d’identité à l’arrivée, pour rendre plus difficile aux autorités la tâche d’établir leur statut ou de les renvoyer dans leur pays d’origine. Les pays de l’Union devaient alors accepter de prendre les demandeurs d’asile sur parole et faire la procédure chez eux. Cette situation conduisit à de longs retards et à des impasses, parce que les États membres voulaient avoir le plus de certitudes possibles avant d’accepter des personnes qui pouvaient représenter des menaces pour la sécurité nationale ou qui n’étaient pas de la nationalité déclarée.
La longueur des procédures d’asile associée à la lenteur des systèmes juridiques méditerranéens faisaient en sorte que le système ne pouvait pas fonctionner avec des réfugiés dont les récits avaient été vérifiés, comme c’est le cas dans la procédure de réinstallation des Nations Unies, mais seulement avec ceux qui prétendaient être des réfugiés.
Hugo Brady
L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés soutenait fortement l’introduction de quotas obligatoires en Europe. Avec plus de 70 millions de personnes déplacées au niveau mondial 29 , l’agence basée à Genève cherchait à tout prix à étendre le nombre de places offertes pour la réinstallation à travers le monde. Elle comptait sur l’Union, relativement stable et aisée, où elle avait l’oreille attentive de la Commission et où la moitié des États membres ne recevaient pratiquement pas de réfugiés, et la regardait comme un fruit mûr. Cependant, même dans ces circonstances, le HCR conseilla à Bruxelles de rester prudent. Malgré un mandat clair, 70 ans d’expertise accumulés et un réseau mondial, l’agence n’arrivait à réinstaller depuis les zones de conflit qu’environ 100 000 réfugiés de bonne foi par an. Il était très peu probable que la Commission, inexpérimentée, puisse organiser un système tout à fait inédit à partir de rien, alors que la crise perdurait, et parvienne à relocaliser 160 000 personnes en deux ans. Comme on pouvait s’y attendre, seule une embarrassante poignée de migrants fut transférée au cours des six premiers mois, et deux ans plus tard, seuls 20% avaient été relocalisés. Qui plus est, peu de migrants, voire aucun, ne restèrent dans leur pays d’affectation, que le pays hôte soit le Portugal, la Lituanie ou le Luxembourg. Presque tous « s’auto-relocalisaient » rapidement pour rejoindre les réseaux de migrants existant dans leurs pays de destination privilégiés, généralement l’Allemagne ou la Suède. Toute l’entreprise prenait un tour tragique et ressemblait à une mise en garde contre « les excès technocratiques ». 30
Néanmoins, la Commission déclara de façon très douteuse que le régime temporaire était un succès et qu’il avait permis de faire mieux que de sauver la face. La crise avait révélé les dysfonctionnements du système de Dublin aux yeux de tous. Plusieurs États avaient remis en place des contrôles aux frontières au sein de l’espace Schengen et refusaient de les lever. La Commission voulut y répondre en reprenant le système d’asile commun selon un nouveau grand dessein. Le cœur de cette réforme serait une refonte du règlement de Dublin pour y inclure – malgré la furie du V4 – un volet permanent et obligatoire sur la relocalisation. En réalité, la Commission proposait un quid pro quo, une chose pour une autre : des quotas systématiques pour soulager les pays de première ligne, en échange de leur acceptation légale et explicite, pour la première fois, d’être les garde-frontières de l’Europe. Cette dernière idée se traduirait en termes bureaucratiques par une extension de la responsabilité des États membres pour le filtrage des premières arrivées de un à dix ans, c’est-à-dire qu’un demandeur d’asile qui entrerait en Italie et serait ensuite repéré en Norvège pourrait être renvoyé aux fins de décision devant les tribunaux italiens jusqu’à dix ans plus tard, et vice versa 31 . De plus, les procédures aux frontières extérieures pour établir le statut d’immigrant seraient désormais obligatoires, de préférence pour chaque migrant irrégulier sans exception.
Le plan de la Commission était intéressant, mais le moment n’était pas le plus propice. Les blessures de la crise étaient encore saignantes et la confiance était au plus bas. L’un après l’autre, tous les textes de compromis présentés par les différentes présidences du Conseil entre mai 2016 et 2019 étaient rejetés, quel que soit leur degré de subtilité ou d’élaboration. Même si les États membres parvenaient à un accord au sein du Conseil européen, le Parlement européen attendait en coulisses pour imposer une vision alternative radicalement différente lors du second tour des négociations, à côté de laquelle même le plan original de la Commission « ressemblerait à une proposition du V4 », selon les mots de hauts responsables. La vision futuriste du Parlement pour une relocalisation permanente était considérée comme de la science-fiction par la Suède elle-même, le lion libéral de l’Union sur les questions relatives aux réfugiés.
Sur le plan politique, récompenser les pays avec des quotas permanents après 20 ans de non-respect des règles au sein de l’espace Schengen, c’était comme si l’Allemagne proposait d’émettre des obligations d’État conjointement avec la Grèce et l’Italie sans aucune réforme préalable 32 . Où était la garantie que les quotas mettraient vraiment fin à l’aléa moral à la frontière extérieure ? Les Pays-Bas voulaient croire que cela fonctionnerait. Le gouvernement néerlandais, qui avait fait pression en 2016 pour que Frontex devienne le nouveau garde-frontières et garde-côtes de l’Europe, appartenait à cette espèce rare : celle des faucons intégrationnistes (la Bulgarie appartenait également à cette espèce, elle était un État membre de l’Union n’appartenant pas à l’espace Schengen qui avait une politique frontalière très stricte mais qui considérait aussi que la relocalisation était largement dans son intérêt).
Les Néerlandais voyaient en fait les quotas comme un moyen de discipliner les États en bordure de l’Union. L’Italie et la Grèce accusaient souvent « l’Europe » de les abandonner, peu importe les millions d’aides envoyés par Bruxelles vers les pays du Sud pour financer leurs contrôles aux frontières et leurs systèmes d’asile. Désormais, la transparence du nouveau système proposé les empêcherait de se poser en victimes aux yeux du public tout en poussant les migrants en situation irrégulière vers le nord. Et les pays du Sud auraient enfin à se confronter à un problème difficile qu’ils avaient tenté d’esquiver depuis leur entrée dans l’espace Schengen : celui de placer en détention les nombreux demandeurs d’asile qui se sont enfuis avant qu’une décision soit prise sur leur statut. Les pays de l’Est pouvaient invoquer les quotas avec la même véhémence, les Italiens en particulier étaient catégoriques : ils ne construiraient jamais un « système pénitentiaire parallèle » dans leur pays pour les migrants irréguliers, peu importe combien la Commission et les pays du Nord insisteraient sur la nécessité d’une forme de détention pour empêcher les mouvements secondaires. Il convient de noter ici que, même selon le HCR, la grande majorité des arrivées irrégulières en Méditerranée centrale ne seraient pas éligibles au statut de réfugié. Par conséquent, les Italiens étaient particulièrement terrifiés à l’idée de devoir enfermer des milliers de demandeurs d’asile déboutés pendant de longues périodes, sans pouvoir les expulser.
L’argument de longue date des Européens du Nord était que si les pays méditerranéens de l’espace Schengen durcissaient les procédures d’asile à leurs frontières, y compris par la détention, cela mettrait fin une fois pour toutes aux arrivées irrégulières de bateaux, sans doute après une période d’adaptation qui pourrait être difficile. Pour les Pays-Bas, cette solution permettait de sécuriser la frontière extérieure en recourant aux arguments du droit (c’est-à-dire de la règle de droit, et non du droit du sang ou du droit du sol). Les Néerlandais pensaient, peut-être un peu naïvement, que les pays méditerranéens devaient simplement adopter leur propre système très efficace de filtrage des demandeurs d’asile en quelques jours ou semaines. En même temps, il fallait montrer aux Européens de l’Est que les bénéfices de l’espace Schengen n’étaient pas sans contrepartie. Leur insistance obstinée à dire que ce n’était pas leur crise fut perçue comme un autre symptôme d’une dérive illibérale à laquelle il fallait faire face. En lisant entre les lignes, c’était aussi désormais la position de la France après l’élection d’Emmanuel Macron et de La République En Marche ! en mai 2017.
Les pays de l’Est pouvaient comprendre tout cela, bien sûr. Ce qu’ils ne comprenaient pas, c’était pourquoi il leur revenait à eux, États frontaliers qui n’avaient jamais causé de problème au bon fonctionnement de l’espace Schengen, de payer le prix de l’incapacité de la Commission à faire appliquer les règles en Italie et en Grèce, ni pourquoi ils devaient être contraints à devenir des sociétés multiculturelles par des pays de l’Ouest prétentieux qui arrivaient à peine à intégrer leurs propres populations de migrants de première et de seconde génération. Et ils n’avaient aucun doute sur le fait que, parce qu’elle ne pouvait même pas occasionnellement se résoudre à parler le langage de la fermeté, la Commission du côté des colombes n’appliquerait jamais les règles de responsabilité renforcées du nouveau système de Dublin dans les pays du Sud. Au lieu de cela, elle ne parlerait toujours que de relocalisation, de relocalisation et de relocalisation.
Les pays de l’Est pouvaient comprendre tout cela, bien sûr. Ce qu’ils ne comprenaient pas, c’était pourquoi il leur revenait à eux, États frontaliers qui n’avaient jamais causé de problème au bon fonctionnement de l’espace Schengen, de payer le prix de l’incapacité de la Commission à faire appliquer les règles en Italie et en Grèce, ni pourquoi ils devaient être contraints à devenir des sociétés multiculturelles par des pays de l’Ouest prétentieux qui arrivaient à peine à intégrer leurs propres populations de migrants de première et de seconde génération.
Hugo Brady
Les Italiens commencèrent à argumenter, de façon peu opportune mais cohérente, que ce n’était pas de leur faute si le droit international et la jurisprudence européenne les obligeaient à secourir les personnes en mer. Ils trouvaient extrêmement injuste que les ONG, souvent financées par l’Allemagne, continuent d’amener des dizaines de milliers de migrants en situation irrégulière dans leurs ports pendant que Berlin insistait, en vertu des règles de Dublin, pour que Rome reprenne ensuite tous les demandeurs d’asile qui avaient réussi à atteindre l’Allemagne. Désormais, l’Italie voulait que toutes les arrivées maritimes irrégulières, de demandeurs d’asile ou non, soient exemptées de la règle du premier pays d’arrivée et automatiquement réparties dans l’Union avant les procédures à la frontière. Le pays exprimait enfin sa vengeance contre les implications de la décision Hirsi.
Au milieu de l’année 2017, le Premier ministre par intérim Paolo Gentiloni indiqua clairement à Tusk que l’Italie avait plus à perdre en acceptant une responsabilité renforcée pour les procédures à la frontière (ce qui impliquait un enregistrement officiel en tant que demandeur d’asile sur le territoire italien) qu’elle n’avait à gagner à une relocalisation permanente. L’Italie conclut alors une alliance de circonstance improbable avec les États en première ligne de l’Est de l’Union pour faire opposition à la proposition de la Commission d’une période de responsabilité de dix ans. Cela conduisit Tusk à la conclusion qu’il ne se risquerait pas à lancer un débat houleux sur les règles en matière d’asile au niveau des dirigeants tant qu’il n’existerait pas de proposition en mesure de soulager les Italiens et de sécuriser les frontières extérieures sans créer d’autres facteurs d’attraction.
Dans le même temps, la mauvaise application de l’accord avec la Turquie par la Grèce soulevait de sérieux doutes quant à la capacité du pays à participer de façon effective au système de Dublin. Malgré des milliers d’agents d’autres pays de l’espace Schengen venus en renfort et une réforme globale du système d’asile grec en 2018, les échanges de réfugiés étaient un échec incontestable, avec pratiquement aucun retour forcé de Syriens vers la Turquie 33 . De plus, malgré des aides de l’Union s’élevant à plus de deux milliards d’euros, les Grecs ne pouvaient ou ne voulaient pas s’assurer que les installations d’accueil sur les îles étaient assez adaptées – ne parvenant même pas à fournir des tentes assez chaudes aux demandeurs d’asile pour la période hivernale. Au lieu de cela, ils commencèrent à vider les camps de façon périodique en transférant les cas les plus graves sur le continent, ce qui allait constituer un autre facteur d’attraction et ancrer la crise pour quatre années supplémentaires. Le seul acteur grec fiable semblait être l’armée, appelée de temps en temps pour construire des infrastructures d’urgence.
Au sein des institutions de l’Union, où beaucoup considéraient que la pression sur les épaules des responsables politiques nationaux n’avait pas grand-chose à voir avec eux, le cheminement intellectuel évolua au fil des questions suivantes : devrions-nous arrêter les flux ? Pouvons-nous arrêter les flux ? Comment pouvons-nous arrêter les flux ? Chacun de ces petits changements rencontrait une opposition farouche du côté du Parlement européen, des services de la Commission en charge de l’humanitaire et du développement – ce qui exaspérait les faucons, puisque ces services contrôlent presque tous les financements pertinents, seul atout qui permettrait d’apporter une contribution essentielle s’il était utilisé à bon escient – et des hauts responsables de l’Union en charge de la politique étrangère. Ils étaient soutenus par la clique des ONG progressistes, des groupes de défense des réfugiés 34 et des organisations internationales, qui tout en recevant la plupart de leurs financements de la part de l’Union n’hésitaient pas à traîner son nom dans la boue en public ou à saper sur le terrain toute tentative de reprendre le contrôle de la situation au nom d’une opposition idéologique 35 . Même l’administration de Donald Trump ne faisait pas l’objet de critiques aussi véhémentes que celles que ces acteurs adressaient à l’Europe, malgré la politique très dure de détention à la frontière de Trump et la réduction à néant des quotas de réinstallation des États-Unis. Pendant ce temps, l’Union était mise au pilori, même si elle soutenait tout le système humanitaire mondial 36 .
De même, le Canada – qui n’a pas dû faire face un seul instant au type d’arrivées de masse par la mer que l’Europe a endurées pendant plusieurs années – était porté aux nues pour sa réinstallation rapide de 40 000 Syriens en 2016, pendant qu’on jugeait honteuse l’attitude des Européens qui recevaient des centaines de milliers de demandes d’asile par mois (le taux de confirmation des demandes d’asile des Syriens par l’Union était à peu près de 90%). La principale obsession des agences internationales était de s’opposer à toute évolution de l’Europe vers une forme de « traitement externe », qui consisterait à déterminer le statut de réfugié dans des centres spéciaux situés hors de l’Union tout en empêchant les arrivées irrégulières. L’Autriche et le Danemark en particulier faisaient la promotion d’un remaniement radical de ce genre en le présentant comme la seule réforme effective et à long terme du système de Dublin, et en se référant à la vulnérabilité géographique de l’Europe ainsi qu’à l’abus systématique par les migrants économiques en situation irrégulière du droit de demande d’asile, utilisé comme un simple moyen de traverser la frontière.
Le groupe des colombes de l’Europe ne devait pas être pris à la légère. Il a souvent agi avec une assurance morale péremptoire, en formant un complexe humanitaro-internationaliste à l’intérieur et autour des institutions européennes, qui n’avaient aucun intérêt à l’intégrité du système Schengen ou à l’arrêt des bateaux. Au contraire, ils croyaient passionnément que le flux de migrants en lui-même n’était ni une menace ni un problème, mais une obligation légale et une responsabilité humanitaire pour l’Europe. Les colombes avaient une vision panglossienne des migrations, régulières ou non, elles croyaient que les responsables pouvaient recadrer les perceptions par le public de la crise en cessant de recourir aux métaphores liquides dans leurs discours, et elles pensaient que l’Europe pouvait facilement prendre en charge les arrivées si elle s’élevait à la hauteur des circonstances et prenait la peine de « s’organiser » – euphémisme régulièrement utilisé par Filippo Grandi, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés – pour mettre en œuvre la relocalisation (Grandi 2016). Cependant, aucun de ces acteurs n’aurait à aller convaincre les électeurs européens de l’Est ou de l’Ouest d’accepter les arrivées de masse en cours, à forcer les demandeurs d’asile relocalisés à rester dans leur pays d’affectation, ou à obliger les autres États de l’espace Schengen à renforcer leurs contrôles aux frontières à mesure que la Grèce laissait passer les migrants. Et pas un ne voulait expliquer pourquoi l’Europe était la seule région du monde à tolérer un phénomène de crise migratoire maritime permanente.
Le groupe des colombes de l’Europe ne devait pas être pris à la légère. Il a souvent agi avec une assurance morale péremptoire, en formant un complexe humanitaro-internationaliste à l’intérieur et autour des institutions européennes, qui n’avaient aucun intérêt à l’intégrité du système Schengen ou à l’arrêt des bateaux.
Hugo Brady
Les réactions des petits États
Pour les plus petits États, la crise frontalière était définie de façon régionale ou stratégique. L’analyse régionale permettait d’établir s’ils étaient directement exposés aux arrivées irrégulières ou uniquement aux conséquences des soubresauts de la politique européenne. Le cas de la Macédoine du Nord mérite d’être développé. Avec une politique intérieure digne d’un cirque, des voisins malveillants et une administration faible (la population s’élève à 2 millions d’habitants), le pays a vécu un moment de grande vulnérabilité au moins d’août 2015, lorsque les autorités ont été tout simplement dépassées par le nombre irrésistible d’entrées irrégulières. Il faut ajouter à cela le fait que les relations avec la Grèce étaient presque inexistantes, à cause d’une querelle qui dure depuis une trentaine d’années entre les deux pays sur l’appropriation du nom « Macédoine ». Cependant, la localisation de la Macédoine du Nord lui donnait une importance capitale pour fermer la route des Balkans. Au cours des années 2015 et 2016, le pays négocia sans complexe l’aide de l’Union pour obtenir des renforts humains pour ses frontières. Le résultat fut le déploiement d’une mission multinationale composée de personnels des pays de la région et du V4 et l’envoi de 10 millions d’euros pour l’achat d’équipement de surveillance et de véhicules de patrouille.
On aurait pu s’attendre à ce que les relations avec la Grèce se dégradent encore. En effet, des responsables de l’Union furent consternés lorsqu’en novembre 2015, des diplomates grecs refusèrent de siéger dans la même pièce que des Macédoniens du Nord lors d’une réunion d’urgence au plus fort de la crise. Ce fut donc une surprise générale lorsque le conflit sur le nom de la Macédoine, qui durait depuis plusieurs décennies, fut résolu peu de temps après la fin de la crise des frontières. On peut soutenir, et c’est même probable, que l’épisode migratoire a rappelé à la Grèce l’importance stratégique d’une normalisation de ses relations avec son voisin (la Bulgarie voisine, par exemple, n’a pas agi une seule fois contre les intérêts de la Grèce au cours de la crise, malgré leur frontière commune). Quelle qu’en soit la raison, les destinées de la Macédoine du Nord ont fait un grand pas en avant, depuis que la Grèce a levé son veto sur ses négociations d’adhésion à l’Union européenne et à l’OTAN.
En ce qui concerne les petits États membres de l’Union, Malte et la Slovaquie sont de bons cas d’étude car l’un a fortement soutenu la relocalisation permanente et obligatoire alors que l’autre s’y est fortement opposé. Tous deux ont été chargés de trouver une solution diplomatique au désaccord en apparence insurmontable entre les États membres à propos de la réforme du règlement de Dublin au cours de leurs mandats successifs à la présidence tournante du Conseil de l’Union au second semestre de 2016 et au premier semestre de 2017. Même en ayant des intérêts importants dans la crise, tous deux ont réussi à convaincre et sont passés pour des acteurs relativement honnêtes. La présidence slovaque a introduit le concept de « solidarité flexible », soit l’idée que les pays qui ne souhaitent pas accueillir des migrants montrent leur solidarité par d’autres moyens, en fournissant par exemple des garde-frontières, des équipes de filtrage des demandeurs d’asile, des équipements ou de l’argent. Le concept est resté, même si les Slovaques n’ont pas réussi à trouver la bonne formule pour son application, ce à quoi aucune présidence du Conseil ne parviendra peut-être jamais. Malgré le comportement turbulent du premier ministre Robert Fico, la Slovaquie sortit de la crise avec la réputation d’être le pays le plus modéré du V4, en accueillant une poignée de demandeurs d’asile venant de Grèce ou d’Italie pour la forme sans pour autant changer sa position sur la relocalisation ni s’attirer les foudres des autres pays du V4 (seuls la Pologne et la Hongrie refusèrent par principe d’accueillir le moindre demandeur d’asile). Avec l’Allemagne et d’autres contributeurs nets qui veulent lier les futurs transferts budgétaires de l’Union à la question des réfugiés, le tango discret de la Slovaquie entre principes et pragmatisme pourrait avoir un jour une grande importance pour le résultat net du pays.
Malte était de loin le pays le plus vulnérable dans la crise. Le petit État se situe très près de l’île de Lampedusa et compte une population d’un demi-million de personnes. A cause de sa localisation, sa zone de patrouilles de recherche et de sauvetage en mer est disproportionnée par rapport à sa taille, ce qui est un héritage des 150 ans passés en tant que dépendance britannique. Même l’arrivée de quelques centaines de migrants par semaine pouvait potentiellement ruiner la plus grande industrie du pays : le tourisme. Ce n’est cependant jamais arrivé, malgré le fait que les flux de migrants irréguliers les plus importants qui ont jamais traversé la Méditerranée centrale soient passés pendant plus de trois ans juste au large de Malte. Aucun des deux pays ne le confirmera, mais un partage informel des missions de recherche et de sauvetage en mer existait clairement entre Malte et l’Italie, au moins à partir du lancement de l’opération Mare Nostrum. Malte était historiquement hostile à ce que l’Italie patrouille dans sa zone de recherche et de sauvetage pour des raisons de souveraineté. Cette position intransigeante s’est relâchée quand il a été convenu que les personnes secourues seraient transportées vers les ports italiens. Il est très difficile de voir comment l’Italie a bénéficié de cet accord informel. Des rumeurs évoquent un échange de bons procédés sur les droits de prospection de ressources énergétiques dans la zone de recherche et de sauvetage en mer, mais elles n’ont jamais été étayées. Il est aussi tout à fait possible que l’accord supposé ait simplement reconnu l’évidence : Malte ne pouvait pas durablement accepter le moindre débarquement sur ses côtes.
Le premier ministre Joseph Muscat et Marlene Bonnici, l’ambassadrice auprès de l’Union, tenace et appréciée, se sont assurés que le pays joue un rôle important dans l’élaboration de la réponse de l’Union à la crise. Muscat contribua à l’organisation d’un sommet exceptionnel avec l’Union africaine en novembre 2015 dans le but de lancer un nouveau partenariat multilatéral avec les Africains sur les migrations et le développement, y compris sur le sujet délicat du renvoi des migrants en situation irrégulière dans leur pays d’origine. Largement influencée par Pierre Vimont, ancien chef des services diplomatiques de la France et de l’Union nommé par Tusk pour mener les négociations, la déclaration de La Valette et le plan d’action qui ont résulté de ce sommet ont été sous-estimés. Cette déclaration reste pourtant le seul accord interrégional de son genre sur les migrations et a conduit de façon décisive à la mise en place d’un fonds d’aide d’urgence d’un milliard d’euros pour l’Afrique, une innovation cruciale qui a permis à l’Union d’intensifier sa coopération dans des domaines clés avec les administrations africaines pendant les deux années suivantes.
Début 2017, Bonnici présida à la fois le comité de coordination de crise de l’Union, connu sous le nom de dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (Integrated Political Crisis Response mechanism), et le Comité des représentants permanents (Coreper), l’organe de décision le plus important du Conseil au niveau diplomatique. Malte accueillit également le sommet européen en février 2017 au cours duquel les mesures opérationnelles pour arrêter les flux en Méditerranée centrale ont été décidées. En somme, le pays s’est abrité sous l’aile de son plus grand voisin pour se protéger et protéger son économie, tout en tirant le maximum de son adhésion à l’Union tout au long de la crise.
En somme, le pays s’est abrité sous l’aile de son plus grand voisin pour se protéger et protéger son économie, tout en tirant le maximum de son adhésion à l’Union tout au long de la crise.
Hugo Brady
Qu’ils approuvent ou non la relocalisation, les petits pays comprenaient son importance centrale. S’ils n’étaient pas directement concernés par les flux, il y avait peu de chance de créer des facteurs d’attraction en y participant. Mais d’un autre côté, s’ils n’y participaient pas, ils risquaient de s’attirer les foudres éternelles de l’establishment bruxellois et des États qui en partageaient le point de vue : l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et d’autres, qui s’étaient fortement investis, tant sur le plan politique que sur le plan émotionnel, pour trouver une « solution européenne » reposant sur le partage des charges et prenant des allures de catharsis. Les petits pays étaient éligibles à des quotas relativement faibles, établis selon le critère de la clé de répartition, même si les règles internationales en matière de regroupement familial signifiaient qu’accepter une personne revenait en réalité à en accepter cinq ou six. Il était tout de même logique pour eux de jouer le jeu. C’est ce qui explique que la plupart ait suivi le train. (Walt 1987).
Les États baltes adoptèrent aussi cette position, malgré leur opposition à la relocalisation aussi nette que celle des pays du V4. Dalia Grybauskaite, la formidable présidente de la Lituanie, fit crier Matteo Renzi au Conseil de juin 2015 lorsqu’elle affirma franchement que son pays se montrerait solidaire des autres, « mais pas avec un pistolet sur la tempe ». En d’autres termes, la solidarité demandée sous la menace d’un isolement politique était une forme de coercition à peine déguisée. Grybauskaite exprimait tout haut le malaise de beaucoup de pays présents dans la salle à l’égard de la direction troublante que semblait prendre la politique européenne. Cette orientation de la politique européenne jouait en particulier sur les insécurités des pays d’Europe centrale et de l’Est, qui doutaient encore d’être vraiment considérés comme des égaux à la table européenne (beaucoup de rumeurs sont largement répandues en Europe de l’Est, comme par exemple celle que malgré l’harmonisation européenne et le marché unique, les États membres d’Europe de l’Ouest envoient à l’est des versions inférieures de biens de consommation et de produits comme le Nutella). Maintenant, les Européens de l’Est voyaient que la Commission et les États membres plus anciens tenaient pour acquise leur acceptation de la relocalisation.
Cependant, plutôt que de jouer la carte de la souveraineté comme l’ont fait les pays du V4, et en sachant bien que les migrants relocalisés chez eux ne resteraient jamais, les trois États baltes accueillirent plusieurs centaines de demandeurs d’asile et s’assurèrent, malgré l’opposition de leurs propres électeurs, que les migrants soient bien traités. Lorsque les nouveaux arrivants partirent, leurs hôtes étaient irréprochables. Face à la menace quotidienne d’une Russie revancharde qui avait annexé la Crimée l’année précédente, les pays baltes ne pouvaient tout simplement pas se permettre de tomber en disgrâce aux yeux d’un establishment européen dont ils pourraient eux-mêmes avoir besoin de toute urgence. Il faut cependant noter que la relocalisation a poussé la politique estonienne vers les extrêmes avec l’entrée du parti d’extrême droite EKRE dans un gouvernement de coalition en 2019, en grande partie du fait de la question migratoire.
Le Danemark représente un cas à part, où l’immigration reste l’un des principaux problèmes politiques après plus d’une décennie. Du fait de leur position constitutionnelle particulière au sein de l’Union, les Danois ont pu déroger discrètement à la relocalisation (comme l’a fait la Grande-Bretagne dans le cadre d’un arrangement similaire) sans préjudice pour leur réputation. A la différence de son voisin la Suède qui recevait proportionnellement encore plus de migrants que l’Allemagne, le Danemark – bien qu’il ait accordé l’asile temporaire à 30 000 Syriens depuis le début de la guerre – découragea les arrivées supplémentaire en menant une politique rigoureuse, qui comprenait la confiscation des biens des demandeurs d’asile pour payer le traitement de leur demande et leur entretien. Une fois de plus, les Danois n’ont jamais vraiment fait l’objet de critiques de la part des États les plus importants de l’Union ou de la Commission européenne pour leur conduite. Comme d’autres États nordiques, tels que la Norvège ou l’Islande, le Danemark a participé aux missions de recherche et de sauvetage en mer Méditerranée menées sous pavillon européen et aux opérations de filtrage dans les îles grecques. C’était le prix minimum à payer pour gagner la respectabilité dans la crise. En d’autres termes, le Danemark s’est caché.
L’Irlande et Chypre sont deux autres exemples dans lesquels la recherche d’un abri stratégique est entrée en jeu. Comme tous les États insulaires, l’Irlande était traditionnellement méfiante à l’égard de la relocalisation des réfugiés. Mais le gouvernement irlandais a compris de plus en plus que le soutien de l’Allemagne était essentiel pour garantir que l’UE27 ferait de la question de la frontière avec l’Irlande du Nord une de ses lignes rouges dans les négociations sur le Brexit. Par conséquent, le pays dépassa allègrement son quota de 600 personnes établi suivant les règles de la clé de répartition. Chypre coopéra également, bien qu’avec moins d’enthousiasme, en raison de son besoin d’une solidarité totale de l’Union dans son conflit territorial avec la Turquie. Puis, les intérêts nationaux chypriotes se sont trouvés étrangement emmêlés dans les manœuvres diplomatiques pour obtenir la Déclaration EU-Turquie. La Turquie demanda malicieusement l’ouverture des dossiers de sa procédure d’adhésion à l’Union qui étaient précisément bloqués par Chypre à cause de leur différend territorial à propos du nord de l’île. Le président Nicos Anastasiades prit soin d’obtenir au préalable la garantie que l’accord ne ferait pas de concessions sur les intérêts fondamentaux de Chypre et déclara juste avant l’important sommet entre l’Union et la Turquie de mars 2016 : « Nous disons oui à l’Europe, et non à la Turquie ». L’astuce fonctionna. La procédure d’adhésion turque n’avancerait pas de toute façon pour d’autres raisons.
Le Luxembourg est probablement le petit État le plus influent d’Europe (et peut-être du monde) et sur le plan idéologique, il est aussi pro-migrants que les pays du V4 sont anti. Exemple rare d’une nation apparemment composée de libéraux de classe moyenne, les Luxembourgeois voyaient une équivalence parfaite entre idéaux progressistes, ouverture à l’immigration et européisme. La déportation, la détention, la construction de clôtures et de camps de retenue, tout cela sortait des chapitres les plus sombres de l’histoire de l’Europe et rappelait l’inhumanité en opposition de laquelle l’Union avait été créée. Si l’Europe ne restait pas manifestement fidèle à la bonne voie, si des gens comme Orban ou Kaczynski commençaient à remporter les grands débats, alors l’intégration européenne pourrait très bien revenir en arrière. Le Luxembourg soutenait la Sondermoral allemande à 1000%.
La déportation, la détention, la construction de clôtures et de camps de retenue, tout cela sortait des chapitres les plus sombres de l’histoire de l’Europe et rappelait l’inhumanité en opposition de laquelle l’Union avait été créée. Si l’Europe ne restait pas manifestement fidèle à la bonne voie, si des gens comme Orban ou Kaczynski commençaient à remporter les grands débats, alors l’intégration européenne pourrait très bien revenir en arrière.
Hugo Brady
Pour le Luxembourg, il était aussi essentiel pour les intérêts nationaux de défendre la « méthode communautaire », dans laquelle un pays ne peut pas opposer son veto à la volonté de la majorité et où la Commission et le Parlement européen ont un rôle à jouer dans la prise de décision. De plus, les pays du V4 bloquaient l’adoption d’une mesure communautaire non seulement pour des motifs de souveraineté, mais aussi d’identité : ils ne voulaient tout simplement pas admettre chez eux des migrants qui étaient en majorité des hommes musulmans du Moyen-Orient. Pour les Luxembourgeois, cette position était ethno-nationaliste, et donc anti-européenne. Bien que le Luxembourg n’ait pratiquement pas de population musulmane, Jean Asselborn, ministre des affaires étrangères pendant longtemps, était déterminé à affronter et à montrer l’exemple à l’égard du V4. Pendant ce temps, les Hongrois et les Polonais s’abaissaient à manier une rhétorique hideuse sur la santé, la culture et la religion des migrants et à opposer systématiquement leur veto aux mesures de politique étrangère européenne. Orban, en particulier, aimait parler de la menace apparente que les migrants musulmans représentaient pour la culture judéo-chrétienne de l’Europe, ce à quoi Tusk répliquait : « Pour un chrétien, la race, la religion et la nationalité d’une personne dans le besoin ne comptent pas » 37 .
En vertu de sa perception de soi comme la quintessence de la « bonne » Union et puisque le Luxembourg n’était pas un pays attractif pour les migrants, le pays pouvait faire et dire à peu près ce qu’il voulait sans craindre de reproche et sans créer de facteurs d’attraction. Par conséquent, le Luxembourg fit tout le contraire de se cacher. Il mena la voie, fixa l’ordre du jour, chercha la confrontation, prit des positions de leadership et les soutint par des gestes forts toutes les fois qu’il en eut l’occasion. La raison pour laquelle il pouvait faire tout cela avec une telle impertinence est que le pays se sentait propriétaire d’un abri qu’il avait contribué à construire des décennies auparavant : l’Union européenne elle-même. Schengen, après tout, était le nom d’une petite ville sur les bords de la Moselle. De plus, Jean-Claude Juncker – un homme irascible, indiscipliné et sentimental aux principes politiques « presque franciscains » – avait été le premier ministre du Luxembourg pro-intégrationniste pendant près de 20 ans avant la crise 38 . Cela est crucial pour comprendre le point de vue adopté par la réponse rapide de l’Union, dans laquelle la proposition principale de la Commission était une proposition humanitaire qui servait également les ambitions intégrationnistes.
Conclusion
Les arrivées irrégulières par la mer de deux millions de migrants en provenance du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie du Sud en Europe n’étaient pas son « 11 Septembre ». Sans être non plus une perte d’innocence, le meilleur parallèle qui peut être fait est celui avec l’ouragan Katrina. En 2005, cette catastrophe naturelle a ravagé la côte du Golfe et plongé la Nouvelle-Orléans et les régions du sud-est des États-Unis dans un chaos terrifiant. Les Américains et le monde extérieur s’efforçaient de comprendre comment une superpuissance nucléaire pouvait être incapable de gérer une crise humanitaire à l’intérieur de ses propres frontières. Pour la plupart des Européens, les chocs de 2015 et de 2016 étaient tout aussi déboussolants. Ils attendaient non seulement que l’Union contrôle rapidement les flux, mais peut-être aussi qu’elle intervienne pour arrêter la guerre en Syrie même, afin que les réfugiés puissent rentrer chez eux. Désormais, ils se réveillaient devant l’impuissance de l’Europe à influencer le monde de plus en plus instable qui l’entoure. Ils regardaient l’Union et, comme l’opinion publique américaine en 2005, étaient déconcertés par son impuissance flagrante, son incapacité à appréhender les luttes idéologiques en son sein, la distinction juridique entre réfugiés et migrants économiques appauvris ou les limites de la coopération internationale en l’absence d’unité politique. Le fait que des missions en mer battant le pavillon européen aient contribué à sauver plus d’un demi-million de vies humaines au cours de cette situation d’urgence – un exploit sans précédent dans l’histoire mondiale – semblait ne compter pour rien.
Malgré toute l’énergie politique consacrée à la relocalisation, les seules mesures qui s’étaient montrées décisives dans la crise étaient des mesures extérieures : le travail avec les pays de départ et de transit pour empêcher en amont les départs de bateaux, puis le soutien des efforts de stabilisation des populations déplacées à travers l’action humanitaire et l’aide au développement. Les missions de diplomatie migratoire les plus sensibles étaient mieux gérées par les États membres de première ligne eux-mêmes, comme l’Italie avec la Libye en 2017, ou plus tard comme l’Espagne avec son voisin marocain après une forte augmentation du nombre d’arrivées irrégulières sur les routes de la Méditerranée occidentale et de l’Atlantique en 2018. L’Union agissait en tant que partenaire financier et gestionnaire de ces accords en apportant des aides, des programmes de renforcement des capacités et un soutien diplomatique. La Grèce était l’exception. Son administration hésitante et chaotique et sa méfiance viscérale à l’égard de la Turquie, qui s’est finalement révélée être un partenaire plus fiable que la Grèce au cours de cette phase de la crise, ont tout simplement obligé l’Union à prendre la relève. Finalement, Berlin a négocié pour Athènes, puisque l’Allemagne était le vrai pays de première ligne et avait le plus à perdre en cas de mauvais résultats. Encore aujourd’hui, les autorités allemandes peinent à renvoyer chez eux plus de 50 000 faux demandeurs d’asile arrivés avec la cohorte des migrants.
Comme la crise de la zone euro dans les années 2010-2013, la crise des frontières de 2015-2017 a révélé aux pays de l’Union leur interdépendance en matière de contrôle des frontières et de politique d’asile. Mais cette révélation n’a pas été un facteur d’unification, parce que ses implications remettent en cause les perceptions fondamentales de nombreux pays. L’Italie et la Grèce ne pouvaient plus être des pays de transit ; les pays d’Europe centrale et de l’Est ne pouvaient plus prendre l’Union pour une vache à lait sans contrepartie ; l’Allemagne et la Suède ne pouvaient plus se montrer aussi généreuses envers les demandeurs d’asile ; la Commission ne pouvait plus s’accrocher à son image d’agence d’aide internationale plutôt que de gardienne de la frontière extérieure de l’espace Schengen. Et ainsi de suite.
Comme la crise de la zone euro dans les années 2010-2013, la crise des frontières de 2015-2017 a révélé aux pays de l’Union leur interdépendance en matière de contrôle des frontières et de politique d’asile. Mais cette révélation n’a pas été un facteur d’unification, parce que ses implications remettent en cause les perceptions fondamentales de nombreux pays.
Hugo Brady
L’absence d’accord sur une réponse décisive au cours des premiers mois ainsi que la façon dont la crise a été instrumentalisée sur le plan idéologique par les extrémistes des deux côtés ont laissé un héritage d’amertume, de divisions régionales fraîchement ravivées et de blocages de la politique interne. Même si les pays du V4 peuvent être critiqués pour leur étroitesse d’esprit et pour leur obstination, une des raisons de l’échec de la conspiration de l’espoir pour mettre en place la relocalisation est que les têtes pensantes de ce projet n’ont jamais pris la peine d’évaluer les perspectives historiques des Européens de l’Est ou leurs espoirs encore fragiles quant à leur propre avenir au sein de l’Union. S’ils ne se voyaient même pas accorder cela, pourquoi alors deviendraient-ils des « preneurs d’ordre » permanents des décisions de l’Allemagne en matière de demandes d’asile ? D’un autre côté, la conspiration pouvait faire preuve elle aussi de la même étroitesse d’esprit, à sa manière, en ne daignant jamais répondre aux questions flagrantes qui entouraient la relocalisation, malgré les preuves manifestes qu’il s’agissait d’une politique inefficace, ou en refusant d’ouvrir les yeux sur la réalité plus laide des aspects humains et du chaos des flux incontrôlés.
Les pays du centre et de l’Est de l’Europe, qui connaissent une croissance rapide, deviendront un jour à leur tour des pays d’immigration, de leur propre chef et à leur manière – dans les faits, cela se passe déjà discrètement 39 . Mais en forçant la question de façon prématurée et en politisant la question au niveau national, les colombes ont tragiquement repoussé ce jour dans un futur encore plus lointain en ce qui concerne les réfugiés. Ironiquement, l’Italie en particulier n’a jamais vraiment été en faveur de la relocalisation dès le départ à cause de la charge que représentent les procédures aux frontières qui y sont attachées.
Finalement, les faucons intégrationnistes ont gagné, mais de justesse. L’urgence à la frontière a permis à l’Union de renouer progressivement avec le réalisme politique par rapport aux arrivées maritimes spontanées, ce qui est de plus en plus visible dans les nouvelles propositions de la Commission européenne en matière de politique des frontières, de politique d’asile, de politique des visas, de politique et développement et de politique étrangère (cela se reflète également dans l’approche très contrastée du contrôle aux frontières de l’actuel gouvernement grec de centre-droit mené par Kyriakos Mitsotakis). Alors qu’on jugeait cela impossible, l’Union a également franchi plusieurs Rubicons pendant que la crise faisait rage, notamment en instituant des garde-frontières européens dotés de pouvoirs exécutifs en 2019.
Par-dessus tout, l’épisode sert de mise en garde et de rappel du prix élevé à payer en politique lorsqu’on se livre à un bref moment d’euphorie ou lorsqu’on cède prématurément aux conseils du désespoir. Un gouvernement ne doit jamais envoyer un signal d’impuissance politique à la population, surtout sur des questions qui suscitent autant d’émotion et qui sont aussi complexes que les migrations mixtes, où beaucoup peuvent détourner les choses en faveur de leurs propres intérêts ; et surtout lorsqu’il y a en fait d’autres solutions sur la table. Faire cela, ce serait risquer l’avenir de la démocratie libérale elle-même. Même dans l’éthique de la conviction, il y a beaucoup d’ambiguïté morale. Le cœur y trouve satisfaction, mais la tête continue d’insister : « oui, mais que faire ensuite ? ».
Notes
- Ce récit est par nature subjectif étant donné que l’auteur a participé aux événements décrits. L’intention est de donner au lecteur une idée réelle de ce qui se passait dans l’esprit des principaux acteurs, de ce qui s’est passé sur le terrain et de ce qui était en jeu. Les opinions exprimées sont uniquement celles de l’auteur et non celles de toute autre personne, groupe ou organisation.
- Ivan Krastev, Le destin de l’Europe: une sensation de déjà vu, Paris, France, Premier Parallèle, 2017, p.13.
- La Convention de Genève (1951) et le protocole qui en découle définissent la notion de réfugié (une personne craignant « avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques »). Ils définissent aussi les droits des réfugiés dans les États d’accueil tandis que la législation européenne précise ce qu’ils signifient en pratique pour les administrations et crée également deux catégories de protection moins importantes : le statut temporaire et le statut subsidiaire.
- La Convention de Dublin, adoptée au début des années 1990, a été intégrée au droit européen ordinaire en 2003 parallèlement à quatre autres directives complémentaires instaurant des normes minimales pour le traitement des demandeurs d’asile et une base de données européenne des inscriptions. La Suisse, la Norvège et l’Islande appliquent également la Convention de Dublin.
- La meilleure façon de créer un système d’asile européen passe par l’harmonisation des aides sociales et économiques accordées aux demandeurs d’asiles à travers l’Union. Mais cela reste utopique, notamment au vu des disparités de richesses dans l’Union.
- Les pays du Nord de l’Europe abritent l’écrasante majorité des demandeurs d’asiles du continent et sont les plus généreux en termes d’aide financière. La Convention de Dublin et les protocoles frontaliers communs suggèrent simplement que les pays au Sud doivent eux aussi jouer leur rôle et non pas agir comme de simples pays de transit.
- De nombreux commentaires visent l’apparente injustice de la règle du premier pays d’arrivée. En réalité, le règlement de Dublin est complexe et flexible : les hôtes secondaires peuvent décider, et décident souvent, de prendre en charge des cas d’asile quel que soit le pays d’entrée. De même, les pays de première ligne peuvent envoyer les demandeurs d’asile au nord pour y traiter leurs demandes si, par exemple, ils ont déjà un membre de leur famille dans un autre État membre. Ces demandes sont appelées « demandes de prise en charge ».
- Avant l’arrêt Hirsi, les migrants illégaux trouvés dans les eaux territoriales européennes pouvaient accéder à la procédure d’asile.
- Au moment de l’écriture de cette note, l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la France, la Norvège et la Suède, ont tous maintenu des contrôles aux frontières intérieures depuis fin 2015.
- Ermias Ghermay, un passeur éthiopien, fait l’objet de sanctions de l’ONU et est toujours recherché par les autorités italiennes pour le naufrage du 3 octobre 2013 à Lampedusa.
- Frontex, l’agence européenne de garde-frontières et garde-côtes, organise des missions frontalières conjointes sur le territoire d’un État membre à sa demande. En 2015, elle n’avait pas de mandat explicite pour mener des missions SAR dans les eaux internationales.
- Le Conseil européen a bien discuté des « flux migratoires » en décembre 2013 à la suite de la catastrophe de Lampedusa, mais la discussion n’a pas été houleuse. En outre, très peu de ministres de l’intérieur dirigent leur pays par la suite, ce qui a exacerbé le manque de connaissances des dirigeants lorsque la crise a éclaté.
- Luuk van Middelaar, Quand l’Europe improvise: dix ans de crises politiques, Paris, France, Gallimard, 2018, p. 91-114.
- Article 17 du règlement de Dublin.
- En réponse, M. Tusk déclara que le plan de M. Juncker signifiait seulement que les migrants passeraient désormais par les portes et les fenêtres.
- Expression que le prédécesseur de Juncker, José Manuel Barosso, se plaisait à répéter pendant la crise de la zone euro.
- Voir le discours sur l’état de l’Union du président Juncker au Parlement Européen en 2016.
- Brunnermeier Markus K., James Harold et Landau Jean-Pierre, The euro and the battle of ideas, Princeton, États-Unis d’Amérique, Princeton University Press, 2016.
- Voir le discours de Juncker au Parlement Européen le 27 Octobre 2015.
- En 2021, ce nombre a atteint 3,6 million : Betts Alexander et Collier Paul, Refuge: rethinking refugee policy in a changing world, Etats-Unis d’Amérique, 2017, p. 76-86.
- La Turquie est signataire de la convention de 1951 sur les réfugiés, qui était initialement destinée à accueillir les Européens déplacés par la Seconde Guerre mondiale. Mais la Turquie n’a pas adhéré à l’élargissement ultérieur de la convention pour couvrir tous les réfugiés du monde. Par conséquent, bien que très généreux à l’égard des réfugiés, le gouvernement turc se réserve le droit de le faire selon ses propres conditions, et non celles de la convention.
- Cet article utilise des citations de fonctionnaires qui étaient omniprésentes à l’époque ou que l’auteur a entendues de première main. À quelques exceptions près, la plupart sont délibérément gardées anonymes.
- Ils ont également offert aux citoyens turcs un accès sans visa à l’espace Schengen d’ici la fin 2016. Il s’agissait d’une promesse téméraire. La Turquie est un pays sûr mais loin d’être stable, avec une importante minorité kurde qui pourrait être tentée d’abuser d’un tel accès à l’Europe.
- La Turquie a mis fin aux déplacements sans visa vers la Libye en août 2015.
- « Peu importe que ce soit un chat noir ou un chat blanc. S’il attrape des souris, c’est un bon chat. »
- Donald Tusk, Der Spiegel, 22 avril 2016.
- Du nom de la ville de Visegrad en Hongrie, le groupement V4 est composé de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque et de la Slovaquie. Il a été fondé par Lech Wałęsa, Josef Antall et Václav Havel en 1991 pour être le « Benelux » de l’Europe centrale. Les quatre pays se relaient chaque année pour présider et coordonner leurs positions sur les questions européennes, afin de maximiser leur poids politique.
- Ce groupe aurait dû inclure le Royaume-Uni, mais le pays a été complètement accaparé par les événements qui ont précédé et suivi sa décision de juin 2016 de quitter l’Union.
- Ce chiffre doit être pris avec précaution car il concerne à la fois les réfugiés qui traversent les frontières internationales et ceux (plus nombreux) qui migrent au sein de leur pays.
- Luuk van Middelaar, Quand l’Europe improvise: dix ans de crises politiques, ibid, p. 100.
- Il s’agit de la position initiale de la Commission ; le chiffre final devrait plutôt se situer autour de cinq ans.
- Lors d’une réunion clé des sherpas de l’UE sur la réforme de Dublin en décembre 2018, les Tchèques ont fait cette analogie avec la zone euro, affirmant qu’il ne pouvait y avoir de « partage des risques » au sein de Schengen sans « réduction des risques » à la frontière extérieure.
- Reconnaissants envers une Turquie qui a largement respecté sa part du marché, les Européens sont tout de même allés de l’avant et ont discrètement réinstallé plus de 23 000 Syriens en Europe depuis la Turquie depuis 2019.
- L’exemple par excellence est celui du Conseil Européen pour les Réfugiés et Exilés (CERE).
- L’une des principales raisons en est que la Commission était très dépendante de ces organismes pour l’exécution de ses politiques. Le HCR, l’OIM et la Croix-Rouge internationale possédaient une expérience, des réseaux, des mandats et une main-d’œuvre dont les agences de l’Union étaient dépourvues. Sans eux, il était impossible d’agir dans les Balkans, en Grèce, en Turquie ou en Libye.
- Le HCR et l’OIM craignaient que les États-Unis de Trump ne se retirent, une issue catastrophique pour eux, mais ils savaient que l’Union ne le ferait jamais. La véhémence particulière à l’égard de l’Europe s’explique également par le fait que ces organisations sont souvent dirigées par des Européens qui attendent beaucoup de leurs propres structures.
- Voir les remarques du président Donald Tusk avant sa rencontre avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, le 3 septembre 2015. Pour montrer sa désapprobation de la rhétorique et du factionnalisme d’Orbán, Tusk a également inclus une déclaration rare soutenant la relocalisation volontaire de 100 000 réfugiés.
- Voir Luuk van Middelaar, Quand l’Europe improvise: dix ans de crises politiques, ibid, chap. 3.
- À l’heure de l’écriture de ce document, la Pologne et la Hongrie se sont distinguées en délivrant un grand nombre de permis de travail à des ressortissants étrangers en 2018 et 2019 pour alimenter leurs économies à croissance rapide. Les membres de l’est de l’Union connaissent une forte augmentation des demandes d’asile en provenance d’Ukraine.
citer l'article
Hugo Brady, Ouverture contre impuissance : la crise frontalière européenne de 2015-2017, Groupe d'études géopolitiques, Juin 2021,




