Réparer un monde cassé : un nouveau consensus pour la finance globale
21/06/2023
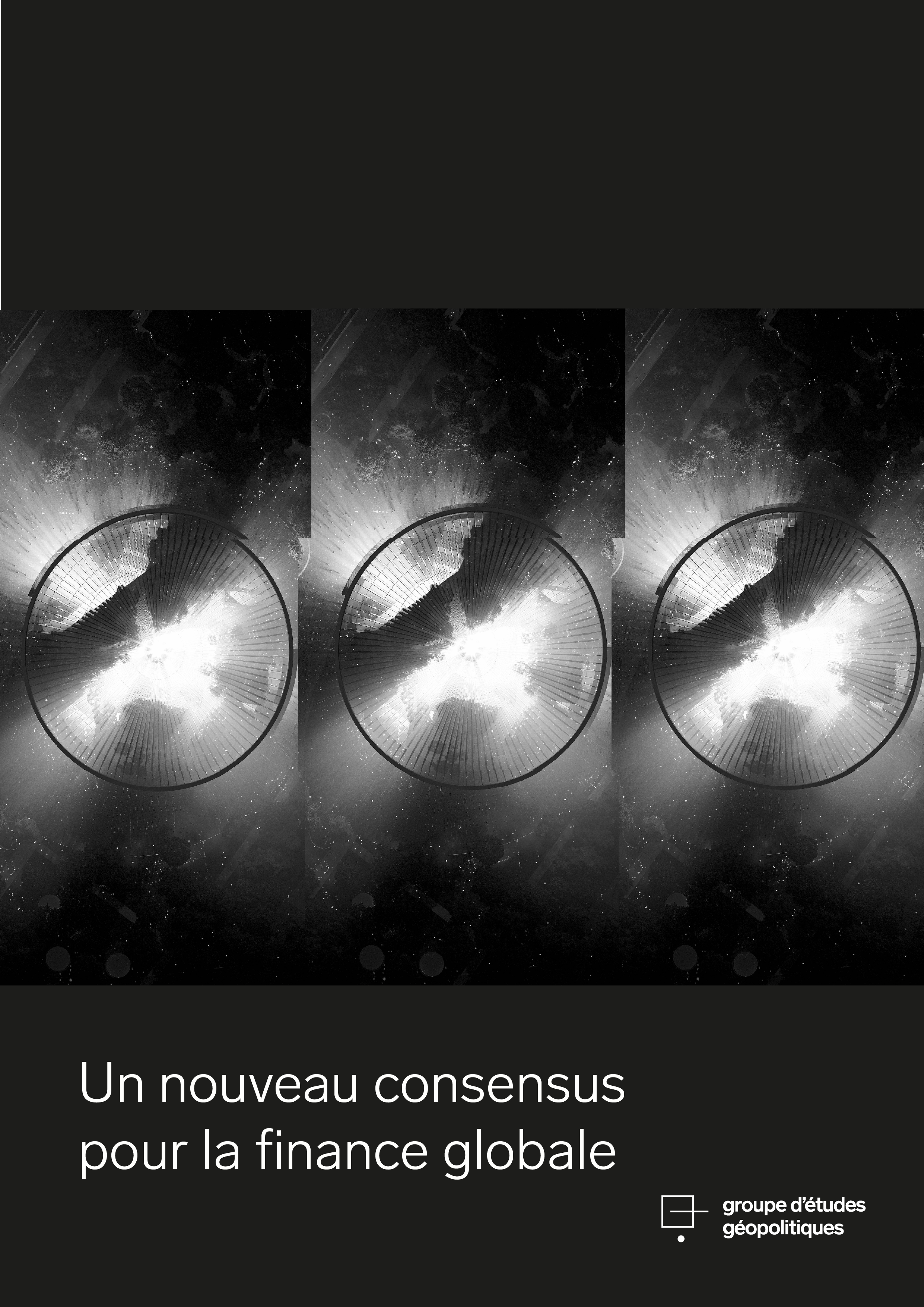
21/06/2023
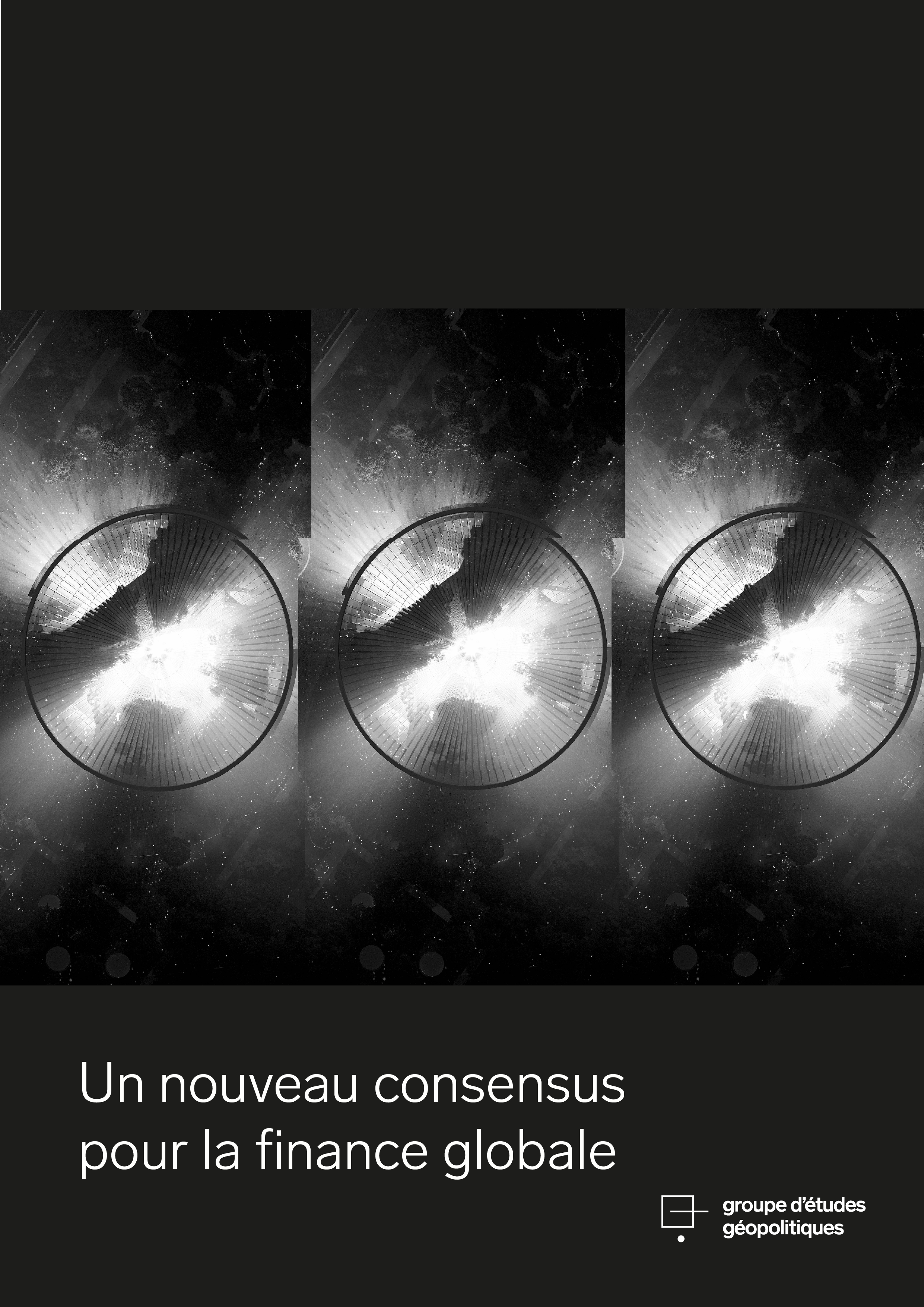
 Voir tous les articles
Voir tous les articles
Réparer un monde cassé : un nouveau consensus pour la finance globale
Les crises imbriquées de la dette, du climat, de l’énergie et de l’instabilité financière resserrent leur emprise sur le monde. Ce n’est pas au moment où celles-ci culminent en cataclysmes qu’il faut dissimuler leur injustice.
L’été dernier, des inondations dévastatrices au Pakistan ont fait des milliers de victimes et bouleversé la vie de 33 millions de personnes. Cette catastrophe n’était pas «naturelle» : elle a été amplifiée par des décennies d’extraction de combustibles fossiles, bien au-delà du fleuve Indus 1 . Comme l’a clairement indiqué le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, c’était aussi la conséquence d’un «système financier mondial moralement en faillite», d’un cycle de la dette qui consacre plus d’argent aux créanciers qu’à des sociétés sûres et stables 2 .
Les souffrances du Pakistan relèvent d’une responsabilité commune. Si nous n’agissons pas, la catastrophe sera générale alors même qu’elle était prévisible. Le dernier rapport du GIEC indique que 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent actuellement dans des zones «très vulnérables» aux effets des phénomènes extrêmes, soit près de la moitié de la population mondiale 3 . Notre architecture financière n’est pas adaptée à ces défis. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, il faudrait tripler les investissements dans les énergies propres à l’échelle mondiale pour atteindre 4 000 milliards de dollars par an d’ici à 2030 4 .
Les souffrances du Pakistan relèvent d’une responsabilité commune. Si nous n’agissons pas, la catastrophe sera générale alors même qu’elle était prévisible.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
Ce financement pourrait ouvrir la voie à un système énergétique propre qui nous placerait sur une trajectoire plus sûre, mais il ne prend pas en compte les coûts des chocs climatiques déjà en cours. Ce montant de mille milliards de dollars ne prend pas non plus la mesure de la situation géopolitique : outre les «actifs irrécupérables», nous commençons à peine à ajouter dans la balance le pouvoir démesuré des «État pétroliers irrécupérables» 5 , ainsi que l’intention de la Russie de renforcer sa position de grand exportateur de combustibles fossiles en utilisant les chaînes d’approvisionnement en énergie et en matières premières comme arme. Cette situation a encouragé l’OPEP à adopter une position plus provocante vis-à-vis des États-Unis — et, par conséquent, des principes fondamentaux d’un système mondial basé sur le dollar — à commencer par le rôle de la monnaie sur les marchés de l’énergie 6 .
Le défi historique auquel nous sommes confrontés consiste à éliminer notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles et à faire face aux menaces qu’ils ont créées — à la fois sur le plan climatique et géopolitique. Le problème ne réside pas uniquement dans l’élaboration de scénarios. Dans notre régime de gouvernance mondiale, l’évaluation des coûts et l’identification des sources de financement sont des activités nébuleuses — et tout à fait distinctes. Chiffrer la solution pose une autre question centrale en macroéconomie : quel sera le coût de cet argent ?
C’est pourquoi la dette apparaît comme l’indicateur le plus alarmant de notre incapacité collective à nous mobiliser et à réagir, et souligne l’injustice que subissent les populations locales. Nous permettons à l’architecture financière internationale de donner la priorité à une stabilisation macrofinancière limitée et profondément inégale, au détriment des piliers de la sécurité humaine tels que la santé, l’éducation, l’énergie propre et les infrastructures résilientes au changement climatique.
La dette accablante du Pakistan l’a récemment conduit à conclure son 23e accord avec le FMI — et son 14e sauvetage —, un triste record qui n’est dépassé que par l’Argentine. Ce scénario du piège de la dette devrait être de plus en plus répandu, les données du FMI plaçant 53 pays, représentant une personne sur cinq dans le monde, sur la voie du surendettement
7
. Là encore, la situation critique du Pakistan préfigure une tendance mondiale. Alors que le cinquième pays le plus peuplé du monde s’efforce — tout comme les programmes de redressement qui lui sont imposés, encore et encore, par la Banque mondiale et le FMI — de relever le triple défi de la viabilité de la dette, des impacts climatiques et de la transition énergétique
8
, ses progrès en matière de lutte contre la pauvreté piétinent également : si l’on tient compte de la croissance démographique, le Pakistan compte aujourd’hui 3 millions de pauvres de plus qu’en 2018
9
.
Dans notre régime de gouvernance mondiale, l’évaluation des coûts et l’identification des sources de financement sont des activités nébuleuses — et tout à fait distinctes. Chiffrer la solution pose une autre question centrale en macroéconomie : quel sera le coût de cet argent ?
Laurence Tubiana et Elliott Fox
Le monde est également à la traîne dans la réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté et des objectifs de développement durable. Il s’efforce de mobiliser des fonds pour l’aide 10 , tout en émettant plus de CO2 l’année dernière que n’importe quelle autre année dans l’histoire de l’humanité 11 .
Les propositions techniques avancées pour ajuster notre architecture financière internationale ne manquent pas : ce texte n’entend pas rivaliser avec elles. Il s’agit plutôt de proposer quelques réflexions sur le chemin parcouru, les angles morts qu’elles révèlent et quelques pistes prometteuses pour l’avenir, ancrées dans l’Accord de Paris.
Tout d’abord, nous examinerons comment notre système financier international a enraciné son fonctionnement dans l’émission de dette, l’hégémonie du dollar et la dépendance aux combustibles fossiles, pesant sur la stabilité financière mondiale et constituant un obstacle fondamental à l’action climatique. Ensuite, nous étudierons l’évolution de la reconnaissance du changement climatique en tant que risque économique et financier majeur au cours des trois dernières décennies, ce qui a conduit à la définition d’objectifs climatiques concrets et a façonné l’économie politique mondiale. Après quoi nous discuterons des défis que posent les économies parallèles, telles que les efforts de dédollarisation de la Chine, et de l’impact des changements de politique des États-Unis sur le système multilatéral. Enfin, nous envisagerons des solutions potentielles, notamment l’exploration de nouvelles sources de financement et la promotion d’un système financier aligné sur l’Accord de Paris en vue de la COP30, qui se tiendra au Brésil en 2025.
Nous vivons une période de tensions profondes, et la «polycrise» est une période d’inconnues. Pourtant, l’accord de Paris a montré que même dans les moments d’impasse diplomatique apparemment insoluble, tout est possible.
L’accord de Paris a montré que même dans les moments d’impasse diplomatique apparemment insoluble, tout est possible.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
Un «consensus de Washington» ancré dans la dette, les dollars, et l’abondance d’énergies fossiles
Un consensus accidentel ?
L’histoire de ces angles morts est mieux racontée à travers le prisme du «consensus de Washington». En fonction des publics, ce terme est considéré comme une boîte à outils libérale pour la croissance ou un compte rendu critique de l’hégémonie économique des États-Unis. Ces deux interprétations sont déconnectées de l’intention initiale qui trouvait ses origines dans l’histoire de la dette, de l’abondance pétrolière et du dollar de l’après-Seconde Guerre mondiale.
Commençons par souligner que ce que désigne l’expression — lancée par l’économiste britannique John Williamson en 1989 — n’est pas le fruit d’un consensus et qu’elle n’est pas née à Washington. Il n’a jamais imaginé qu’il «inventait un terme qui deviendrait un cri de guerre dans les débats idéologiques pendant plus d’une décennie» 12 . Il cherchait plutôt à empiriquement décrire les réponses économiques que soutenaient le FMI, la Banque mondiale et le Trésor américain pour répondre aux crises de la dette en Amérique latine dans les années 1980. En ce sens, il est plus utile de comprendre la naissance du consensus de Washington comme le résultat d’une «effervescence intellectuelle» en Amérique latine au cours de cette décennie, enracinée dans ces circonstances économiques spécifiques, à savoir un éloignement progressif des principes d’accumulation du capital, des croyances selon lesquelles les défaillances du marché entraveraient la croissance et que les marchés ne «fonctionneraient pas bien» dans ces pays 13 .
En ce sens, il s’agissait d’une réplique à des décennies de théorie de la dépendance, d’arguments en faveur d’un État proactif, doté d’une politique industrielle forte par substitution aux importations, du contrôle des prix et des droits de douane — autant d’éléments qui avaient assuré une croissance robuste dans les années 1960 et 1970 14 .
Dans les années 1980, les chocs pétroliers de 1973 et 1979 et les tentatives de la Réserve fédérale américaine de lutter contre l’inflation en augmentant les taux d’intérêt provoquèrent une onde de choc mondiale parmi les économies endettées en dollars.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
Dans les années 1980, les chocs pétroliers de 1973 et 1979 et les tentatives de la Réserve fédérale américaine de lutter contre l’inflation en augmentant les taux d’intérêt provoquèrent une onde de choc mondiale parmi les économies endettées en dollars, mettant en évidence la «dangereuse accumulation de vulnérabilités intérieures» 15 de l’Amérique latine, notamment la nécessité pour ces pays de recourir à des emprunts élevés pour financer les rentes pétrolières, la substitution des importations et le maintien des niveaux élevés de dépenses publiques. C’est dans ces conditions qu’est né un «solide courant intellectuel et idéologique» en faveur de la liberté des marchés et de la démocratie, ainsi que l’état d’esprit qui a présidé à l’intention initiale de Williamson en 1989, où le Consensus de Washington décrivait dix politiques s’articulant autour de trois grandes idées : «stabiliser, privatiser et libéraliser» 16 .
Les dépendances à la dette, au pétrole et au dollar
Le lien entre les chocs pétroliers et la boîte à outils du système international en matière de crise de la dette souveraine permet d’identifier la dépendance — dans notre économie politique et dans notre système de gouvernance mondiale — à l’égard de trois problèmes fondamentaux qui limitent notre capacité à faire face à la polycrise d’aujourd’hui.
Tout d’abord, l’évolution du système de Bretton Woods vers l’imbrication de la mondialisation du dollar à l’émergence d’un lien pétrole-dollar a contribué à rendre de nombreuses économies très sensibles aux hausses de taux de la Réserve fédérale américaine et à d’autres changements dans la politique économique des États-Unis. Cela rendait ces pays très vulnérables aux hausses des prix de l’énergie et d’autres produits de base. La décision prise à Bretton Woods en 1944 de construire l’architecture financière internationale en utilisant un système basé sur le dollar a commencé à s’effriter après la décision prise en 1971 par l’administration Nixon de suspendre la parité or-dollar en faveur de taux de change flottants. La décision de l’OPEP d’utiliser le dollar comme monnaie de facto pour le commerce du pétrole — alors que l’intensité pétrolière de l’économie mondiale atteignait son apogée 17 — a posé les bases de ce qui a suivi : au début des années 1980, les chocs pétroliers mondiaux ont conduit les pays exportateurs de pétrole à accumuler des dollars américains et à se lancer dans le «recyclage des pétrodollars», en investissant dans des titres américains et en contribuant à la conjonction d’un système fondé sur l’emprunt public, de crises cycliques de la dette et d’un régime de taux de change flottants centré sur le dollar — autant de facteurs qui ont contribué à la décennie perdue de l’Amérique latine.
L’effet de levier exercé par les États-Unis et d’autres grands pays créanciers constitue un deuxième problème. Si le système de Bretton Woods a permis une croissance historique et une réduction de la pauvreté dans plusieurs régions du monde, il a avant tout profité aux économies qui constituent aujourd’hui le Club de Paris, c’est-à-dire des créanciers souverains. Cette logique de dépendance a réduit l’incitation à trouver des cadres plus multilatéraux et plus équitables pour gérer le fardeau de la dette. L’émergence des procédures informelles du Club de Paris dans les années 1950, avant l’explosion de la dette souveraine dans les années 1980, met en évidence les lacunes de la conception institutionnelle de l’architecture financière internationale. La persistance des procédures du Club de Paris après les années 1980, alors que la libéralisation des échanges produisait une croissance historique et l’émergence de nouvelles sources de pouvoir géoéconomique dans les BRICS, a aggravé le problème, et indique que l’opportunisme et l’influence géopolitique sont toujours à l’origine de l’inertie de l’architecture financière internationale, bien que la Chine soit devenue — et de loin — le plus grand créancier bilatéral au cours des deux dernières décennies, avec une approche plus opaque de la diplomatie de la dette.
Si le système de Bretton Woods a permis une croissance historique et une réduction de la pauvreté dans plusieurs régions du monde, il a avant tout profité aux économies qui constituent aujourd’hui le Club de Paris, c’est-à-dire des créanciers souverains.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
Il est révélateur que les procédures ad hoc du Club de Paris aient perduré alors que l’idée d’accords multilatéraux plus formels se faisait de plus en plus pressante — bien que de manière sporadique, et jusqu’à présent sans succès. La persistance du surendettement dans les années 1990 a conduit le FMI et la Banque mondiale à lancer l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) en 1996 et à faire du G20 le principal forum multilatéral pour les questions relatives à la dette, à la suite de la crise financière asiatique de 1998. L’annulation de la dette est devenue une cause célèbre au cours des années 2000, et le lancement par le G8 de l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM) en 2005 a ajouté une nouvelle possibilité de réponse pour soulager les crises aiguës de la dette. Si ces initiatives ont permis d’effacer des centaines de milliards de dettes souveraines, elles n’ont pas résolu le problème de la dette mondiale qui, à l’instar de nos émissions de CO2, continue de battre des records 18 .
Troisièmement, l’incapacité à anticiper l’émergence d’un lien entre la dette et le changement climatique, malgré le rôle central du pétrole en tant que moteur économique mondial et contributeur principal au changement climatique, est un véritable obstacle. La mise en place d’un régime de gouvernance climatique depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui a été — et c’est aussi frappant que révélateur — un processus qui s’est développé alors que la science du climat progressait principalement dans les institutions publiques ainsi que dans les départements de recherche des grandes multinationales pétrolières occidentales, qui ont déployé de puissantes tactiques de désinformation et de retardement, tout en dissimulant leurs résultats.
Conséquence sous-estimée, la lenteur avec laquelle le système international est finalement parvenu à l’accord de Paris en 2015 a contribué à creuser le déficit d’investissement nécessaire pour faire face à la crise, alimentant de profondes tensions autour des questions de financement et de justice climatique. Par exemple, bien qu’ils soient parmi les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique, les petits États insulaires en voie de développement dépensent aujourd’hui près de vingt fois plus pour le service de la dette que pour le financement de la lutte contre le changement climatique 19 .
L’incapacité à anticiper l’émergence d’un lien entre la dette et le changement climatique, malgré le rôle central du pétrole en tant que moteur économique mondial et contributeur principal au changement climatique, est un véritable obstacle.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
Un risque macro-critique dans un monde multipolaire
Du coût de l’action au coût de l’inaction
Le protocole de Kyoto de 1997 a représenté une étape importante dans la lutte contre le changement climatique. Les économistes ont joué un rôle clef dans la conception de ce qui pourrait être un nouvel instrument juridique international centré sur l’idée d’un «budget carbone» mondial, défini par les travaux des modélisateurs du climat synthétisés dans les rapports du GIEC. Sur la base de ces hypothèses, les économistes ont alors suggéré que la meilleure façon de parvenir à une réduction des émissions au niveau mondial était d’établir un prix du carbone et de plafonner les quantités possibles d’émissions.
Le protocole de Kyoto s’est également distingué par le fait qu’il proposait une quantité spécifique d’émissions à réduire. À l’époque, il était question de réductions plutôt modestes, de l’ordre de 8 à 10 % sur huit ans, ce qui est très éloigné des objectifs que nous devons atteindre aujourd’hui.
En 2006, Nicholas Stern et les travaux du rapport Stern 20 ont cherché à remettre en question certaines hypothèses communément admises dans les études sur le changement climatique. Il a notamment remis en cause l’approche coût-bénéfice et le taux d’actualisation utilisés pour évaluer le coût des dommages causés par le changement climatique. Selon Stern, la plupart des travaux économiques de l’époque reposaient à tort sur l’idée que les sociétés seraient plus riches à l’avenir et donc mieux équipées pour gérer les coûts du changement climatique. Cette perspective a dominé le discours économique jusqu’à la crise financière de 2008-2009.
Le point d’inflexion de la crise financière mondiale
Ce contexte permet de mieux comprendre l’échec de la COP15 à Copenhague en 2009, qui a révélé l’une des fractures les plus profondes du système multilatéral : organisée immédiatement après la crise financière mondiale, alors que le pouvoir économique des États-Unis et de l’Occident était profondément ébranlé, on pourrait y voir le moment où les BRICS — et en particulier la Chine — dont la part dans le PIB mondial avait plus que doublé au cours de la décennie précédente, rejetaient le cadre de négociation imposé par la présidence danoise, en particulier toute limite à leur capacité souveraine de décider de leur propre voie pour réduire les émissions. Cela marque le début d’une ère où aucun hégémon ne peut dominer les normes de gouvernance mondiale.
Plus largement, la COP15 peut être interprétée comme un basculement dans l’équilibre des pouvoirs entre le G8 et le G20, et comme la reconnaissance de l’obsolescence du consensus de Washington. Ce n’est pas une coïncidence si la présidence sud-coréenne du G20, en 2010, a ressenti le besoin de lancer un «Consensus de Séoul» (qui n’a jamais vraiment séduit), un mois après avoir également accepté des réformes historiques des quotes-parts et de la gouvernance du FMI pour rééquilibrer les parts et les droits de vote en faveur du Brésil, de la Chine, de l’Inde et de la Russie 21 . En raison du veto effectif du Congrès américain sur les réformes du FMI, celles-ci ne sont entrées en vigueur qu’en 2016.
La COP15 peut être interprétée comme un basculement dans l’équilibre des pouvoirs entre le G8 et le G20, et comme la reconnaissance de l’obsolescence du consensus de Washington.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
L’évolution de l’approche économique de la crise climatique, qui s’est accompagnée d’une meilleure compréhension de la gravité du problème par les institutions et de l’émergence d’une dynamique de pouvoir de plus en plus multipolaire dans les négociations climatiques de la CCNUCC, a consolidé certaines lignes rouges importantes concernant la souveraineté des nations sur leurs trajectoires de décarbonation, tout en retardant la capacité du monde à trouver un accord sur le type de réponse à apporter.
C’est à partir de l’échec de la COP15 que la discussion a commencé à évoluer, pour aboutir à l’Accord de Paris de 2015. Lors de la COP de Copenhague en 2009, les pays du «Nord global» se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars pour le financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en voie de développement, à partir de 2020. Cet engagement, réaffirmé lors de la COP21 à Paris, a permis de passer d’un cadre obligatoire de réduction des émissions (limité aux pays développés, comme le prévoyait l’accord de Kyoto) à un système volontaire, collaboratif et mondial axé sur des stratégies nationales de réduction des émissions, connues sous le nom de contributions déterminées au niveau national (CDN).
L’Accord de Paris inscrit également une limite de réchauffement de 1,5°C et le fait que les réductions d’émissions doivent être drastiques, avec l’objectif d’atteindre de net-zéro à l’horizon 2050. Cette nouvelle perspective a également pris en compte de manière explicite les coûts de l’inaction face au changement climatique : en 2015, contrairement à ce qui s’était passé à Copenhague en 2009, tous les dirigeants politiques ont reconnu les dommages causés par le changement climatique dans leurs déclarations. Ce contexte a également contribué à la socialisation inégale du risque climatique parmi un ensemble plus large d’acteurs économiques, en particulier dans le secteur financier, et notamment à la reconnaissance que certains impacts climatiques seraient si importants qu’ils ne seraient pas possibles de les assurer. L’année 2014, qui a précédé Paris, a constitué un point d’inflexion particulier : elle a été marquée par le rapport Risky Business de Michael Bloomberg, Hank Paulson et Tom Steyer 22 , ainsi que par le discours de Mark Carney, gouverneur de la Banque d’Angleterre, sur la «tragédie à l’horizon» 23 .
Dans le même ordre d’idées, la description par Christine Lagarde, alors directrice générale du FMI, du changement climatique comme un problème «macro-critique» 24 a marqué un changement radical dans la pensée économique et a directement influencé l’inclusion dans l’accord de Paris de l’article 2.1(c), établissant l’objectif de rendre «les flux financiers compatibles avec une trajectoire vers des émissions de gaz à effet de serre faibles et un développement résilient au climat», une disposition potentiellement puissante mais qui continue aujourd’hui à se heurter à l’économie politique mondiale des combustibles fossiles.
Les entités publiques et privées produisent des dynamiques de pouvoir fluides dans un cadre institutionnel non reconstruit, invitant de nouveaux organismes à combler le vide. Par exemple, le Network for Greening the Financial System (NGFS) a été créé en 2017 par les banques centrales et les autorités de surveillance, tandis que la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), un collectif de diverses entités axées sur l’investissement et codirigées par Mark Carney, a été annoncée lors de la COP26 en 2021. Bien que ces initiatives volontaires reflètent des points de vue différents, elles partagent une préoccupation commune : une désillusion croissante à l’égard de l’ère des marchés de capitaux libéralisés. Les banques centrales et les grandes institutions financières commencent à s’interroger sur la stabilité et l’efficacité des structures financières actuelles pour faire face à la crise climatique.
Les banques centrales et les grandes institutions financières commencent à s’interroger sur la stabilité et l’efficacité des structures financières actuelles pour faire face à la crise climatique.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
La gouvernance climatique, entre multipolarité et fragmentation
Climat, énergie et endettement : la multipolarité
L’instabilité de ce système, enracinée dans les dépendances parallèles des régimes de Bretton Woods et de gouvernance climatique, est remise en question par l’émergence de systèmes économiques parallèles et d’un monde multipolaire.
En effet, la crise financière de 2007-2008 a été le point d’inflexion qui a permis à la Chine de réorienter ses capitaux excédentaires des marchés financiers occidentaux vers une «version chinoise du plan Marshall» pour des investissements en Asie, en Afrique et en Amérique latine, ce qui a conduit à l’initiative «One Belt One Road», qui a prêté environ 1 000 milliards de dollars au cours de la dernière décennie. Ce processus a également conduit à la création de l’AIIB et de la Banque des BRICS, maintenant la Nouvelle Banque de developpement, offrant une alternative majeure à la Banque mondiale pour les besoins en infrastructures de nombreux États (et générant des volumes de dette très opaques — mais probablement massifs — au cours de ce processus) 25 .
La Chine représente aujourd’hui environ 20% du PIB mondial, 30% des émissions de CO2 et est le plus grand créancier bilatéral du monde. L’AIIB — qui prête principalement en dollars, mais aussi en renminbi — et l’inclusion du renminbi dans le panier de devises des droits de tirage spéciaux du FMI en 2015 ont constitué des étapes clés dans l’objectif de la Chine de mondialiser sa propre monnaie.
Bien qu’il soit peu probable qu’elle supplante totalement la domination du dollar, cette progression indique le début d’une multipolarité monétaire. L’intention de la Chine de «dédollariser» l’économie mondiale est claire. Aujourd’hui, le renminbi, en tant que monnaie de règlement des échanges, a plus que doublé au cours de l’année écoulée et est en passe de dépasser l’euro dans les deux prochaines années. Le «pétroyuan» commence également à concurrencer le pétrodollar, notamment en facilitant les échanges de pétrole facturés en renminbi avec la Russie 26 .
L’intention de la Chine de «dédollariser» l’économie mondiale est claire.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
Les turbulences macroéconomiques et le nouveau non-alignement
«Tous les soirs, je me demande pourquoi les pays doivent baser leur commerce sur le dollar», s’est récemment demandé Lula dans un discours prononcé devant la Nouvelle banque de développement créée par les BRICS en Chine, soutenant un rôle plus important du renminbi dans l’économie mondiale 27 — un signal majeur de l’humeur des économies émergentes du monde, qui remettent aussi en question le système multilatéral en exprimant leur non-alignement face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
En fait, le non-alignement pourrait être expliqué comme une couverture permettant aux nations vulnérables au niveau de leur dette de conserver leur autonomie dans un contexte géopolitique qui les expose de plus en plus à la volatilité des marchés des matières premières et à un éventail de créanciers géopolitiquement chargés. Comme le souligne Mona Ali, la Russie n’est pas seulement un grand exportateur d’énergie fossile, elle est aussi un créancier des pays à revenus faibles et moyens plus important que la France ou l’Allemagne 28 .
L’internationalisation de l’économie chinoise au cours de la dernière décennie a coïncidé avec plusieurs moments clés de la fragmentation émergente du système international, du Brexit à la présidence Trump — y compris son retrait de l’accord de Paris et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine — en passant par la pandémie de Covid-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Combinés, ces chocs accumulés ont modifié de manière décisive le tableau macroéconomique, défini aujourd’hui par la flambée des prix de l’énergie et des matières premières, et une inflation persistante ayant un impact sur le coût du capital et, comme nous le savons, sur les niveaux d’endettement critiques 29 . Ces facteurs assombrissent à leur tour le tableau géopolitique.
Le non-alignement pourrait être expliqué comme une couverture permettant aux nations vulnérables au niveau de leur dette de conserver leur autonomie dans un contexte géopolitique qui les expose de plus en plus à la volatilité des marchés des matières premières et à un éventail de créanciers géopolitiquement chargés.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
Un nouveau consensus de Washington ?
L’administration Biden s’interroge sur l’avenir du leadership économique américain. «L’intégration économique n’a pas empêché la Chine d’étendre ses ambitions militaires dans la région, ni la Russie d’envahir ses voisins démocratiques. Aucun des deux pays n’est devenu plus responsable ou plus coopératif», a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, dans un discours prononcé en avril 2023.
«Ce moment exige que nous forgions un nouveau consensus», a-t-il ajouté, ouvrant explicitement la porte à un «nouveau consensus de Washington» pour décrire cette nouvelle doctrine qui reconnaît implicitement que le statut du dollar américain, même s’il reste largement dominant, est plus contesté qu’il ne l’a jamais été depuis 1944. D’où la nécessité d’établir de nouveaux fondements économiques nationaux pour le dollar : son pouvoir, ancré dans la taille du marché financier américain, son rôle central dans le commerce du pétrole (et les fluctuations de son prix), et sa capacité à permettre des déficits commerciaux nationaux massifs, ont tous contribué à rendre l’économie américaine intrinsèquement inflationniste — et le monde plus fragile.
À cet égard, la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act) pourrait être interprétée dans un sens plus large que le récit dominant : il ne s’agit pas seulement d’un moyen d’alléger la pression sur les ménages et les entreprises américains, mais aussi du point de départ d’une nouvelle économie politique de l’énergie renouvelable, qui éloigne le dollar de l’attraction gravitationnelle du pétrole et d’autres sources de combustibles fossiles. Cette initiative est rationnelle dans un monde qui doit réduire considérablement sa dépendance au pétrole et aux autres combustibles fossiles pour limiter les effets sur le climat. Il s’agit également d’un moyen calculé de renforcer la compétitivité des États-Unis sur un marché mondial dont la dynamique — et les points d’étranglement — promet d’être plus tendue.
Une question clef, cependant, est de savoir ce que ce «nouveau consensus de Washington» signifie pour le multilatéralisme. L’IRA, tout en affichant son ambition et sa crédibilité sur les principaux objectifs de décarbonation, a également exposé les États-Unis à des accusations de protectionnisme et à d’autres approches «non marchandes» qu’ils ont reprochées à la Chine, augmentant ainsi le risque de «fragmentation géoéconomique», contre laquelle la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, n’a cessé de mettre en garde 30 .
Et pour cause : il est difficile d’imaginer que les normes vertes et la course au «zéro émissions nettes» puissent s’imposer dans un monde où les grandes économies ferment mutuellement la porte de leurs marchés, tout en «amenant» leurs alliés dans leur propre orbite. Il est donc légitime de se demander — malgré les assurances de Sullivan que ce nouveau consensus pourrait «construire un ordre économique mondial plus juste et plus durable» — dans quelle mesure les États-Unis sont politiquement prêts à réformer le système de Bretton Woods, si cela risque de donner l’impression qu’ils renoncent à leur rôle de leader.
Il est difficile d’imaginer que les normes vertes et la course au «zéro émissions nettes» puissent s’imposer dans un monde où les grandes économies ferment mutuellement la porte de leurs marchés, tout en «amenant» leurs alliés dans leur propre orbite.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
Fondamentalement, les structures de gouvernance de la Banque mondiale et du FMI ont contribué au ressentiment au sein de l’architecture financière internationale, dans un contexte d’évolution rapide de l’ordre économique mondial, confronté à des impacts climatiques de plus en plus importants. L’influence démesurée des États-Unis sur la gouvernance et l’orientation des deux institutions (contribution financière, leadership, droit de vote — et droit de veto effectif —, avantage du pays d’origine) exige une réforme institutionnelle ambitieuse.
L’émergence d’entités parallèles telles que l’AIIB et la Nouvelle banque de développement montre clairement que les financements non occidentaux et l’influence géopolitique qui en découle seront déployés ailleurs, avec l’encouragement explicite de la Chine, et qu’ils représentent un volume de bilan beaucoup plus important.
La COP27 et la «fenêtre d’Overton» de la finance
Ces dynamiques ont atteint leur paroxysme lors de la COP27 en Égypte, ce qui a donné lieu à un nouvel espace politique pour remettre en question l’architecture financière internationale.
Les résultats — avec des divergences importantes concernant la protection du seuil de 1,5 °C et le langage relatif à l’abandon progressif des combustibles fossiles — ont reflété une économie politique émergente où les énergies renouvelables tentent de s’imposer tandis que les exportateurs de combustibles fossiles, enhardis, poussent dans l’autre sens. La justice climatique a poursuivi son ascension dans l’agenda international, les pays vulnérables l’emportant finalement dans leur campagne — avec le soutien tardif et inattendu des États-Unis — pour que le concept de «pertes et dommages» soit formellement reconnu et qu’un fonds soit créé pour les dédommager des effets dévastateurs de la crise climatique.
Le débat sur les finances a également connu un changement radical, avec une résolution visant à rendre enfin opérationnelles les dispositions cruciales de l’accord de Paris sur le rééquilibrage du système financier. Cela permettra-t-il de clarifier l’interaction entre les marchés de capitaux et l’intervention de l’État, en particulier dans un monde plus fragmenté ?
Le changement par rapport à la COP26 a été significatif : à Glasgow, le Royaume-Uni a revendiqué la promotion du leadership de la finance privée, notamment en dévoilant le GFANZ. Mark Carney a parlé de l’alliance représentant 130 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion consacrés à la transition verte ; une alliance effectivement capable de se «réorienter» vers la décarbonation. Lors de la COP27 — avec l’invasion de l’Ukraine, les bénéfices exceptionnels pour l’industrie des combustibles fossiles et la réticence de nombreux acteurs financiers à l’égard du GFANZ s’il impliquait des objectifs climatiques contraignants — cette rhétorique avait perdu de son élan. Plus encore, l’attrait des investissements dans le pétrole et le gaz a suscité, dans certains États américains dirigés par des républicains, une bataille contre les critères ESG dans le secteur financier.
L’appel en faveur d’un «agenda de Bridgetown» a marqué l’esprit du temps.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
En dehors des négociations officielles, la fenêtre d’Overton de la réforme financière internationale s’est encore déplacée. Dans un discours éclairant prononcé lors de la COP27 — après avoir également fait la une des journaux lors de la COP26 —, Mia Amor Mottley, Première ministre de la Barbade, a presque à elle seule sorti le monde de l’impasse politique dans laquelle il se trouvait. Soulignant les difficultés de son propre pays à assurer le service de la dette et les taux de plus en plus intenables auxquels la Barbade doit emprunter, tout en étant confrontée à des ouragans de plus en plus violents et à une crise du Covid-19, elle a dressé un tableau clair des injustices structurelles du lien entre le climat et la dette.
L’appel en faveur d’un «agenda de Bridgetown» a marqué l’esprit du temps. Lancé à la Barbade et repris par le président Macron à la fois lors de la COP27 et du sommet du G20 qui s’est tenu en même temps, cet agenda présente un programme de réforme visionnaire qui prévoit de nouvelles émissions massives de droits de tirage spéciaux pour répondre aux besoins mondiaux en matière d’adaptation et d’énergie propre, ainsi que de nouveaux prélèvements mondiaux, plus que nécessaires, sur les bénéfices tirés des combustibles fossiles pour financer la transition.
Encouragé par le leadership audacieux de la Première ministre Mottley, le Président Macron a pris l’initiative d’appeler le Sommet de Paris de juin à soutenir l’esprit — mais sans pouvoir encore préciser l’agenda politique — des appels de Bridgetown.
La prochaine étape pour le multilatéralisme en matière de dette et de climat
Vers — et pendant — le sommet de juin
Les attentes à l’égard du Sommet de juin se réduisent à quelques résultats importants, quoique progressifs.
Tout d’abord, dans le but de trouver de nouvelles sources de financement sans endettement supplémentaire — en particulier de nouvelles taxes liées à la dimension économique de la crise climatique — l’adoption d’une taxe sur le transport maritime dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) d’ici la fin de l’année 2024 a le vent en poupe. Cette taxe constituerait un outil essentiel pour lutter contre les émissions du secteur maritime, qui contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre. En outre, les pays devraient fixer des objectifs ambitieux de décarbonation du secteur d’ici à 2030.
Les gouvernements devraient également explorer d’autres options fiscales, telles que des taxes sur le secteur du pétrole et du gaz et sur l’aviation, dans le but de favoriser l’équité tout en contribuant à la réduction des émissions.
L’appel de Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, en faveur d’une «évolution» de la Banque mondiale — l’incitant à ajuster ses bilans et à accepter davantage de risques pour faire face à la crise climatique et à d’autres menaces majeures — progresse, avec l’adoption d’une feuille de route à cette fin lors des réunions de printemps de 2023. Les gouvernements devraient profiter du prochain sommet pour donner au nouveau président de la Banque mondiale, Ajay Banga, les moyens d’agir en conséquence. Cela contribuerait à faire de la Banque mondiale l’institution leader en matière de changement climatique, tant au niveau mondial que national, ainsi qu’à soutenir la recapitalisation des différentes agences du groupe, ce qui contribuerait à orienter et à mobiliser les financements privés dans les pays en développement en faveur de la décarbonation.
En outre, les pays du G20 devraient tenir leur promesse de réaffecter 100 milliards de dollars de DTS au soutien du développement durable. Cela devrait inclure la reconstitution complète du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité et du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du FMI. Les gouvernements devraient également soutenir la dynamique de réacheminement des DTS vers les BMD par le biais de mécanismes tels que le capital hybride ou les obligations liées aux DTS, contribuant ainsi à établir de nouvelles normes pour le volume et la manière dont les DTS peuvent être mobilisés en faveur de l’action climatique.
Les gouvernements devraient demander au FMI de s’aligner sur l’Accord de Paris d’ici 2025, ce qui devrait inclure l’intégration systématique des risques climatiques dans les activités de surveillance du FMI et l’intégration du climat dans sa boîte à outils en matière de prêts.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
Enfin, les gouvernements devraient demander au FMI de s’aligner sur l’Accord de Paris d’ici 2025, ce qui devrait inclure l’intégration systématique des risques climatiques dans les activités de surveillance du FMI et l’intégration du climat dans sa boîte à outils en matière de prêts.
Encourager un changement de paradigme en matière de gestion de la dette
Ces «résultats» pourraient tous fournir une marge de manœuvre importante pour s’attaquer à nos crises interdépendantes de manière concertée et multilatérale. Ils s’appuieraient sur une autre évolution positive récente : la promesse faite par les pays riches en 2009, à Copenhague, de réunir au moins 100 milliards de dollars par an pour le financement de la lutte contre le changement climatique est enfin en passe d’être tenue cette année.
Quelle est la suite ? Un test fondamental pour ce sommet unique sera les éléments de langage du résumé du Président : pourrait-il produire un «plan d’action de Paris» et un élan durable pour la réforme financière internationale, en commençant par une nouvelle réflexion et de nouveaux engagements sur la dette ?
Les mentalités — mais pas encore les politiques — semblent évoluer. Une étude récente du FMI 31 montre que l’assainissement budgétaire ne réduit pas, en moyenne, les ratios dette/PIB, ce qui remet en question la boîte à outils établie pour les pays vulnérables à la dette — et les croyances dominantes sur l’austérité — dans la poursuite de niveaux d’endettement viables.
Au-delà du sommet, les discussions en cours sur la dette avec des pays comme le Sri Lanka, le Ghana, le Pakistan, le Kenya et de nombreux autres pays menacés de surendettement offrent autant d’occasions de renforcer les efforts de restructuration et d’annulation de la dette.
Par ailleurs, des solutions innovantes telles que l’échange de dettes vertes sont en train de voir le jour. L’Équateur, par exemple, vient d’achever le plus grand échange de dette contre nature jamais réalisé, contribuant à financer les efforts de conservation des îles Galapagos pour une valeur de 1,6 milliard de dollars 32 . Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, une initiative des Nations unies, soutenue par des philanthropes, impliquera la société civile dans le processus d’identification des possibilités de conversion de la dette pour soutenir les objectifs de développement durable 33 .
Des solutions innovantes telles que l’échange de dettes vertes sont en train de voir le jour. L’Équateur, par exemple, vient d’achever le plus grand échange de dette contre nature jamais réalisé, contribuant à financer les efforts de conservation des îles Galapagos pour une valeur de 1,6 milliard de dollars.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
Un rôle pour l’Europe : construire des normes autour de l’Accord de Paris
Les créanciers reconnaissent le besoin urgent d’approches innovantes en matière d’allègement et de restructuration de la dette. La Chine se montre ouverte à une plus grande diplomatie de la dette, comme en témoignent l’allègement de la dette de 17 pays en 2022 34 et les progrès réalisés en vue d’un accord récent avec la Zambie. La négociation, coprésidée par la Chine et la France sous l’égide du Club de Paris, prouve que des espaces de discussion constructifs sont possibles.
L’Europe a un rôle clair à jouer. Pour commencer, la restructuration de la dette dans le cadre commun du G20, ainsi qu’un dialogue accru entre les principaux créanciers comme la Chine et le Club de Paris, pourraient réduire la nécessité des interventions du FMI, améliorer la viabilité de la dette, renforcer la confiance et contribuer à réduire les coûts d’emprunt.
Sur le plan climatique, l’opportunité la plus évidente de poursuivre les progrès réside dans le leadership climatique renouvelé du Brésil après l’élection de Lula. Le gouvernement brésilien considère sa présidence du G20 en 2024 et sa candidature à l’organisation de la COP30 en 2025 comme un moyen de catalyser le multilatéralisme climatique. Depuis les conventions de Rio de 1992, le Brésil bénéficie d’une excellente réputation en tant que bâtisseur de ponts dans la diplomatie environnementale, et cette séquence peut en effet servir de rampe de lancement pour la prochaine grande «COP de l’ambition», ainsi que de moment pour restaurer la confiance des économies de marché émergentes et des pays vulnérables au climat dans l’architecture financière internationale.
Ce pourrait être le moment d’amorcer le passage à un système plus décentralisé, fondé sur les normes et standards prévus par l’Accord de Paris.
Jusqu’à ce que des progrès soient réalisés en matière d’endettement, la marge de manœuvre budgétaire des pays dépendra largement du financement concessionnel, des subventions et des DTS. Le récent rapport Stern-Songwe évalue le besoin des pays en développement et des pays émergents en matière de financement extérieur à 1 000 milliards de dollars supplémentaires par an 35 . Dans un contexte macroéconomique défavorable, la pression sur les budgets de l’aide publique au développement (APD) est encore plus forte pour répondre aux exigences concurrentes de l’atténuation, de l’adaptation — et maintenant des pertes et dommages — alors que les quantités promises restent largement insuffisantes. Lors des réunions de printemps, la Banque mondiale a accepté de modifier son bilan pour débloquer environ 5 milliards de dollars de prêts supplémentaires.
Il s’agit d’une étape positive, mais modeste. Alors que la réforme des institutions de Bretton Woods est essentielle, cette lenteur souligne la nécessité d’adopter d’urgence des stratégies concomitantes, notamment une structure financière plus décentralisée et régionalisée basée sur des normes alignées sur celles de Paris. L’Europe, en particulier avec l’aide de la Banque européenne d’investissement (BEI), est dans une position unique pour guider ce changement vers un système financier centré sur le climat qui pourrait être partagé également par l’AIIB et la Nouvelle banque de développement.
Jusqu’à ce que des progrès soient réalisés en matière d’endettement, la marge de manœuvre budgétaire des pays dépendra largement du financement concessionnel, des subventions et des DTS.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
Un tel changement de mentalité serait bénéfique au leadership européen en matière de climat, ainsi qu’au discours mondial sur le financement de la lutte contre le changement climatique et la dette en général. Étant donné le rôle de premier plan joué par l’Europe dans la définition de l’ambition mondiale en matière de climat, cette initiative pourrait provoquer un bouleversement indispensable au sein du système des institutions financières mondiales, tout en facilitant la libération de capitaux pour les pays qui en ont besoin.
Réforme du financement du développement : un tremplin ?
Partageant en grande partie le diagnostic et l’esprit de Bridgetown, un article récent offre un point de départ précieux et légèrement différent. Les auteurs proposent une refonte de l’APD et de l’architecture du financement du climat d’ici 2025, avec un cadre convaincant pour y parvenir.
Selon eux, la dépendance globale de l’aide internationale est entrée dans «l’âge des conséquences» — en d’autres termes, nos nombreux angles morts et dépendances décrits dans ce texte se heurtent à la réalité des impacts climatiques.
Ce faisant, le concept changeant de l’APD a dilué les financements mobilisés dans le cadre de son mandat, tout en consolidant (paradoxalement) le rôle de l’APD en tant qu’outil de la politique de l’État.
La montée en puissance des BRICS, l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et le passage des objectifs du Millénaire pour le développement aux ODD, plus ambitieux, ne sont que quelques-uns des facteurs de cette transformation, qui souligne l’importance de trouver une nouvelle taxonomie décentralisée pour déterminer quel type de financement peut servir au mieux un objectif donné.
Dans le cadre de cette «fusion» conceptuelle, l’aide serait divisée en deux parties : la première serait axée sur les personnes les plus vulnérables au climat et se concentrerait sur les objectifs «traditionnels» de l’APD et les donateurs historiques. La seconde sur la décarbonation, visant à faire entrer plus d’acteurs reflétant davantage notre réalité multipolaire, et un plus grand recours à des outils tels que les annulations et les échanges de dettes, avec des objectifs spécifiques de financement privé.
«L’Accord de Paris a fixé le calendrier : nous devons redéfinir le cadre et les contributeurs de la finance climat d’ici 2025», écrivent les auteurs. «Profitons-en pour redéfinir en même temps le financement du développement.»
Le concept changeant de l’APD a dilué les financements mobilisés dans le cadre de son mandat, tout en consolidant (paradoxalement) le rôle de l’APD en tant qu’outil de la politique de l’État.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
Ce cadre — et les négociations nécessaires pour le rendre opérationnel — permettrait également d’attribuer les priorités nationales et régionales aux institutions financières concernées, réduisant ainsi les chevauchements et les doubles emplois. Il s’agit là aussi d’un programme prometteur que l’Europe devrait soutenir, dans l’intérêt d’une déconcentration de notre système financier conforme aux principes de Paris.
Conclusion : redéfinir le débat sur la dette ?
Mia Mottley a donné une voix à un espoir partagé. Pendant des décennies, le statu quo a exacerbé les inégalités et sapé la confiance dans notre système multilatéral. Il y a eu des tentatives de réforme décousues dans le passé, mais aujourd’hui nous avons les grandes lignes d’un consensus, provoqué par cette «polycrise» 36 . Le diagnostic est le suivant : notre architecture financière internationale actuelle est à la fois injuste, mal équipée, insuffisamment responsable et préjudiciable à nos frontières planétaires. Notre trajectoire actuelle nuit à notre sécurité dans tous les sens du terme.
Les échanges sur la portée et l’ampleur de ces réformes suscitent, comme on pouvait s’y attendre, plus de désaccords. Ceci prépare le terrain pour le sommet de Paris, un moment privilégié dans une séquence rare de possibilités politiques. Alors que nous approchons de la mi-parcours des objectifs du Millénaire pour le développement et du premier bilan mondial de l’accord de Paris, le débat sur la réforme de l’architecture financière internationale ne peut se dérouler de manière isolée, et nous ne pouvons pas non plus le laisser échouer.
En outre, la diversité même des propositions — du G20 à l’initiative de Bridgetown, en passant par celles de Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, pour n’en citer que quelques-unes — offre l’occasion d’élargir et de démocratiser ce débat, alors même que les crises mondiales provoquent la fusion des débats macrofinanciers avec ceux sur la dette, le climat, la biodiversité, la santé et les biens publics mondiaux en général.
En fin de compte, nous avons besoin d’un financement record sans endettement excessif. Nous avons besoin d’un financement fermement orienté vers nos objectifs climatiques. Et nous avons besoin d’un système multilatéral qui favorise la confiance, au-delà des limites étroites de la souveraineté des États.
Cela nécessite également de repenser en profondeur la nature de la dette dans notre système financier. Et cela doit commencer chez nous.
La crise de la zone euro des années 2010 a rappelé brutalement le coût de l’emprunt pour les citoyens qui, lorsque leurs dirigeants sont confrontés à un défaut de paiement, sont tenus à l’écart du processus de prise de décision. Ce modèle historique de «dette, pétrole et dollar» pourrait être contré par une solution simple : la démocratie.
Nous avons besoin d’un financement record sans endettement excessif. Nous avons besoin d’un financement fermement orienté vers nos objectifs climatiques. Et nous avons besoin d’un système multilatéral qui favorise la confiance, au-delà des limites étroites de la souveraineté des États.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
L’Europe, quant à elle, doit encore équilibrer ses plans d’investissement dans le cadre du Green Deal avec une stratégie viable de consolidation du déficit, ce qui souligne la nécessité de redéfinir le débat mondial sur la dette et l’emprunt. Comme le fait remarquer l’économiste Mona Ali, la Réserve fédérale américaine a récemment augmenté son bilan de 300 milliards de dollars et a rapidement géré les turbulences du secteur bancaire aux frais considérables de l’État. Ce type de flexibilité contraste avec le programme moyen du FMI 37 .
L’Europe est particulièrement bien placée pour mener cette réflexion politique. La question centrale doit être de savoir comment les dépenses publiques — en particulier les milliers de milliards nécessaires pour faire face à la crise climatique — doivent être incluses dans tout objectif de déficit.
De par leur conception, de tels objectifs induisent une vision à court terme qui est fondamentalement incompatible avec l’horizon temporel requis pour respecter les engagements de zéro net, ainsi qu’avec les énormes inégalités entre les détenteurs de monnaies de réserve et le reste du monde, qui, à son tour, sera le moins bien protégé contre les impacts climatiques les plus violents. Aucun ratio dette/PIB ne peut protéger les populations du «carnage climatique».
À cet égard, il serait utile de repenser la manière dont les investissements verts sont comptabilisés dans la dette souveraine, comme Darvas et Wolff l’ont proposé dans le contexte des règles budgétaires européennes 38 . De même, il n’est pas judicieux d’ignorer les investissements climatiques urgents parce qu’ils ne correspondent pas à un carcan fiscal donné. Comme l’a dit succinctement Pisani-Ferry, «les investissements climatiques sont un argument de poids pour laisser les gouvernements s’endetter, car l’objection intergénérationnelle habituelle ne s’applique pas». En effet, «les gouvernements peuvent choisir de s’endetter financièrement pour pouvoir rembourser la dette climatique» 39 .
Le paradoxe suivant clarifie la voie à suivre. D’une part, nous devons financer la décarbonation à hauteur de milliers de milliards de dollars et nous adapter rapidement aux impacts climatiques, tout en faisant face à un endettement apparemment insoutenable et à des coûts d’emprunt croissants. D’autre part, le FMI est le premier à nous rappeler que plus nous attendons, plus les coûts seront élevés, non seulement parce que la dépendance aux combustibles fossiles et les conséquences climatiques renforceront le cercle vicieux, mais aussi parce que les volumes d’investissement nécessaires requièrent des politiques décisives et crédibles pour que les attentes en matière d’inflation restent inchangées.
En revanche, avec une coordination adéquate, la transition vers une économie plus verte pourrait créer un système durable plus résistant aux pressions inflationnistes 40 . Ce passage pourrait également libérer l’économie mondiale de la volatilité de la rente des combustibles fossiles et renforcer la sécurité énergétique. Bien que les intérêts liés aux combustibles fossiles et les «États pétroliers échoués» puissent rendre difficile le cheminement vers un scénario post-fossile, nous devons envisager une ère multipolaire d’énergie propre.
Enfin, cette transition s’accompagne d’inconnues auxquelles les économistes doivent faire face.
Les implications géopolitiques de l’approvisionnement en minerais essentiels et d’autres chaînes d’approvisionnement vertes, qui posent de profondes questions en matière de droits de l’homme et de justice sociale, figurent en tête de l’ordre du jour. Tout comme le défi des anticipations inflationnistes, il est clair qu’une transition verte qui oublie d’impliquer les collectivités est vouée à l’échec.
Le FMI est le premier à nous rappeler que plus nous attendons, plus les coûts seront élevés.
Laurence Tubiana et Elliott Fox
Nous pouvons également sous-évaluer les avantages. Les investissements verts ne sont pas traditionnellement considérés comme anticycliques ou comme des moteurs de croissance majeurs. Cependant, les recherches du FMI indiquent que le coefficient multiplicateur des investissements publics dans les secteurs verts pourrait être de 2 à 7 fois supérieur à celui des autres secteurs, influençant ainsi la croissance économique, les finances publiques et la dynamique de la croissance mondiale 41 .
Nous devons de toute urgence prendre en compte les inconnues que sont les catastrophes potentielles et l’incertitude dans les modèles économiques, comme le préconise l’agenda de Bridgetown. Les effets dévastateurs du changement climatique — tempêtes, inondations, incendies de grande ampleur — ne sont plus des exceptions, ils deviennent la norme. Comme le dit clairement Avinash Persaud, conseiller du Premier ministre Mottley et architecte de Bridgetown : «le changement climatique est un événement non assurable».
Les effets climatiques extrêmes de l’été dernier n’ont pas épargné le Pakistan. En Chine, des mégapoles ont été paralysées par des pannes d’électricité. La montée des eaux a érodé le sol sous les lignes ferroviaires côtières aux États-Unis, entraînant des fermetures permanentes. Les rivières du sud de l’Europe se sont asséchées et les agriculteurs ont dû faire face au temps le plus sec depuis 1200 ans.
Nous pouvons nous permettre la prospérité, la sécurité et la paix. Ce que nous ne pouvons pas nous permettre, ce sont des hypothèses dépassées, parce qu’elles engagent notre survie.
Notes
- «Climate change likely increased extreme monsoon rainfall, flooding highly vulnerable communities in Pakistan», World weather attribution, 14 septembre 2022.
- «Guterres urges radical global finance shake-up to help Pakistan after deadly floods», Nations-Unies, 9 janvier 2023.
- Sixième rapport d’évaluation du GIEC, Rapport de synthèse, mars 2023.
- World Energy Outlook 2021, Agence internationale de l’énergie, octobre 2021.
- Kate Mackenzie, Tim Sahay, «Stranded Countries and Stranded Assets», Phenomenal World, 23 mars 2023.
- Gillian Tett, «Prepare for a multipolar currency world», Financial Times, 30 mars 2023.
- «The 53 fragile emerging economies», The Economist, 20 juillet 2022.
- Seb Kennedy, «Zombie pipelines taunt Pakistan», Energy flux, 14 avril 2023.
- Poverty and Equity Briefs – Pakistan, Banque mondiale, avril 2023.
- «Aid in 2021: Key facts about official development assistance», development initiatives, février 2023.
- «CO2 Emissions in 2022», Agence internationale de l’énergie, mars 2023.
- John Williamson, «From Reform Agenda to Damaged Brand Name – A short history of the Washington Consensus and suggestions for what to do next», FMI, septembre 2003.
- Nancy Birdsall, Augusto de la Torre et Felipe Valencia Caicedo, «The Washington Consensus:Assessing a Damaged Brand», Center for global development, mai 2010.
- Ibid.
- Ibid.
- Dani Rodrik, «Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank’s Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform», Journal of Economic Literature, vol. XLIV (décembre 2006), pp. 973–98.
- Christof Rühl, «Oil Intensity: The Curiously Steady Decline of Oil in GDP», Center on Global Energy policy, 9 septembre 2021.
- Vitor Gaspar, Paulo Medas, Roberto Perrelli, «Riding the Global Debt Rollercoaster», Blog du FMI, 12 décembre 2022.
- «Small island developing states (SIDS) have spent 18 times more in debt repayments than they receive in climate finance, says new research», eurodad, 11 octobre 2022.
- Stern Review on the Economics of Climate Change, octobre 2006.
- «IMF Survey: G-20 Ministers Agree ‘Historic’ Reforms in IMF Governance», FMI, 23 octobre 2010.
- Disponible à cette adresse.
- «Breaking the tragedy of the horizon – climate change and financial stability – speech by Mark Carney», Bank of England, 29 septembre 2015.
- « Lifting the Small Boats, » Speech by Christine Lagarde, Managing Director, IMF, 15 Juin 2015.
- James Kynge, «China hit by surge in Belt and Road bad loans», Financial Times, 16 avril 2023.
- Phyllis Papadavid, «The Renminbi’s Rise and its Accelerated Use in Global Trade Finance», Asia House, 22 mai 2023.
- Joe Leahy et Hudson Lockett, «Brazil’s Lula calls for end to dollar trade dominance», Financial Times, 13 avril 2023.
- «Ali: Deweaponize the Dollar», Progressive International, 17 avril 2023.
- «G-20 Background Note on the Macroeconomic Impact of Food and Energy Insecurity», FMI, mars 2023
- Kristalina Georgieva, Gita Gopinath, Ceyla Pazarbasioglu, «Why We Must Resist Geoeconomic Fragmentation—And How», Blod du FMi, 22 mai 2022.
- World Economic Outlook, FMI, avril 2023.
- Rodrigo Campos et Marc Jones, «Ecuador frees cash for Galapagos conservation with $1.6 billion bond buyback», Reuters, 5 mai 2023.
- «Open Society Announces $1.7 Million to Support Middle East and North Africa Debt Swap for Sustainable Development», Open Society Foundations, 15 mars 2023.
- «China to Waive Some Africa Loans, Offer $10 Billion in IMF Funds», Bloomberg, 23 août 2022.
- «Finance for climate action: scaling up investment for climate and development», London School of Economics, 8 novembre 2022.
- Adam Tooze, «Welcome to the world of the polycrisis», Financial Times, 28 octobre 2022.
- Mona Ali, «Reforming the IMF», Phenomenal world, 13 mai 2023.
- Zsolt Darvas, Guntram B. Wolff, «A green fiscal pact: climate investment in times of budget consolidation», Bruegel, 9 septembre 2021.
- Jean Pisani-Ferry, «21-20 Climate Policy is Macroeconomic Policy, and the Implications Will Be Significant», Peterson Institute for International Economics, août 2021.
- Warwick McKibbin, Maximilian Konradt et Beatrice Weder di Mauro, «Climate Policies and Monetary Policiesin the Euro Area», Banque centrale européenne, 2021.
- Nicoletta Batini, Mario di Serio, Matteo Fragetta, et Giovanni Melina «Building Back Better: How Big Are Green Spending Multipliers?», FMI, 19 mars 2021.
citer l'article
Laurence Tubiana, Elliott Fox, Réparer un monde cassé : un nouveau consensus pour la finance globale, Groupe d'études géopolitiques, Juin 2023,




