Le rôle des entreprises dans la lutte contre le réchauffement climatique
Issue
Issue #6Auteurs
Béatrice Parance , Anne Stévignon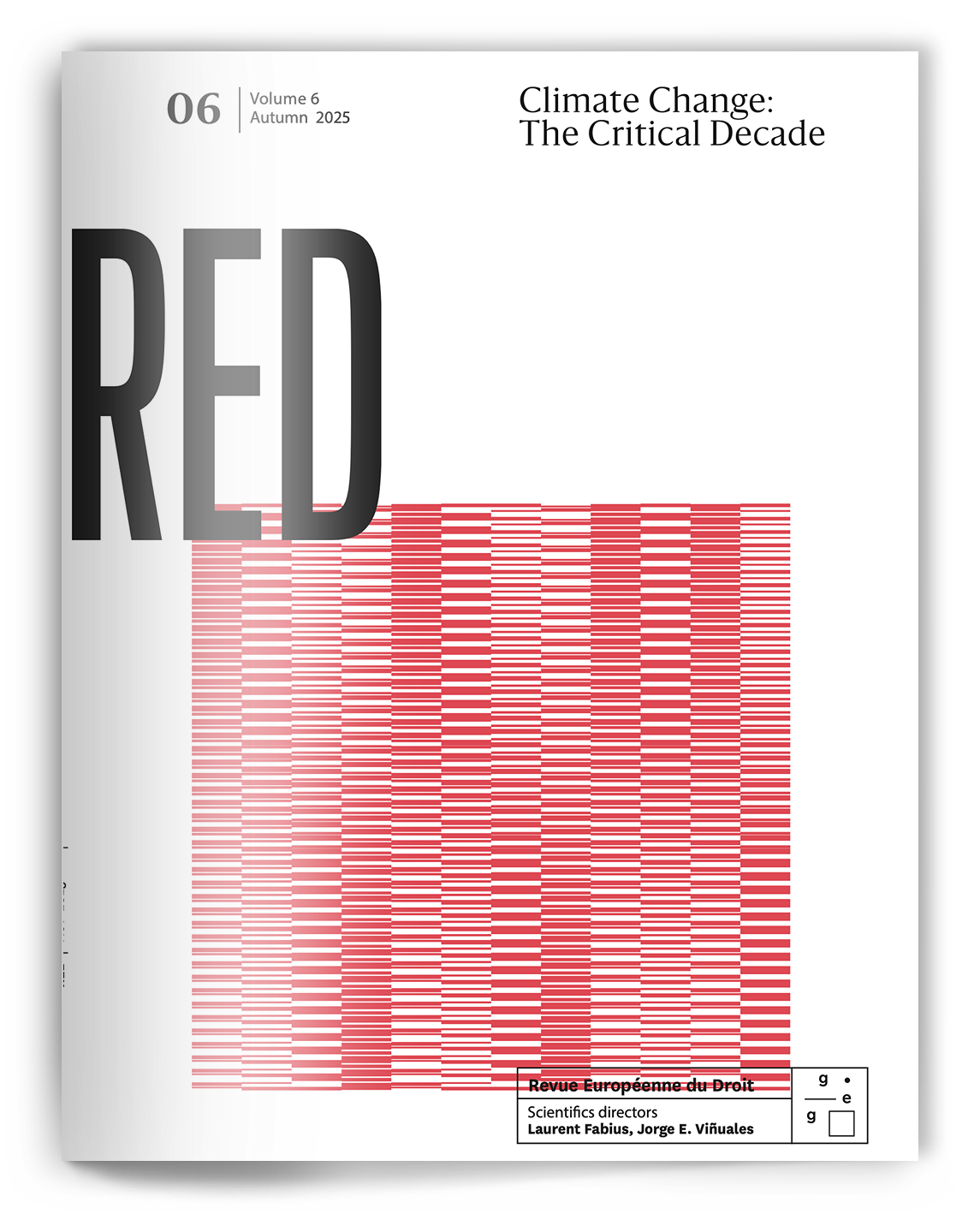
A Scientific Journal published by Groupe d'études géopolitiques
Climate Change: The Critical Decade
Face à la décennie critique, le rôle des entreprises est essentiel afin de contribuer à relever les défis sociaux et environnementaux qui s’apparentent plus qu’à une simple évolution à un véritable bouleversement : réchauffement climatique, crise de la biodiversité, inégalités sociales qui ne cessent de croître, contexte géopolitique en pleine reconfiguration dans un climat d’incertitude inégalé, fragmentation idéologique de la pensée politique dans la plupart des pays… 1 Parmi ces défis, la crise climatique est l’un des enjeux les plus cruciaux qui remet en cause les conditions mêmes d’habitabilité de la Terre, comme la Cour internationale de justice l’a rappelé en des termes solennels dans son avis du 23 juillet dernier relatif aux obligations des États en matière climatique 2 . Quels sont alors les mécanismes qui accélèrent ou au contraire freinent la transition des entreprises, en particulier la transition climatique ? Quelles sont les dynamiques qui permettent de renforcer l’élan des entreprises face à ces défis ?
La contribution des entreprises au dépassement de ces défis est d’autant plus nécessaire que ceux-ci atteignent une ampleur sans précédent. De nombreuses entreprises multinationales opèrent dans des régions du monde où les législations nationales sont lacunaires, tandis que les chaines de valeur se sont mondialisées, s’étirant sur plusieurs continents. Jusqu’ici, les transitions technologiques étaient initiées par l’apparition d’une innovation, préparée par un ou plusieurs acteurs, qui finissaient par l’imposer et déclasser les techniques précédentes moins efficientes. Aujourd’hui, rien de tel : le moteur du changement ne procède pas de la découverte d’une solution nouvelle, mais d’un impératif exogène. C’est par l’atteinte des limites planétaires que nous sommes collectivement sommés de nous mettre en mouvement, sans pour autant que toutes les solutions existent déjà. Les réflexions présentées ici s’appuient sur le rapport produit dans le cadre du Club des juristes, « L’entreprise engagée face aux défis du XXI° siècle », sous la présidence d’Isabelle Kocher de Leyritz 3 .
Dans les années 1970, dans le courant de l’opinion portée par Milton Friedman selon laquelle l’entreprise a pour fonction de maximiser le profit des actionnaires, la théorie de l’agence a permis d’aligner l’intérêt des dirigeants sur celui des actionnaires de telle sorte que les décisions sociales étaient guidées par la seule recherche du profit au détriment des différents impacts des activités des entreprises. La forte prise de conscience à partir des années 2000 du caractère majeur des défis environnementaux et sociaux qui s’imposent à nous a conduit à « prendre au sérieux la responsabilité des entreprises » dans l’adaptation à ces défis 4 . Kofi Annan avait en ce sens lancé en 1999 lors du forum économique de Davos un appel à un pacte de partage de valeurs et de principes entre les entreprises et les Nations Unies afin de « donner un visage humain au capitalisme », appel qui donnera lieu à la création du Global compact. Depuis lors, cet élan a suscité le déploiement de régulations juridiques tendant à orienter les entreprises à prendre en considération les externalités négatives de leurs activités sur les droits humains et l’environnement. Ce mouvement s’est d’abord traduit par l’introduction des premières formes de reporting extra-financier, avant d’évoluer vers des obligations plus substantielles de vigilance.
Deux voies se sont dégagées des travaux menés dans le cadre du rapport du Club des juristes. D’une part, il est apparu nécessaire de repenser le droit de la responsabilité afin que celui-ci ne soit plus seulement le mécanisme qui sanctionne un comportement passé imputable à un seul acteur, mais devienne un levier d’engagement des entreprises en faveur de l’avenir (1).
D’autre part, une réflexion a été menée sur les régulations juridiques déployées à partir des années 2000 ; celles-ci ont été comprises comme participant à la construction d’un « droit de l’engagement » qui dépasse les formes de régulations antérieures fondées sur l’imposition de limites et d’interdits, que l’on peut qualifier, par contraste, de « droit des limites » (2).
C’est à la lumière de ces réflexions que nous analysons le recul préoccupant qui se déploie actuellement au nom de la compétitivité économique, nouveau mantra de la Commission européenne, et vient justifier le détricotage de l’ouvrage patiemment tissé. La nouvelle majorité politique européenne issue des élections du Parlement au printemps 2024 a été une des premières causes de ce mouvement de backlash, les partis populistes présentant avec constance les régulations environnementales comme des contraintes bureaucratiques sans fondement. Dans un deuxième temps, le rapport « The future of European competitiveness ‒ A competitiveness strategy for Europe » coordonné par Mario Draghi en septembre 2024 a mis sur la table de l’Union européenne le sujet de la simplification. Enfin, les profondes transformations de l’environnement géopolitique avec l’accession au pouvoir aux Etats-Unis de Donald Trump ont parachevé d’entretenir la croyance que les régulations européennes, frein majeur pour les entreprises, devaient être remises en cause. Il en résulta la présentation par la Commission européenne en février 2025 de deux propositions de directive omnibus ayant notamment pour objectif de retarder et de réduire la teneur des directives CSRD et CS3D 5 . Sans entrer ici dans le détail de dispositions non encore définitivement adoptées, retenons pour l’essentiel qu’elle tend à réduire très fortement le champ des entreprises soumises à de telles réglementations, et qu’elle entend alléger les obligations qui en résultent. Pourtant, à la lumière des réflexions qui précéderont, il nous apparaît plus que jamais nécessaire de garder le cap face aux défis sociaux et environnementaux du 21ème siècle (3).
I – Le monde a changé : repenser la responsabilité comme un engagement pour l’avenir
1 – Les défis inédits posés aux entreprises, en particulier le défi climatique
Le réchauffement climatique est désormais identifié à juste titre comme le risque le plus grave auquel l’humanité est confrontée au 21ème siècle. Comme l’a martelé le Secrétaire Général des Nations Unies Antonio Guterres lors de la 27e session de la Conférence des Parties, « c’est la question déterminante de notre époque. C’est le défi central de notre siècle […] les impacts mortels du changement climatique sont ici et maintenant » 6 . Pour la Cour internationale de Justice, il ne s’agit rien moins que d’un « problème existentiel d’ampleur planétaire, qui met en péril toutes les formes de vie ainsi que la santé même de notre planète » 7 .
Le consensus qui se déduit des normes internationales de référence en matière climatique (incluant la CCNUCC, l’Accord de Paris, le Pacte de Glasgow et la Loi européenne sur le climat) et des rapports scientifiques faisant le plus autorité (notamment les rapports du GIEC), conclut à l’impérieuse nécessité de limiter le réchauffement global à 1,5°C. La plus haute juridiction mondiale en a d’ailleurs pris acte en indiquant dans son récent avis sur les obligations des États en matière de changement climatique que l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C est « considéré par tous, sur la base des données scientifiques, comme celui qu’il convient de poursuivre en vertu de l’accord » de Paris 8 .
Or des pans entiers de l’économie sont identifiés comme problématiques du fait de leur potentiel d’émissions alors que le budget carbone mondial restant, c’est-à-dire le volume maximal de gaz à effet de serre pouvant encore être rejeté dans l’atmosphère pour ne pas dépasser l’objectif de réchauffement de 1,5°C, s’épuise plus rapidement que prévu. Le budget carbone mondial restant pour tenir l’objectif 1,5°C était évalué à 510 Gt CO2 par le GIEC en 2022 9 , il a été réévalué à la baisse à 130 GtCO2 en début d’année 10 : à ce rythme, il devrait être épuisé dans les années à venir. Le risque d’emballement climatique avec l’atteinte de points de bascule (« tipping points ») n’a jamais été si grand 11 . Ainsi, les années passant, les défis à relever et la marche à gravir par les acteurs tant publics que privés ne font que croître à proportion que les efforts collectifs ont été insuffisants.
Il convient également de souligner que la crise climatique n’est que la partie émergée de l’iceberg car en arrière-plan, le dépassement d’autres limites planétaires telles que mises en évidence par le Resilience Center de l’Université de Stockholm 12 et l’effondrement de la biodiversité sont autant de défis colossaux. Les liens entre climat et biodiversité sont d’ailleurs de plus en plus manifestes, comme en témoigne le rapport conjoint du GIEC et de l’IPBES de 2021 qui met justement en garde contre les analyses en silo 13 .
Ainsi, les multiples crises environnementales posent des défis inédits pour les entreprises qui sont non seulement négativement impactées dans l’exercice de leur activité mais sont également appelées à les surmonter.
2 – La nécessité de repenser le droit de la responsabilité
En théorie, il serait possible de considérer que le rôle et la responsabilité juridique de l’entreprise sont de veiller à respecter des limites fixées par le législateur, limites de plus en plus étroites, et de déployer ses activités dans ce cadre. Cette conception, que l’on pourrait qualifier d’historique, n’est cependant plus pleinement satisfaisante. La responsabilité civile, telle que définie aujourd’hui encore au sein de l’article 1240 du Code civil comme « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », révèle ses limites dans un contexte d’émergence de risques inédits tant par leur échelle, leur ampleur que par leur caractère potentiellement irréversible 14 .
Tout d’abord, la notion d’imputabilité qui fonde la responsabilité d’un acteur unique dans une chaine causale clairement identifiée n’est plus pertinente dans un contexte où tout un système est à l’origine des déstabilisations massives observées 15 . La complexité scientifique des sujets et leur caractère systémique induisent le flou entre les actes et leurs impacts : au-delà d’actes individuels faisant naître un dommage identifié, nous sommes aujourd’hui face à des dommages globaux qui résultent des impacts des activités d’une multitude d’acteurs.
Ensuite, d’un point de vue collectif, il semble inapproprié de réfléchir en termes de réparation a posteriori parce qu’il s’agit de prévenir le pire : nous sommes aujourd’hui face à des impacts de nature collective qui s’avèrent irréparables au sens propre, et dont il faut tenter d’éviter ou d’atténuer l’avènement plutôt que d’imaginer les réparer.
Enfin, cette complexité des enjeux, l’évolution permanente de la compréhension de ces enjeux et de la manière d’y répondre rendent l’exercice réglementaire particulièrement ardu. L’effort du droit, tout particulièrement du droit de l’environnement, de délimiter des bornes sûres, des limites que personne ne doit dépasser, placées à des niveaux tels que si chacun les respecte, la sécurité de l’ensemble est assurée, est confronté au caractère systémique des enjeux, souligné par la notion de limites planétaires. Ces questions systémiques sont en outre entachées d’incertitudes scientifiques et technologiques, ce qui complexifie encore le choix des réponses institutionnelles à apporter. Ces incertitudes contribuent également à expliquer pourquoi les réglementations environnementales ont souvent été perçues comme un édifice excessivement technique et siloté. Il apparaît dès lors illusoire de penser que le législateur puisse définir de manière exhaustive et à la bonne vitesse les limites nécessaires. Le droit des limites doit ainsi être conjugué avec un droit de l’engagement.
Ainsi, rehausser les contraintes environnementales suffisamment rapidement pour retrouver un système de limites dont le respect doit assurer la protection du collectif ne peut suffire, d’autant que la période que nous vivons se caractérise en même temps par un besoin pressant de faire émerger des solutions nouvelles. Il s’agit autant d’inventer un avenir sûr que de mettre fin à certaines de nos pratiques actuelles. Le monde a donc plus que jamais besoin de pionniers. C’est ainsi que la responsabilité des entreprises ne peut seulement être vue comme une responsabilité pour le passé et appelle pour l’avenir à l’émergence d’un droit de l’engagement.
3 – La promotion d’une responsabilité perçue comme un engagement pour l’avenir : le dépassement du droit des limites en faveur du droit de l’engagement
La construction d’un « droit de l’engagement » apparaît aujourd’hui nécessaire pour accompagner le mouvement des entreprises et répondre aux défis planétaires et sociétaux. Contrairement au « droit des limites » historique, le droit de l’engagement met davantage l’accent sur l’avenir, sur l’utilité spécifique que l’entreprise cherche à atteindre, et ce dans tous les secteurs d’activités. Chaque acteur économique doit apprécier son positionnement au regard de la meilleure évaluation possible de ce qui se dessine pour son secteur, soit qu’il soit directement concerné du fait des activités de ses propres usines, soit qu’il génère chez ses fournisseurs ou ses clients des activités qui vont être remises en cause. Au-delà d’une simple logique de verdissement, il s’agit de déployer une approche stratégique de ce que sera l’activité en question dans un monde soutenable et de la bonne vitesse de déplacement pour y parvenir.
Dans cette perspective, la responsabilité perçue comme un engagement pour l’avenir doit non seulement contribuer à accompagner l’entreprise dans cette vision stratégique mais aussi la « récompenser » de ses efforts. Ainsi, le droit de l’engagement d’une part maintient une dimension de contrôle en imposant à l’entreprise d’anticiper et de prioriser les risques que son activité fait peser sur l’environnement à travers la figure modernisée du devoir de vigilance : celui-ci étant en quelque sorte appelé à fermer la marche en relevant au fur et à mesure des avancées les minimas en dessous desquels il n’est pas possible de se situer. D’autre part, il renforce l’obligation de publier des informations en soutien de l’émergence de la nouvelle représentation du succès, afin de faciliter la comparaison des entreprises sur les problématiques transversales, et de mettre en valeur les entreprises les plus engagées et résilientes, incitant ainsi l’entreprise à s’engager dans une mission qui lui sera singulière pour opérer sa transition.
II – Les vertus d’un système juridique qui promeut l’engagement des entreprises
Plus une entreprise questionne son modèle à l’aune des évolutions en cours et anticipe les renoncements nécessaires ainsi que les ruptures technologiques à engager, plus elle renforce sa capacité de résilience face aux mutations à venir. Dès lors, le système juridique ne peut se cantonner à poser des limites auxquelles les entreprises doivent se conformer ; il doit susciter une représentation du succès favorable aux entreprises engagées et inciter celles-ci à aller au-delà des minimas posés pour façonner les contours d’un avenir désirable. Ce droit de l’engagement repose ainsi tant sur l’obligation de transparence née du reporting (2.1) que sur l’obligation substantielle née du devoir de vigilance (2.2).
1 – La capacité du reporting à modeler une représentation du succès en faveur des entreprises engagées
À l’origine, l’obligation de transparence a pris la forme d’une obligation de reporting sur les sujets sociaux et environnementaux : il s’agissait de faire du reporting extra-financier l’égal du reporting financier utilisé par les investisseurs pour qu’ils soient à même de mener leurs arbitrages d’investissements. Dans le sillage de la France, qui avait ouvert la voie dès 2001 en imposant aux sociétés cotées une obligation de reporting extra-financier, l’Union européenne a adopté, le 22 octobre 2014 16 , une directive visant à harmoniser ce type d’exigence à l’échelle communautaire. Toutefois, cette première génération de reporting laissait beaucoup de liberté aux entreprises sur le format des données à fournir, faisant porter ses exigences sur les champs thématiques des informations à couvrir.
C’est pourquoi il est apparu nécessaire d’aller plus loin en améliorant la comparabilité entre les informations non financières délivrées par toutes les entreprises et en renforçant leur fiabilité par un approfondissement du contrôle exercé. C’était toute l’ambition de la directive Corporate sustainability reporting (CSRD) adoptée en décembre 2022 17 , qui a étendu considérablement le champ des entreprises soumises à un tel reporting afin de faire du reporting de durabilité, nouveau vocable retenu, le véritable alter ego du reporting financier. À cette fin, elle a opéré une standardisation des informations à publier par les ESRS (European Sustainability Reporting Standards) proposés par l’EFRAG et adoptés par la Commission européenne dans des actes délégués dont le premier a été publié le 30 juillet 2023.
Cette directive opère une véritable révolution du reporting à travers quatre caractères très novateurs. Premièrement, elle ancre définitivement le fait que les sujets de soutenabilité s’étendent sur toute la chaine d’approvisionnement de l’entreprise au-delà de son périmètre légal en l’interrogeant sur l’amont (les commandes passées aux fournisseurs) et l’aval (l’utilisation par les clients de produits et services qui lui ont été vendus). Deuxièmement, elle consacre le principe de double matérialité, s’émancipant du modèle américain : à côté de la matérialité financière (l’influence de ces enjeux sur l’évolution des affaires et les résultats de l’entreprise), s’affirme la matérialité d’impact (les incidences de l’activité de la société sur les enjeux de durabilité). Troisièmement, elle s’écarte du seul champ de l’ESG en intégrant le champ de la stratégie, questionnant les entreprises non plus seulement sur leurs émissions de gaz à effet de serre par exemple mais aussi sur la part de leur chiffre d’affaires dit « à risques de transition » et aussi en opportunités de transition. Enfin, quatrièmement, elle s’intéresse à la dynamique de l’entreprise en l’obligeant à publier un plan de transition des activités, les ressources financières allouées à ce plan et celles qui sont allouées aux activités à fort risque de transition.
Remise substantiellement en cause par la proposition Omnibus, la dérive bureaucratique de la CSRD a été pointée du doigt : la directive aurait complexifié à l’excès l’exercice de reporting avec ses multiples points d’information requis. Cette lecture un peu simpliste fait cependant l’impasse sur l’ambition du texte, qui était de pousser les entreprises à un examen structurant et exigeant de leurs impacts, de leurs stratégies et de leurs modèles économiques. Ce ne sont pas tant les exigences de la directive qui ont nui à son efficacité, que le refus d’obstacle de certaines entreprises, confrontées pour la première fois à une exigence d’évaluation de leurs pratiques commerciales, de leurs choix stratégiques et de leur rôle sociétal. L’articulation entre les différentes réglementations européennes aurait certainement pu être mieux pensée, et un délai de mise en œuvre plus long aurait sans doute facilité l’appropriation de ces nouvelles obligations. Mais il serait réducteur de faire de la densité du dispositif une pure dérive bureaucratique, alors même que celui-ci portait une intention transformatrice assumée que certains acteurs ont, au fond, préféré contourner plutôt que d’y répondre.
Si les arbitrages européens ne sont pas encore connus 18 , il est impératif que le reporting traduise la capacité de l’entreprise à devenir résiliente, c’est-à-dire capable de s’adapter aux évolutions qui se profilent. D’une part, dans la majorité des secteurs d’activité, les technologies vont devoir évoluer, les chaines d’approvisionnement vont devoir devenir plus circulaires face à la raréfaction des ressources. Or les écarts entre les acteurs économiques sont considérables tant du point de vue de leurs risques de transition (la part des activités qui vont devoir se transformer, ralentir ou cesser du fait de la transition) que de leur capacité à saisir les opportunités de transition, ce que leur reporting devrait révéler. D’autre part, lorsque c’est tout le système qui est en cause et qu’il faut faire évoluer en même temps les modes d’extraction des ressources, les modes de production, de consommation et logistique, chaque acteur doit évoluer dans sa partie du jeu. Le reporting devrait alors rendre compte de la vitesse de déplacement de l’entreprise vers des modalités plus vertueuses dans sa propre partie du jeu, c’est-à-dire de la dynamique de transition qu’elle opère.
2 – La capacité du devoir de vigilance à stimuler les entreprises vers une meilleure intégration des risques sur toute la chaine de valeur
L’émergence de législations sur le devoir de vigilance représente une innovation décisive dans le droit des affaires. Elle illustre de manière concrète ce que nous avons désigné comme l’émergence d’un droit de l’engagement : un droit qui ne se limite plus à fixer des bornes ou à sanctionner des manquements, mais qui cherche à structurer les comportements des acteurs économiques dans une perspective proactive de responsabilité.
À cet égard, la loi française du 27 mars 2017 19 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre fait figure de texte pionnier en matière de protection des droits humains et des libertés fondamentales, de la santé et sécurité des travailleurs et de l’environnement. Elle est née de la prise de conscience que les entreprises ne pouvaient détourner le regard sur les conditions dans lesquelles sont produits les biens et fournis les services qu’elles commercialisent : un impératif de responsabilisation voyait le jour. Ses dispositions sont novatrices à double titre. D’une part, elles imposent à l’entreprise, non plus seulement de maîtriser ses risques internes, mais de prendre en compte les effets systémiques de ses activités sur les droits humains et l’environnement— autrement dit, de se confronter structurellement aux limites planétaires et au plancher social minimal, et ce sur l’ensemble de sa chaine de valeur. D’autre part, la loi innove par la plasticité du devoir de vigilance : il s’agit d’un standard de comportement évolutif appelé à s’adapter au fil du temps aux nouveaux défis sociaux et environnementaux – à l’image, par exemple, de la problématique croissante liée au plastique ou encore aux polluants dits « éternels ».
Cette loi a constitué d’emblée une véritable révolution pour l’entreprise qui ne peut plus se retrancher derrière la dimension mondiale de son activité pour ignorer les risques en la matière et doit démontrer une certaine proactivité dans la prévention des risques et l’atténuation des atteintes graves, sous peine de se voir attraite en justice pour obtenir du juge une mise en conformité du plan (art. L. 225-102-1 C. com.) ou visée par une action en responsabilité civile (art. L. 225-102-2 C. com.). Si le bilan des premières années d’application de la loi est contrasté 20 , le cadre juridique de la première des actions prévues par la loi a été récemment précisé dans l’affaire dite « La Poste » : la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 19 juin 2025 21 a confirmé l’importance de l’exercice de la cartographie des risques, poussant incidemment les entreprises à se saisir de la loi et à dépasser la logique de conformité.
Dans la lignée de la loi française, la directive (UE) 2024/1760 relative au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité 22 (dite Corporate Sustainability Due Diligence Directive ou CS3D), adoptée en juin 2024, vise à instaurer un socle commun d’obligations à l’échelle de l’Union, afin de mettre un terme à l’asymétrie normative entre États membres et d’élever le niveau de protection des droits humains et de l’environnement par les entreprises opérant sur le marché européen. À l’instar de la loi française, la directive a un champ d’application large qui vise l’ensemble de la « chaîne d’activités » et impose, aux termes de ses articles 8 et 9, une analyse des incidences négatives, réelles ou potentielles, ainsi qu’une hiérarchisation fondée sur la gravité et la probabilité des risques. Cette approche impose ainsi aux entreprises une analyse transversale des risques, les contraignant à adopter une logique filière dans l’identification et la hiérarchisation des risques et atteintes potentielles, au-delà de la seule sphère juridique de contrôle.
La directive fait cependant l’objet d’une profonde remise en cause depuis quelques mois 23 . Le paquet dit « Omnibus », présenté par la Commission le 26 février 2025, entend réviser certains éléments substantiels de la directive, en particulier le champ étendu de l’obligation de vigilance mais aussi l’exigence de mise en œuvre effective des plans de transition climatique prévue à l’article 22. La position du Conseil 24 va plus loin encore dans la régression. Dans une déclaration commune du 21 août sur l’accord-cadre pour des échanges commerciaux réciproques, équitables et équilibrés entre les États-Unis et l’UE, l’UE a déclaré s’engager à déployer des efforts pour faire en sorte que la CS3D et la CSRD « n’imposent pas de restrictions excessives au commerce transatlantique ». Elle a également promis de « travailler pour répondre aux préoccupations des États-Unis concernant l’imposition d’exigences en matière de vigilance aux entreprises de pays non membres de l’UE disposant de réglementations pertinentes de haute qualité » 25 .
Il ne faut néanmoins pas oublier que, quel que soit le sort des textes actuellement en discussion, l’obligation de vigilance qui pèse sur les entreprises ne se cantonne pas à la loi de 2017. La Cour de cassation considère en effet que les sociétés informées d’un risque étayé scientifiquement sont tenues d’une obligation de vigilance 26 . Le Conseil constitutionnel affirme également, à partir des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, que « chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité » 27 . Dans un récent arrêt remarqué rendu dans l’affaire du « Dieselgate », la première chambre civile de la Cour de cassation a même franchi un pas supplémentaire 28 : elle a interprété les articles du code civil au fondement de la demande à l’aune des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, et s’est appuyée sur le principe précité dégagé par le Conseil constitutionnel pour trancher que « caractérise un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat, le fait de livrer à un acquéreur un véhicule à moteur équipé d’un dispositif » truqué dont il est résulté une sous-estimation des émissions nocives pour l’environnement. Autrement dit, dans le cadre de son obligation de délivrance conforme, le vendeur est tenu d’exercer sa vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui peuvent résulter de la vente de son bien, obligation qui entre dans le champ contractuel et qui peut fonder une demande de résolution du contrat. La portée étendue de l’obligation de vigilance en matière environnementale est ainsi clairement posée 29 .
Dans ce contexte et quoique le Green deal soit de plus en plus menacé, il incombe d’autant plus aux entreprises de garder le cap.
III – Garder le cap dans un contexte géopolitique contraint
Dans un contexte politique de plus en plus idéologique, il existe de fortes raisons de garder le cap pour les entreprises, ce qui pourra se réaliser par la force du leadership des dirigeants.
1 – Les fortes raisons de maintenir le cap
D’une part, d’un point de vue général, il apparaît que de nombreux pays mènent leur transition, même si les Etats-Unis marchent à contre-courant. À cet égard, des études récentes démontrent que la Chine est engagée dans une profonde révolution énergétique qui a permis à ses émissions de gaz à effet de serre de diminuer dans un contexte global d’augmentation. Elle vient aussi d’instaurer un mécanisme de reporting pour ses entreprises qui reposent sur le concept de double matérialité.
En outre, affirmer que les régulations européennes sont un facteur de distorsion de concurrence pour les entreprises européennes sonne faux dans la mesure où l’Union européenne avait enfin eu le courage d’imposer ses réglementations aux entreprises étrangères qui opèrent sur son territoire, à l’instar de ce que pratique depuis très longtemps les Etats-Unis dans l’application extraterritoriale de leur droit sans cesse décriée. Tant la directive CSRD que la CS3D devaient s’appliquer aux entreprises étrangères réalisant un chiffre d’affaires conséquent sur le sol européen, tandis que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières est en train de se consolider.
Enfin, ces exigences réglementaires contribuent à la sécurité du système économique dans son ensemble en contraignant les entreprises à développer une meilleure vision stratégique : une majorité d’entreprises apprécient que la mise en œuvre de la CSRD leur ait permis de renforcer leur vision stratégique et de mieux intégrer les risques, et qu’elle offre une garantie de transparence et de comparabilité des rapports de durabilité des entreprises 30 . Dans le même sens, la Banque centrale européenne met en garde contre un abaissement des normes en soulignant que le système financier a besoin de données climatiques des entreprises de qualité et de quantité suffisante 31 . C’est alors la force du leadership qui permet de garder le cap.
2 – La force du leardership pour maintenir le cap
Dans ce contexte politique hautement instable, les entreprises adoptent des positionnements contrastés. Parmi les entreprises ayant réalisé pour la première fois leur rapport de durabilité dans le cadre de la CSRD, un certain nombre ont salué les vertus de l’exercice et n’entendent pas faire marche arrière. Mais le mouvement d’allégement des normes initié par la Commission européenne est également perçu comme de nature à ralentir l’implication des équipes et déprioriser les enjeux ESG 32 . Dans ce contexte, la transformation des entreprises repose en définitive beaucoup sur leurs épaules et sur le leadership de leurs dirigeants.
Comme le rapport « L’entreprise engagée face aux défis du XXI° siècle » le met en évidence, le leadership des dirigeants et du conseil d’administration est la pierre angulaire de la transition des entreprises engagées 33 . Dans un contexte d’arbitrages permanents sur des injonctions contradictoires, le conseil d’administration devient le lien où se cristallisent les convictions de l’entreprise, celles qui vont sous-tendre toutes les décisions les plus importantes, en particulier sur la stratégie et les investissements. Ces convictions vont en particulier s’incarner dans trois sujets de transition que sont la définition de l’utilité de l’entreprise axée sur sa raison d’être, les risques et opportunités de transition dont notamment les renoncements auxquels elle doit procéder, et enfin la manière dont elle doit appréhender le partage de la valeur.
Au-delà de toutes ces considérations et en définitive, c’est ainsi une opposition idéologique qui transparait des débats enflammés sur le sujet dans un contexte géopolitique très incertain sous l’influence américaine. L’Europe souhaite-t-elle encore proposer un modèle de développement fondé sur le respect de l’environnement et la préservation des droits humains, ou entend-elle s’effacer face au diktat posé par Donald Trump lequel rejette catégoriquement ces règlementations qui ne sauraient à ses yeux s’appliquer aux entreprises américaines ? Espérons que les convictions des entreprises les plus engagées ne vacillent pas face au mouvement temporaire de backlash.
Notes
- Les analyses et positions exprimées ci-après n’engagent que leur autrice
- CIJ, Avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique, 23 juillet 2025
- « L’entreprise engagée face aux défis du XXI° siècle », I. Kocher de Leyritz, B. Parance et A. Stévignon, Le Club des juristes, novembre 2024
- A. Supiot and M. Delmas-Marty (dir), Prendre la responsabilité au sérieux, PUF, 2015
- COM(2025)80 et COM(2025)81
- A. Guterres, « Discours d’ouverture de la COP 27 », 7 nov. 2022. Citation originelle (traduction libre) : « it is the defining issue of our age. It is the central challenge of our century. […] The deadly impacts of climate change are here and now ».
- CIJ, Avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique, 23 juill. 2025
- CIJ, Avis précité, §224.
- GIEC, AR6, WGIII, « Mitigation of Climate Change », Résumé à l’intention des décideurs, avr. 2022, p.18, Tableau SPM.2, « Key characteristics of the modelled global emissions pathways »
- Indicators of Global Climate Change, Key indicators of global climate change 2024.
- McKay, A. et al. (2022), « Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points », Science, Vol. 377/6611, p. 1. V. aussi : OCDE, « Climate Tipping Points: Insights for Effective Policy Action », 2022, p. 8 et 9
- Le Resilience Center de l’Université de Stockholm a identifié dès 2009 9 limites naturelles planétaires à ne pas dépasser pour maintenir sans risque la vie sur terre, dans un cadre qui a été mis à jour en 2023. Les scientifiques établissent que six des neuf limites planétaires sont désormais dépassées : le changement climatique, l’intégrité de la biosphère, la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, le changement d’usage des sols, l’utilisation de l’eau douce, et l’introduction d’entités nouvelles
- GIEC et IPBES, Biodiversité et Changement Climatique, 2021
- V. la triple mutation des risques décrite par J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, Notion 8, La responsabilité, Puf, 3e éd. 2023.
- F. Vallaeys, « Responsabilité sociale, gouvernance et soft law : trois définitions philosophiques à usage des « forces imaginantes » de la régulation hybride », in K. Martin-Chenut, R. de Quénaudon, Développement durable : mutations ou métamorphoses de la responsabilité ?, éd. A. Pedone, 2016, p. 138.
- Directive (UE) 2014/95 22 octobre 2014 dite « NFRD » (Non Financial Reporting Directive)
- Directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive)
- Le 31 juillet 2025, l’EFRAG a publié un ensemble simplifié de normes en matière de reporting (« Exposure Drafts (ED) of the Amended ESRS »), réduisant les points de données de 57 %
- Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
- V. le Radar du devoir de vigilance mis à jour en octobre 2024
- CA Paris, pôle 5- ch. 12, 17 juin 2025, La Poste, RG n° 24/05193. V. déjà TJ de Paris, 5 décembre 2023, La Poste, RG n° 21/15827
- Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.
- E. Pataut, « Omnibus ? », RTD eur., 2025, p. 5 ; D. Bureau, « Éloge de la négligence ? », JCP G n°22, act. 654 ; Th. Duchesne, « Paquet « Omnibus » : courage fuyons ! », BJB n°4, p. 33.
- https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/06/23/simplification-council-agrees-position-on-sustainability-reporting-and-due-diligence-requirements-to-boost-eu-competitiveness/
- https://policy.trade.ec.europa.eu/news/joint-statement-united-states-european-union-framework-agreement-reciprocal-fair-and-balanced-trade-2025-08-21_en (traduction libre)
- Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 04-16.180, Bull. civ. I, n° 143
- Cons. const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC ; Cons. const., 10 nov. 2017, n° 2017-672 QPC
- Civ. 1re, 24 sept. 2025, pourvoi n° V 23-23.869, « Affaire Dieselgate »
- Sur ce point et en amont de la décision du 24 septembre 2025, v. G. Leray, « La prise en considération des décisions du Conseil constitutionnel par le juge judiciaire en matière environnementale », JCP E, n° 01, 2025, 1006.
- En mai 2025, une enquête réalisée par le collectif #WeAreEurope, en partenariat avec HEC Paris révèle que 61% des entreprises européennes sont favorables à la CSRD actuelle, tandis que 51% rejettent le projet de réforme Omnibus, contredisant ainsi le discours dominant sur l’impact de cette réglementation
- Lettre de Christine Lagarde, présidente de la BCE au Parlement européen, 15 août 2025
- V. notamment l’étude menée par Deloitte, l’ANDRH et l’ORSE, « CSRD et au-delà : un an après, quel bilan ? », juill. 2025 : l’enquête a été menée auprès de plus de 80 entreprises et a mis en évidence que 54% des entreprises estiment que l’omnibus a un impact limité suite aux efforts déjà engagés mais 28% des organisations estiment que ces changements risquent de ralentir l’implication des équipes et déprioriser les enjeux ESG
- Cf la deuxième partie du rapport, p. 57 à 90
citer l'article
Béatrice Parance, Anne Stévignon, Le rôle des entreprises dans la lutte contre le réchauffement climatique, Groupe d'études géopolitiques, Nov 2025,





