Le grand récit de la politique industrielle et de la décarbonation

Adam Tooze
Professeur d'histoire et directeur de l'Institut européen à Columbia UniversityIssue
Issue #4Auteurs
Adam Tooze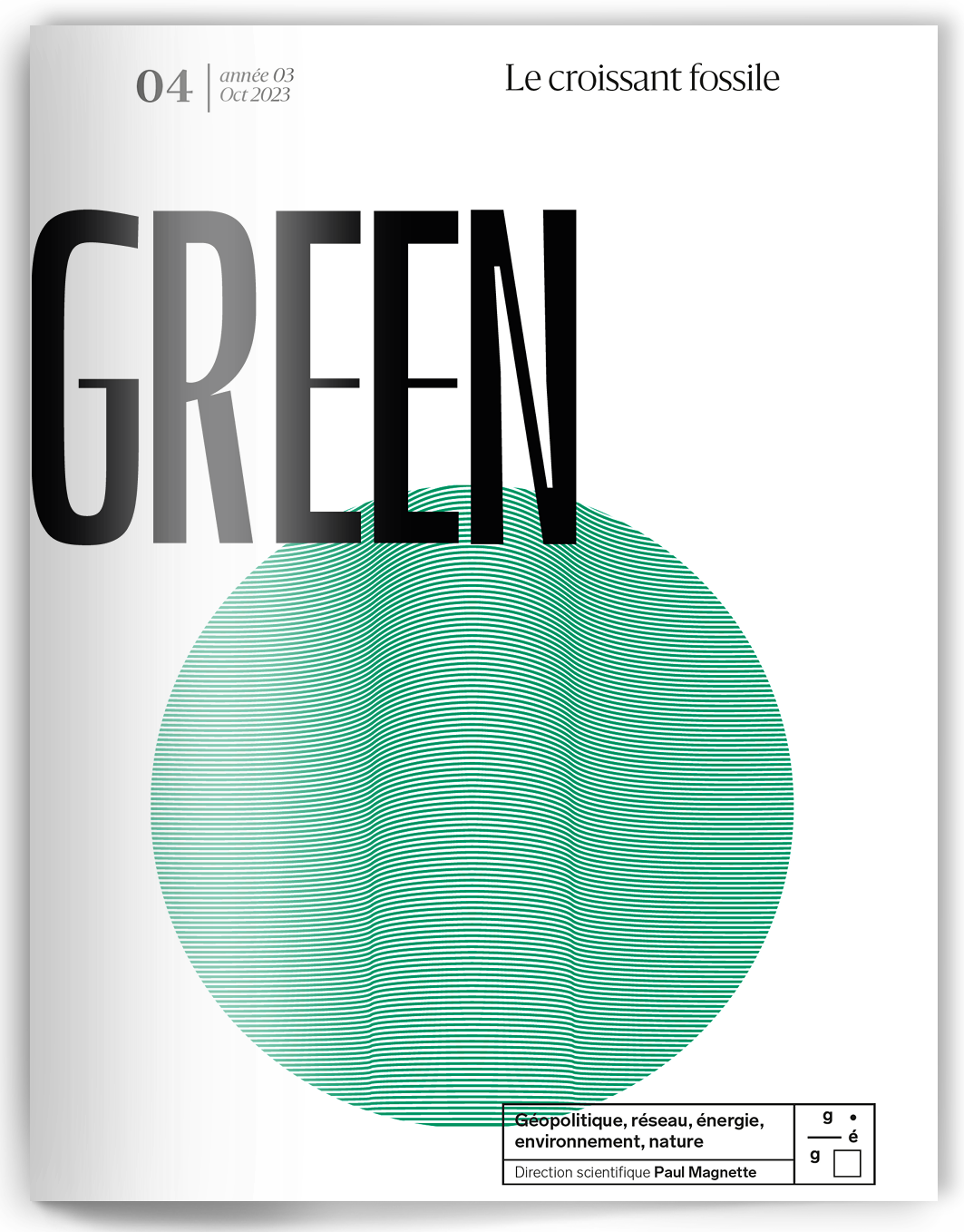
Publié par le Groupe d'études géopolitiques, avec le soutien de la Fondation de l'École normale supérieure
Le croissant fossile
Nous sommes arrivés à un tournant décisif. Nous pouvons désormais commencer une véritable transition énergétique et en même temps nous cherchons encore à comprendre ce qu’elle implique fondamentalement pour nous. Or, en général, une manière classique et familière de comprendre une situation est de se tourner vers une forme littéraire connue — comme celle du roman. En observant les États-Unis, on peut essayer de dessiner un modèle romanesque, en empruntant à Ezra Klein ses expressions de « libéralisme constructif » ou encore de « progressisme axé sur l’offre ». Ce récit serait décomposé en trois phases. La première est l’inévitable attirance ; la deuxième est le moment de tension où tout pourrait terriblement mal tourner ; et la troisième est le moment de la résolution.
La première phase est celle que nous ressentons presque tous au plus profond de nous-mêmes : le problème du climat exige que l’on se concentre sur la technologie, ce qui peut avoir de terrifiantes implications. Cela nous ramène à des choses dont nous aurions toujours dû nous préoccuper intellectuellement. Nous savons qu’à plusieurs reprises dans le passé, les États avaient les mains libres pour aborder ce problème par le biais de mécanismes de planification et d’intervention. Nous pensons donc que le problème climatique actuel va nous conduire vers ce point. Mais il se passe alors quelque chose de bouleversant, qui est un coup du destin si l’on suit notre métaphore romanesque : le moment où la question de la politique climatique a fait surface sur le devant de la scène politique mondiale était précisément le moment où le néolibéralisme et la révolution du marché ont pris le contrôle de l’agenda politique.
Le fait que la première réunion internationale sur la politique climatique ait eu lieu les lundi 6 et mardi 7 novembre 1989 est une coïncidence presque cosmique. Le mercredi était un jour férié de l’histoire mondiale — et le jeudi, le mur de Berlin tombait. Il s’agit d’un de ces moments étranges où les trajectoires de deux navires se croisent. À partir de cet exemple, Klein construit l’histoire du hiatus de 30 ans qui, dans le cas des États-Unis, a été motivé par l’idéologie néolibérale. Au plan narratif, le roi Exxon sépare les amants — le New Deal et son apogée verte.
Le grand bonheur de la politique américaine actuelle est que nous sommes sortis de ce hiatus. Un tournant majeur s’est produit l’été dernier lorsque les démocrates ont adopté la loi sur la réduction de l’inflation (IRA). Dans l’Amérique d’aujourd’hui, cette combinaison de lois sur les infrastructures et d’investissements massifs constitue une sorte de nouveau consensus de Washington. À cela s’ajoutent d’autres faits : les enjeux dépassent les simples questions de politique industrielle technique et du climat. La politique industrielle promet aujourd’hui de résoudre la question sociale.
Les Américains ne peuvent pas parler directement de classes sociales. Ce dont ils parlent, c’est de la classe moyenne — et ils s’efforcent donc de construire une vision de la politique américaine qui serait centrée sur la classe moyenne. L’un de ces projets importants, qui a une grande influence sur la réflexion en matière de politique étrangère, est la « politique étrangère pour la classe moyenne américaine ». C’est tout à fait inédit. Les sociaux-démocrates européens, quant à eux, n’ont jamais dit : « Nous allons formuler une politique étrangère pour la classe ouvrière européenne ».
Aux États-Unis, la politique industrielle verte s’inscrit donc dans le cadre des efforts déployés pour mettre en place une diplomatie fondée sur la base électorale. Et ce qui fait le lien entre ces deux éléments, c’est la Chine. On ne soulignera jamais assez à quel point elle est au cœur de l’imaginaire politique international américain, à quel point le protectionnisme gradué permet d’associer la politique industrielle et la question de la classe moyenne. Et c’est d’autant plus pratique que cela permet de colmater toutes les fissures du mur ; c’est ce que fait un bon récit.
Pourtant, en termes de volume, l’IRA est loin d’être aussi important que ne le suggère le battage médiatique. Sur une période de dix ans et par rapport à l’énorme produit intérieur brut américain, cela représente un dixième de point de pourcentage de PIB américain. C’est notamment le cas si nous prenons les estimations les plus élevées — non pas le chiffre utilisé pour faire passer le projet de loi au Congrès, mais celui dont nous rêvons et qui serait tiré par l’investissement privé — soit 1,3 trillion de dollars sur 10 ans selon les membres du Congrès. Cela représenterait 130 milliards de dollars sur un PIB qui s’élève actuellement à 20 000 milliards.
En ce qui concerne sa composante anti-chinoise, comme la plupart des politiques anti-chinoises actuelles, il n’est tout simplement pas évident de savoir comment nous allons procéder, étant donné la position que la Chine a établie dans de nombreux domaines stratégiques — nos téléphones portables et, littéralement, tout ce qui leur succèdera dans un avenir prévisible n’existent pas sans la Chine. Il s’agit d’une description correcte de l’état actuel du monde, une sorte de politique explicite.
Nous critiquons la politique des populistes de droite — Meloni et Trump — en leur reprochant d’être trop expressifs. Nous devrions également reconnaître que les progressistes ont la même tendance et le même désir : ils avaient besoin de faire quelque chose, l’Amérique avait besoin d’adopter une forme de législation verte. Il fallait que nous ressentions sa force car c’était la seule législation verte qu’ils seraient susceptibles d’adopter avant longtemps. Il était politiquement nécessaire de le faire. Autrement dit, nous devons être un peu moins positivistes, un peu moins naïfs dans notre lecture de ces données et de ces chiffres, parce qu’ils sont politiques au sens le plus riche du terme — ils terrifient les Européens. Il s’agissait d’une politique symbolique, dans le but de démontrer que l’Amérique était de retour. Les Chinois regardent et s’amusent de la façon dont l’IRA est revigorée et comme galvanisée, à tel point que le débat européen s’en est trouvé déstabilisé.
L’ancienne politique industrielle de l’Union
Ce récit peut également s’appliquer à l’Europe. On pourrait presque dire que l’Union est l’enfant de l’État néolibéral : il est assez évident que ce sont les Européens qui ont eu l’idée de la tarification du carbone. L’Environmental Defense Fund, un groupe de réflexion néolibéral américain, avait vendu l’idée de la tarification du carbone à l’administration Bush. Il n’a pas réussi à faire aboutir le projet sous Clinton, mais l’idée a fait son chemin jusqu’à Bruxelles.
Il est également vrai que l’Union, qui est née d’un projet de politique industrielle, a adopté des règles beaucoup plus strictes que les États-Unis en matière d’aides publiques. L’une des choses que nous sous-estimons toujours lorsque nous disons : « la réponse européenne à l’IRA fait voler en éclats l’unité de l’Europe et accroît les disparités », c’est que l’IRA fait la même chose à l’intérieur des États-Unis, car les Américains ne se voient imposer aucune limitation à ce que les États, les villes et les comtés peuvent subventionner. Bref, aux États-Unis, l’IRA a un effet polariseur extrêmement puissant qui joue sur les ressorts singuliers du modèle américain.
Mais dans quelle mesure sommes-nous réellement convaincus par ce récit ? Celui-ci permet-il vraiment de faire sens ? Car s’il s’agit de sa version néolibérale, il y a également des raisons d’être sceptique à l’égard du système d’échange de quotas d’émission. C’est un exercice symbolique sans effet tangible. Et quand bien même il s’agirait du mécanisme de tarification du carbone le plus sophistiqué au monde, aurait-il servi à quelque chose ? En réalité, ce n’est pas si important ; le mécanisme n’a pas été conçu pour cela.
Il s’agit donc d’un triomphe du néolibéralisme, ou, du moins, d’une version locale de celui-ci : le mécanisme est le bon lorsqu’il s’agit de montrer aux gardiens sourcilleux du libéralisme que l’on sait faire les choses ; néanmoins, si l’on observe les taux de prix, on constate que ce sont des chiffres insignifiants qui ne font aucune différence. On peut ainsi récolter des certificats en pagaille et gagner de l’argent à tour de bras en les vendant sur ce marché : c’est un système qui distribue les cadeaux. En somme, c’est un drôle de néolibéralisme.
En ce qui concerne leur politique industrielle, les Européens disent parfois : « nous avons traversé cette période où nous n’avons pas investi dans l’industrie, et aujourd’hui elle est derrière nous ». C’est un peu bizarre. Lorsque vous prenez l’avion, il y a de fortes chances que vous soyez assis dans l’un des deux grands modèles d’avions aujourd’hui disponibles : soit un Boeing — produit de la politique industrielle américaine dépendante du pétrole — ; soit un Airbus — produit du plus grand projet industriel européen.
Ce n’est pas un hasard, mais une conséquence de l’investissement de l’Europe dans la défense. Jusqu’au début des années 1990, la défense était au centre du débat sur la politique industrielle européenne. Aujourd’hui, Airbus est un vestige de cette époque, car l’aérospatiale est un trait d’union entre la politique de défense et le complexe militaro-industriel. Mais il semblerait que ce soit une exception. Le secteur européen de l’énergie, par exemple, n’a apparemment jamais profité d’une politique unifiée qui ait abouti à quoi que ce soit. Pourtant l’Europe a eu trois politiques énergétiques : premièrement, le programme nucléaire le plus avancé et le plus complet au monde, qui a été mis en place en collaboration avec les États-Unis sur la base d’une technologie américaine sous licence ; deuxièmement, le gaz, qui est une décision de politique industrielle de la part d’une série d’États européens et de grands producteurs de turbines et de gaz comprimé ; troisièmement, les grandes compagnies pétrolières européennes, comme Total et Shell, ont été des acteurs majeurs dans le secteur pétrolier transformé qui a émergé dans les années 1990, en particulier dans l’espace post-soviétique qui s’était ouvert à la prospection.
Bref, étant donné que le complexe énergétique de l’Europe s’est diffusé dans le monde entier, au moment, du reste, où le train à grande vitesse commençait à se développer, grâce à des entreprises européennes, il est un peu étrange de dire, comme le font certains Américains, que l’Europe n’a pas de politique industrielle — et d’autant plus si l’on pense à leur embarras pour construire une seule ligne de train à grande vitesse en Californie.
Prenons un autre exemple : les voitures. Les Européens sont lents à développer des véhicules électriques par rapport aux Chinois. Il existe beaucoup de travaux sur l’adoption de la Prius, le premier véhicule à post-combustion interne commercialisé en masse. Elle a été fabriquée par les Japonais et les Californiens. C’est le marché californien qui a permis à la Prius et à la mobilité hybride de devenir une réalité et d’entrer dans l’imaginaire des gens. De fait, la Tesla n’est pas le fruit du hasard : elle a réussi en étant plus attrayante que la Prius. L’entreprise Tesla avait la performance pour elle. Si vous êtes un investisseur en capital-risque en Californie, vous ne pouvez pas conduire une Prius car c’est une voiture peu soignée. Vous recherchez un véhicule puissant, et c’est exactement ce que fabrique Tesla. Mais il est important de reconnaître qu’il y avait un espace dans l’imaginaire automobile que les Japonais et les Américains ont construit.
Que faisaient les Européens à ce moment ? Où étaient-ils ces gens « qui n’ont jamais eu de politique industrielle » ? Ils perfectionnaient le turbo, c’est-à-dire une énorme réussite industrielle, qui a permis de faire passer le diesel à six litres aux 100 kilomètres. Nous savons aujourd’hui qu’il s’agit d’une impasse, mais à une époque, ce fut un projet énorme, conduit avec détermination par l’ensemble de l’industrie automobile européenne, soutenue par de nombreuses aides publiques.
Cette rapide série d’exemples montre une chose simple : il faut abandonner cette vieille idée selon laquelle l’industrie et l’Europe auraient divergé. Comme dans tous les bons romans, l’histoire d’amour n’est pas linéaire — le récit doit être plein de rebondissements, il est parfois même chaotique.
Le défunt marché européen de l’énergie et la montée en puissance de la Chine
L’Europe avait-elle une politique énergétique verte qui fonctionnait ? Oui, mais on aurait tort de croire que c’était le Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. En réalité, c’est le soi-disant modèle allemand des tarifs d’achat qui était vertueux… Ce qui est amusant avec ce modèle allemand, c’est justement qu’il exagère totalement le rôle des Allemands. Il est certes apparu en Allemagne, mais si l’on considère les données on se rend compte qu’à la fin de la première décennie du XXIe siècle, l’Espagne et l’Italie ont apporté des contributions très importantes à ce mouvement. C’était une politique industrielle qui fonctionnait. Son échec a donné lieu à une explication aujourd’hui largement diffusé : nous aurions laissé les Chinois s’emparer de l’ensemble du secteur de l’énergie solaire. Il y a une part de vérité dans cette affirmation, mais dire que les Chinois ont tué l’industrie solaire européenne, c’est un peu près comme dire que quelqu’un qui aurait été percuté par un camion de dix tonnes aurait dû surveiller son alimentation parce qu’il souffrait du corps.
La taille de l’industrie chinoise importait peu. Les Européens s’apprêtaient à tuer leur propre industrie solaire, sous l’effet conjoint du retrait des subventions et des pressions macroéconomiques. Les coûts allaient tuer les deux acteurs les plus dynamiques — l’Espagne et l’Italie — parce qu’ils font partie de la périphérie de la zone euro. Lorsque les gouvernements espagnol et italien ont été mis sous pression budgétaire, ils ont dû réduire leurs programmes de subventions. Autrement dit, ce sont les Européens qui se sont autodétruits tout en réduisant considérablement leur influence macroéconomique. Revenons à notre récit : l’histoire d’amour entre l’industrie et l’Europe se passait bien avant que cette dernière ne prenne une série de décisions catastrophiques, sapant complètement la relation.
Ce n’est donc pas tant que l’Europe était dirigée par un régime néolibéral puissant et cohérent, mais elle était aux prises avec un ensemble incohérent d’impératifs qui poussaient dans des directions différentes. Il existait une architecture néolibérale, fonctionnant sous la forme du système d’échange de quotas d’émission. Mais pendant la première phase de son existence — la première décennie — il s’agissait en quelque sorte d’une façade permettant aux entreprises industrielles de poursuivre des stratégies indépendantes. Les politiques étaient là, mais elles n’étaient pas coordonnées. À ce stade, l’Europe était dans l’impasse : ce paradigme dit néolibéral a engendré des contradictions jusqu’à l’effondrement. De ce point de vue, l’interdiction de la fusion Alstom/Siemens en février 2019 a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.
Mais pour qu’une telle décision ait précipité la crise, il y a de nombreux autres facteurs à prendre en compte. La décision de février 2019 a été cataclysmique, parce qu’elle a été prise à un moment où les Européens vivaient dans la peur de Trump et de la Chine depuis plusieurs années. Elle a ensuite été catalysée par la pandémie sans précédent du Covid, qui a permis de tirer deux leçons. La première est qu’il faut une politique industrielle cohérente pour conduire des politiques industrielles : tout reposait sur le succès des vaccins. Nous avons été confrontés au fait que le destin macroéconomique dépendait de la capacité à mener des essais médicaux très structurés. En Californie, tout s’est mis à tourner autour de cela, et la collaboration entre laboratoires s’est imposée au monde entier. L’autre impératif est tout simplement celui-ci : Berlin et Paris devaient trouver un plan de relance à grande échelle. À ce moment-là, la neutralité écologique au sens large du terme a disparu : il ne suffisait plus de dire que nous avions besoin d’un paquet d’investissements, il fallait désormais préciser que ceux-ci devaient être tournés vers les transitions numérique et écologique. En Europe, ce basculement s’est produit lorsque la CDU d’Angela Merkel a embrassé ce tournant, donnant une nouvelle dynamique au continent.
Quelle que soit la politique industrielle qui émergera de ce plan, sera-t-elle mise en place rapidement et efficacement ? Il faut toujours être conscients du fossé qui peut se creuser entre le discours et la mise en œuvre de la politique, d’autant que les questions qu’elle soulève sont nombreuses. Comment financer cette politique industrielle verte ? Comment assurer le partage des bénéfices et des risques ? Comment, pour éviter d’être mis hors-jeu, contribuons-nous à promouvoir une version mondiale de ces politiques ?
Depuis l’invasion de l’Ukraine, l’administration Biden a confirmé que les Américains étaient peut-être de retour, mais qu’ils n’étaient plus les mêmes. C’est une Amérique nouvelle et leurs nouvelles règles changent les termes du problème ; cette décision a déclenché une mutinerie des gouvernements nationaux à travers l’Europe.
Géoéconomie de la décarbonation
La transition vers une économie sans carbone nécessitera d’énormes investissements. Pour stabiliser quelque peu le climat au cours des vingt ou trente prochaines années, il faudra dépenser plusieurs milliers de milliards de dollars par an. Quatre mille milliards est un chiffre consensuel — 4 à 5 % du PIB mondial. C’est le montant des dépenses de défense pendant la guerre froide. La République fédérale d’Allemagne a par exemple dépensé 3 % par an sans broncher dans les années 1970 et 1990. Nous devons atteindre cet objectif et pourtant nous sommes constamment en deçà, non pas en termes d’ordre de grandeur, mais plutôt de multiples. Bref, nous sommes extrêmement loin du compte.
Pouvons-nous y arriver ? Est-ce soutenable ? C’est à ce stade qu’il faut introduire l’un des personnages clef du roman capitaliste contemporain : Mckinsey. Le cabinet de conseil a estimé la viabilité de la décarbonation de l’Europe il y a deux ans et, selon ses chiffres, l’établissement d’un prix du carbone suffirait à la financer. Selon eux, par secteur — entreprises, bâtiment, électricité —, un prix du carbone de 100 euros la tonne couvrirait le montant de tous les investissements en Europe.
Commençons à explorer l’impact inégal et combiné d’un tel choc de prix et d’énergie sur l’économie mondiale. Imaginons que nous nous trouvions dans un monde où les arguments en faveur d’une transition massive vers les énergies renouvelables deviennent très difficiles à remettre en question dans des endroits où la tarification du carbone est correcte, en Europe, par exemple, mais aussi, pour les besoins de notre raisonnement, en Chine, — que se passerait-il ?
Pour la Chine et l’Europe, l’argumentaire contre le passage au vert est pratiquement irrecevable : la transition énergétique abaissera les prix et offrira une meilleure sécurité d’approvisionnement. La Chine, l’Asie et le bloc eurasien commencent donc à se décarboner. La conséquence est que la demande de combustibles fossiles diminuera à long terme. Ils atteindront néanmoins un pic pour satisfaire la demande restante. Cependant, la tarification du carbone en Europe et en Chine empêchera l’effet de rebond de se produire et il n’y aura pas d’augmentation de la demande pour les combustibles fossiles bon marché disponibles.
Mais la conséquence d’un scénario dans lequel la demande mondiale de combustibles fossiles diminue est bien connue. Les derniers producteurs font cavalier seul et influencent les prix — l’Arabie saoudite, par exemple. Il en résulte un dommage collatéral : la formation d’un groupe de producteurs de combustibles fossiles à coûts élevés. Un groupe de chercheurs a simulé les gains et les pertes macroéconomiques accumulés par pays : l’Europe et la Chine tireraient d’énormes bénéfices de ce changement, tandis que les États-Unis subiraient des pertes. Cela ne les mènerait pas à la faillite, mais cela représenterait un manque de 2 000 à 4 000 milliards de dollars réparti sur plusieurs décennies, alors que l’économie américaine pèse 20 000 milliards de dollars. Il s’agit donc de pertes concentrées pour des groupes d’intérêt clefs. Un autre document publié l’année dernière par le même groupe a mis en évidence les pertes liées aux actifs échoués ou irrécupérables. Le capital fossile anglo-américain serait sévèrement touché par ce processus. Pour comprendre ce qui se produirait, il faut observer le choc qui s’est produit sur le prix des céréales dans l’agriculture européenne dans les années 1870 et 1880. Au terme de ce processus, dans les années 1930, les marchés agricoles du monde entier avaient été divisés en lots autonomes qui subsistent encore aujourd’hui.
Une transition énergétique mondiale au sein du système eurasien nécessiterait une participation des banques pour en compenser le coût, mais nous pouvons généralement imaginer que cela se produise en Amérique. C’est un fait peu connu, mais dans les années 1950 et 1960 — et, en réalité, dès les années 1930 — les importations de pétrole aux États-Unis ont été interdites, parce qu’à l’époque les producteurs de pétrole américains du Texas, de l’Oklahoma et de la Pennsylvanie étaient des producteurs à coûts élevés. On croit souvent que l’Amérique est un pays où le coût du pétrole est faible mais c’est uniquement parce qu’il était historiquement peu taxé. Les Européens et les Japonais bénéficiaient d’un pétrole vraiment bon marché mais ils payaient d’énormes taxes. Entre les années 1930 et les années 1960, les États-Unis ont donc mis en place une économie pétrolière protectionniste fermée à coûts élevés — ses multinationales opérant bien sûr des deux côtés de la barrière. On pourrait imaginer un tel scénario pour l’avenir. Mais cela impliquerait un conflit.
De fait, on voit déjà poindre les débuts de la dispute, ou plutôt les efforts pour la désamorcer entre les Européens et les Américains. La Maison Blanche veut faire savoir que l’Europe et les États-Unis ont enterré la hache de guerre écologique sur la question de l’énergie verte, et rappeler qu’ils veulent entamer les négociations sur un accord crucial sur les minéraux. Ils recherchent un dialogue sur les incitations en matière d’énergie propre afin de parvenir à un alignement — un euphémisme qui permet de ne pas dire : « désamorcer l’IRA ». Le Conseil transatlantique du commerce et de la technologie est aussi censé coordonné les actions de l’Union et des États-Unis contre la Chine. Enfin, un accord mondial sur l’acier et l’aluminium, dont il a été question pour la première fois lors de la COP 26 à Glasgow, devrait être conclu cette année.
Par ailleurs, les États-Unis envisagent les choses de façon globale. Ils veulent mettre en place un partenariat mondial sur les investissements dans les infrastructures. C’est la réponse de l’Europe et de l’Amérique à l’initiative des Nouvelles routes de la soie. Et elle se déploie de manière classique : beaucoup de paroles ; très peu d’argent.
Les États-Unis sont-ils un partenaire fiable ?
La rivalité avec la Chine
La question que l’Europe doit se poser est celle de la fiabilité et du coût de ce potentiel accord avec les États-Unis. Si l’on considère les pertes déjà existantes dans le portefeuille américain, en termes d’actifs bloqués, une personne rationnelle devrait-elle faire confiance aux Américains en tant que partenaire dans la décarbonation alors que son impact ne s’est pas encore fait sentir ?
La réponse est à chercher du côté des structures qui fondent cette situation : le plus grand exportateur mondial de combustibles fossiles — les États-Unis d’Amérique — est un partenaire improbable pour l’Europe à long terme. Les libéraux américains le savent et travaillent d’arrache-pied pour trouver des compensations. Les réalistes européens devraient le comprendre tout en surveillant le facteur chinois. Si l’on examine chacune de ces propositions transatlantiques — la proposition sur les matières premières, le Conseil du commerce et de la technologie, l’accord sur l’aluminium et l’acier, l’initiative du G7 sur l’infrastructure, le changement de direction de la Banque mondiale — elles font toutes partie d’une grande stratégie américaine qui consiste à chercher des alliés pour endiguer la Chine.
Et il s’agit, qui plus est, d’une stratégie tout à fait explicite de leur part, qui pose des dilemmes fondamentaux aux Européens. Sur la question chinoise, de nombreux dirigeants européens ont le sentiment pessimiste que le continent est pris entre le marteau et l’enclume. Mais l’Europe dispose en réalité d’une grande marge de manœuvre et elle doit évaluer sérieusement les options qui s’offrent à elle.
C’est là que la définition du problème est essentielle, car si l’on parle d’une politique européenne de l’emploi, d’un avenir industriel pour l’Europe ou du point de vue de l’intégration européenne en tant qu’objet d’intérêt principal, l’on se dirige dans une direction où la Chine apparaît de toute évidence comme la principale menace pour la survie de ce qu’il reste de l’industrie en Europe.
La lutte contre le changement climatique
Mais si l’on se place du point de vue du climat, le problème apparaît sous une lueur très différente. L’on peut choisir d’être neutres quant à la manière dont les Européens vont gagner leur vie : en fin de compte, peu importe où l’acier est fabriqué, tant qu’il est livré quand on l’achète. Si l’on adopte cette position, la réponse au problème est sans ambiguïté.
Selon les données de Bloomberg sur les investissements dans les énergies renouvelables l’année dernière, ces derniers s’élevaient à 1,1 billion de dollars au niveau mondial, soit plus de deux fois les investissements dans les combustibles fossiles. C’est une bonne nouvelle, à ceci près que la moitié de ces investissements est réalisé en Chine. C’est encore plus vertigineux si l’on considère non pas la production et les investissements totaux, mais les investissements en amont dans les usines de batteries : 90 % de ces investissements ont été réalisés en Chine au cours des cinq dernières années.
La Chine est absolument dominante dans tous les secteurs, qu’il s’agisse des batteries, des panneaux solaires ou des électrolyseurs. S’il est certain que ces marchés vont se développer considérablement dans d’autres pays, il faut reconnaître la position actuelle de la Chine et ses implications. Il y a une conséquence sur le climat : il suffit de regarder le schéma mondial des émissions aujourd’hui par rapport à 1990 pour comprendre la réalité : la Chine est à elle seule responsable de plus d’émissions que l’ensemble du G7. Le reste de la croissance sur cette période a été portée par le G20 — l’Indonésie, le Pakistan, la Turquie et les États du Moyen-Orient.
Il faut distinguer cette question de celle de la justice climatique et réfléchir de manière pragmatique. Où peut-on réellement résoudre ce problème ? Comment avoir une compréhension plus large de la position européenne dans le monde ?
Pour le moment, on attend le moment où le PIB chinois dépassera celui des États-Unis. On se demande si la Chine aura un jour une puissance militaire égale à celle des États-Unis — alors même que les émissions de la Chine ont dépassé celles des États-Unis en 2004. Le protocole de Kyoto avait en quelque sorte anticipé que cela allait se produire et comprenait la manière dont l’équilibre allait se déplacer. Au début des années 2010, la Chine a produit plus de béton en trois ans que les États-Unis pendant toute la durée du XXe siècle.
Cette situation n’est pas équilibrée par l’industrie occidentale, qui pèse aujourd’hui très peu dans un système aujourd’hui centré en Asie et porté par l’un des développements les plus extraordinaires de la civilisation urbaine dans l’histoire. Nous devrions féliciter les Chinois pour ce qu’ils ont accompli : 600 millions de personnes se sont installées dans les villes en l’espace de 25 ans. C’est comme si les révolutions industrielles américaines successives s’étaient déroulées en une seule génération, à notre niveau actuel de technologie.
Or c’est ce qui fait que l’équilibre est fondamentalement transformé. Et le point fondamental qu’il nous faut comprendre est que nous ne contrôlons plus notre propre destin — par « nous », j’entends l’Europe et les États-Unis. Prenons l’exemple d’un monde qui se réchauffe. Avec un gain de 4 à 5 degrés, tous les points de basculement seraient activés. Dans les scénarios vers lesquels nous nous dirigeons, avec tous les choix difficiles concernant la décarbonation, l’adaptation, les pertes et les dommages, ces choix seront fondamentalement faits en Asie — à ce stade, c’est elle qui mène l’ensemble du processus.
C’est là que débute le prochain roman : l’Europe et les États-Unis doivent prendre conscience qu’ils sont les passagers d’un train conduit par d’autres.
citer l'article
Adam Tooze, Le grand récit de la politique industrielle et de la décarbonation, Groupe d'études géopolitiques, Jan 2024, 54-59.
à lire dans cette issue
voir toute la revue





