« Une page du capitalisme se tourne »

Alain Minc
Essayiste, Président d'A.M. Conseil, auteur de Ma vie avec Marx, Gallimard, 2021Issue
Issue #4Auteurs
Alain Minc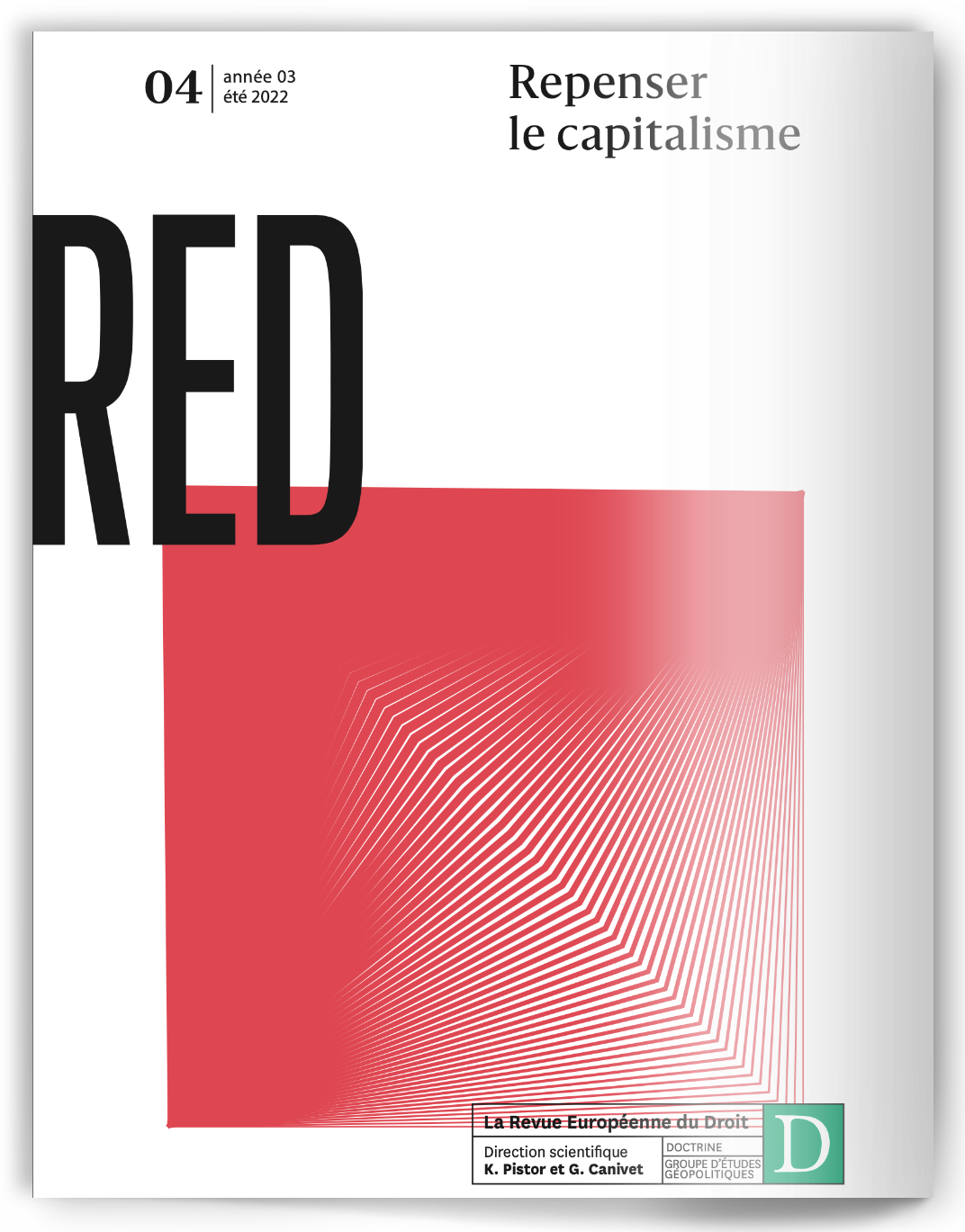
La Revue européenne du droit, été 2022, n°4
Repenser le capitalisme
Les invitations à repenser le capitalisme ont été nombreuses depuis le début de la pandémie et la crise économique qu’elle a entraînée. Est-on selon vous à l’aube d’un changement de modèle ?
La situation actuelle est à la fois très grave, mais par certains côtés elle est paradoxalement plus rassurante que la crise de 2008. En 2008, le système capitaliste pouvait mourir. Là, la question n’est pas là, le système capitaliste ne mourra pas. Les crises économiques comme celles que nous connaissons avec le covid ne sont pas des signes de faiblesse du système capitaliste mais au contraire qu’elles les renforcent et qu’elles accélèrent les grands changements et les progrès : la mondialisation numérique s’accentue, la mondialisation financière continue allègrement avec des niveaux boursiers ahurissants. Forts des expériences passées, les gouvernements et les banques centrales ont aussi su mieux répondre aux défis qui leurs étaient posés.
Il reste néanmoins qu’une page du capitalisme se tourne avec la crise économique liée au Covid-19. On n’a pas mesuré l’étendue des changements macroéconomiques qui sont en train de s’opérer. La révolution qui s’annonce est à la fois immense et très difficile à conceptualiser. Si le capitalisme demeure un état incontournable de la société, « le pire des systèmes à l’exception de tous les autres », il importe de le sauver de ses vieux démons.
Parmi ces « vieux démons », les inégalités économiques, qui ont été renforcées par la crise, paraissent aujourd’hui au cœur de ces contestations.
Il s’agit là d’un paradoxe insupportable : nos sociétés ne cessent de s’enrichir en apparence, mais les inégalités sociales en tirent profit pour s’aggraver. Le rêve de l’après-guerre s’éloigne ainsi de jour en jour : nous avions cru en une grande politique de redistribution des acquêts de la croissance, réussissant à réduire les inégalités économiques, éducatives, culturelles avec pour corollaire la promotion d’une immense classe moyenne absorbant progressivement en son sein l’essentiel des groupes sociaux. Ce processus de mutation sociale avait parfaitement fonctionné de 1945 aux années quatre-vingt.
Toutes les formes d’inégalité se sont accrues depuis, après cette longue période durant laquelle la social-démocratie a modelé l’Occident. L’économie de marché fabrique du même pas de l’efficacité et de l’inégalité ; quand elle tourne à pleine vitesse, la globalisation aidant, elle suscite un maximum d’efficacité et simultanément un maximum d’inégalités. Aujourd’hui, la valeur ajoutée se partage désormais de façon léonine au profit des revenus du capital et aux dépens des revenus du travail. Y remédier suppose soit d’accroître les salaires, soit de transformer les salariés en capitalistes. La première voie trouve rapidement sa propre limite dans les contraintes de la globalisation et la difficulté pour l’économie européenne de conserver un niveau convenable de compétitivité face au reste du monde. La seconde piste est plus prometteuse car elle est susceptible de permettre une distribution intelligente des richesses sans peser sur l’exploitation des entreprises. Il ne s’agit pas seulement de modifier les mécanismes d’intéressement et de participation comme a tenté de le faire de manière non coercitive la loi Pacte, c’est-à-dire la répartition du profit sans changement de propriété, mais d’attribuer des actions aux salariés et d’en faire des propriétaires pour 10 ou 20 % du capital des sociétés.
Il ne s’agit d’ailleurs que de renforcer une spécificité du capitalisme français issue d’une volonté gaullienne d’une association entre le capital et le travail avec la présence d’un actionnariat salarié parfois significatif. Eiffage, Bouygues, Vinci, ou Saint-Gobain ont aujourd’hui pour premier actionnaire leurs salariés et la gouvernance de ses entreprises ne s’en trouve pas amoindrie ni le climat social dégradé, au contraire. Ce qui est aisé à mettre en pratique dans les sociétés cotées en bourse suppose un peu de gymnastique dans les entreprises non cotées : il suffit d’émettre des actions sans droit de vote.
Ces inégalités ne résultent-elles pas en partie de la faiblesse des contrepouvoirs traditionnels ?
Le vrai problème est que le jeu social est déséquilibré. Normalement le jeu social se fait entre l’Etat, le patronat et les syndicats. Dans un pays aussi syndiqué que l’Allemagne, ce sont encore les syndicats des vieilles industries (automobile, sidérurgie) qui donnent le tempo du partage salaire/profit au sein de l’économie classique avec des répercussions dans tous les domaines de la vie sociale. Mais ce match entre détenteurs de capital et détenteurs de la force de travail pour la répartition de la valeur ajoutée devient de plus en plus déséquilibré au fil de la désyndicalisation et de l’ubérisation de l’économie et la dialectique sociale traditionnelle est alors impossible.
Pour ce « lumpenprolétariat » – qui ne bénéficie d’ailleurs que d’emplois très peu qualifiés, très faiblement rémunérés, et très peu productifs – le progrès ne peut venir que de décisions gouvernementales et il revient alors l’Etat de se substituer à la faiblesse syndicale par exemple pour donner des droits élémentaires aux chauffeurs et livreurs d’Uber ou Deliveroo. On retrouve un schéma bismarckien dans lequel il était revenu au Chancelier de fer donnait les premiers droits sociaux en Allemagne.
Ce constat n’est pas d’ailleurs pas propre à l’Europe : la mondialisation souffre de ne connaître ni syndicats à Shanghai, ni grèves à São Paulo, ni compromis social à New Delhi, ni militantisme syndical à Moscou.
Ces préoccupations sociales – et environnementales – ne sont-elles pas prises en compte par les marchés eux-mêmes ?
Après avoir supplanté le capitalisme managérial, le capitalisme patrimonial – modèle enfanté par la mondialisation et la révolution technologique – se voit aujourd’hui concurrencé par l’essor d’un capitalisme de « stakeholders » dont on dessine encore difficilement les traits. S’affrontent désormais deux visions. L’une, traditionnelle défend l’idée selon laquelle l’entreprise appartient à ses actionnaires ; sa vocation et son devoir consistent à produire, en leur nom, du profit. L’autre, qui a le vent en poupe estime qu’au-delà de ses actionnaires, l’entreprise doit prendre en compte toutes les parties prenantes – salariés, clients, riverains, fournisseurs et plus encore l’avenir de l’humanité en contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique. On est loin de l’approche social-démocrate traditionnelle, fondée sur le compromis classique entre les trois joueurs, patronat, syndicats, puissance publique.
Les deux approches sont contradictoires : faire le bien, tout en obtenant la même rentabilité que le capitalisme pur et dur, est un fantasme. Il faut, dans ce cas, reconnaître que l’objectif de profit doit diminuer et avoir l’honnêteté de l’avouer au marché. C’est là que le bât blesse et Emmanuel Faber l’a compris à ses dépens lorsqu’il dirigeait Danone en promettant des résultats financiers qui ne correspondaient pas au projet d’entreprise à mission qu’il s’était proposé de mettre en œuvre. Aucun chef d’entreprise ne peut raisonnablement assumer un tel choix lorsqu’il fait son road show, c’est-à-dire la tournée semi-annuelle de ses investisseurs, des fonds de pension en tout genre. Il consacre un moment à sa gestion traditionnelle, puis un autre à ses responsabilités écologiques, sociétales, morales, mais se garde bien d’avouer que les secondes vont nécessairement affaiblir la première.
Il reste qu’une nouvelle philosophie du pouvoir, venue du monde anglosaxon, surplombe la vie économique, avec les concepts de « governance » et d’« accountability », dont – aveu involontaire sur la difficulté pour la France à se mouvoir dans cet univers – la langue française n’a pas encore trouvé la parfaite traduction. La place des investisseurs institutionnels dans l’actionnariat des principales entreprises françaises oblige néanmoins à un alignement sur les pratiques de gouvernance anglosaxonnes. Ce phénomène prend forme en particulier à travers une plus grande idéologisation des marchés économiques : au-delà des pétitions de principes, l’Etat est aujourd’hui très en-deçà dans son degré d’exigence de celui qu’impose le marché aux entreprises et à leurs dirigeants. La place prise par les investissements dits « responsables » en témoignent, comme les pressions qui pèsent sur les banques pour ne plus financer certains secteurs d’activité, à l’image de ceux liés aux énergies fossiles ou au secteur de la défense. Le fort engagement des dirigeants d’entreprises sur ces questions s’explique moins par les contraintes que les Etats font peser sur leur activité que par leur souci d’améliorer leur relation avec leur environnement financier, c’est-à-dire leurs actionnaires et leurs obligataires. C’est une pression extrêmement forte qui pèse aujourd’hui sur les dirigeants d’entreprises. Cette idéologisation, à travers laquelle les nouvelles pulsions qui animent les sociétés occidentales sont transférées aux entreprises via le marché, est le poids ultime de l’étape actuelle du capitalisme, nous en sommes qu’au début.
Les juges ne sont-ils pas aussi un profond levier de changement ?
La prise en compte des exigences de l’environnement, le respect des normes sanitaires, la protection des salariés, parmi tant d’autres préoccupations réglementaires, sont progressivement passés de l’orbite de l’administration à celle du juge. Ce dernier pratique, vis-à-vis de l’entreprise, un interventionnisme aussi large que possible, sans doute parce qu’il est convaincu de l’impuissance de l’Etat, de l’inefficacité des syndicats et de l’omnipotence de moins en moins contestée, sauf par lui, des acteurs capitalistes. C’est avec les mêmes arrière-pensées qu’il recourt au marteau-pilon de la procédure pénale, plus contraignante, plus médiatisée, donc plus infamante. Rien ne témoigne davantage de cette évolution que la mise en place d’une responsabilité pénale des personnes morales : destinée à se substituer à l’incrimination personnelle des dirigeants, elle s’y est au contraire ajoutée, l’entreprise rejoignant de la sorte son président dans le box des accusés. Les juges se contentent souvent de la mise en examen des responsables et sont indifférents à la suite des procédures, puisque la véritable sanction, le pilori médiatique, aura été prononcée dès ce stade.
Examinée dossier par dossier, procès civil par procès civil, mise en examen par mise en examen, l’intervention du juge peut sembler tatillonne, parfois inique, souvent antiéconomique. Vue de plus haut, à partir d’une approche panoramique des rapports de forces, elle apparaît plus justifiée, dès lors qu’au nom des principes de l’équilibre des pouvoirs, un marché omnipotent a besoin de contrepoids, des dirigeants d’entreprise trop sûrs d’eux d’un minimum d’inquiétude, outre celle que distille le marché boursier, et le capitalisme lui-même de régulateurs. Mais il demeure qu’en démocratie, l’efficacité globale de l’intervention judiciaire ne justifie pas les dérapages individuels et les excès procéduriers.
L’opinion publique n’est-elle pas tout aussi déterminante ?
L’action du juge est en effet d’autant plus solide face au marché qu’ils s’enracinent dans les mouvements de l’opinion publique. On peut continuer à ressasser avec Tocqueville qu’elle est devenue « une pression immense de l’esprit de tous sur l’intelligence de chacun », que « la foi dans l’opinion commune deviendra une sorte de religion, dont la majorité sera le prophète » ou que « l’opinion commune est le seul guide qui reste à la raison individuelle chez les peuples démocratiques ».
Pendant plus de deux siècles, la France a vécu au rythme d’un affrontement entre le marché et l’Etat, comme s’il n’existait que ces deux formes antagonistes d’organisation de la société et de l’économie. Sous la pression idéologique du communisme, des mythes de gauche, de la tradition bonapartiste et des ambiguïtés sociales du gaullisme, c’est le plus souvent l’Etat qui a étendu son territoire aux dépens du marché. Avec l’apparition du capitalisme patrimonial, c’est le marché qui a pris une revanche historique, acculant l’Etat à battre partout en retraite face à un nouvelle ordre réputé irrésistible, irréversible, insubmersible. Mais de nouveaux équilibres de pouvoir en train de s’imposer. Ce n’est plus un couple antagoniste, le marché et l’Etat, qui structure la réalité, mais une nouvelle « Sainte-Trinité » qui réunit le marché, le droit avec son grand prêtre, le juge ; l’opinion publique. Au triptyque à la Montesquieu – exécutif, législatif, judiciaire –, s’en est substitué un autre. L’opinion publique, elle, s’affirme de plus en plus à travers des ONGs qui, grâce à leur dynamisme, leur incroyable aptitude, parce qu’elles fonctionnent culturellement en réseau, à retourner à leur profit la fluidité d’internet, se posent en interlocutrices des grands acteurs capitalistes et politiques, tels des lobbies d’intérêt général.
Une nouvelle logique est, dans ces conditions, à l’œuvre : elle infléchit les critères de gestion des entreprises ; elle change leur mode de gouvernement ; elle soulève une interrogation sur leur nature même. On découvre qu’une multinationale est au moins aussi sujette aux émotions collectives qu’un gouvernement. Mais moins rompus à ce jeu que les politiques, les responsables d’entreprise peinent encore à tenir leur rôle dans une société médiatique où la démocratie d’opinion a pris le pas sur la représentation traditionnelle. Ils devront faire leur apprentissage. Le marché et l’opinion sont les deux maîtres de la société contemporaine : les patrons l’oublieraient-ils, la réalité se chargerait de le leur rappeler.
Dans votre dernier ouvrage, vous vous présentez comme « le dernier marxiste français », quel héritage en gardez-vous ?
L’héritage marxiste est un héritage pluriel. Le marxisme ayant conduit au bolchevisme, au léninisme et à l’échec absolu du communisme est mort. En revanche, l’héritage marxiste a aussi donné naissance à la social-démocratie, mode de gestion consensuel des conflits des classes dont le quoi qu’il en coûte a sans doute constitué l’apogée. Au-delà, s’est à travers se fait la synthèse entre la dynamique capitaliste, le poids de l’Histoire et le fonctionnement de la société. Aucun personnage de l’histoire a pensé simultanément l’histoire, la philosophie, l’économie et la société. Marx est aussi l’esprit qui a le mieux pensé compris, décrit, encensé l’économie de marché, sa puissance, le progrès, l’essor de la bourgeoisie mais aussi les mouvements profonds de la société qui y sont indubitablement liés. Après des décennies de réussite dont les pays scandinaves et plus généralement l’Europe continentale ont constitué un exemple incontesté, la social-démocratie s’est enlisée. Elle s’est laissé dominer par des corporatismes qui ont oublié l’intérêt général au profit des intérêts particuliers. Elle a fabriqué d’énormes machineries bureaucratiques dont l’efficacité s’est révélée autrement plus décroissante que le taux de profit ne l’a été à rebours de la prophétie de Marx. Elle a vu des pans entiers de la société échapper à l’action des syndicats. Elle n’a pas toujours tourné à son avantage les mutations technologiques Et surtout elle n’a pas su s’implanter dans le monde non occidental. C’est sans doute la raison pour laquelle l’économie mondiale vit en déséquilibre.
Dans Le Manifeste du parti communiste, livre supposé militant, Marx fait le plus bel éloge du capitalisme qui existe : il en montre les vertus, en termes de compétitivité, de mondialisation, de progrès technologique. Il rend hommage à la puissance transformatrice que le capitalisme a suscitée chez la bourgeoisie. Il s’est néanmoins trompé sur deux points. Il a sous-estimé la ductilité du système capitaliste. Si le capitalisme a une propension monopolistique, il a su la corriger dès le début du XXe siècle avec le démantèlement de la Standard Oil of New Jersey, en 1911, point de départ de la politique de refus des monopoles. Sa seconde erreur concerne la baisse tendancielle du taux de profit. Elle est annihilée par le progrès technique qui permet des gains de productivité : le taux de profit se maintient, voire s’accroît durant certaines périodes.
Cette ductilité du système capitalisme n’est-elle pas aujourd’hui mise à l’épreuve par la puissance des GAFAM ?
L’immense apport du libéralisme, jamais suffisamment proclamé, réside le couple indissociable du marché et de la règle de droit. Le marché sans la règle de droit, c’est la jungle capitaliste ; la règle de droit sans le marché, c’est le communisme bureaucratique. Il n’existe pas de meilleure illustration de cette situation que la régulation des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) dans le monde contemporain. Laissés à eux-mêmes, ils représentent le point ultime de la dynamique capitaliste encensée par Marx. Révolution technologique, élargissement des marchés à l’échelle du monde entier, création de monopoles de fait : autant d’illustrations du capitalisme en action, version marxiste : on est en train de prendre conscience du caractère systémique de certaines entreprises. Les GAFAM interpellent les puissances publiques différemment parce qu’à la question du monopole s’ajoutent des enjeux liées libertés publiques (à travers la question des données personnelles), à la liberté d’expression ou à la liberté de la presse qui sont des problèmes nouveaux, sans précédents.
De là un enjeu cardinal. Soit les institutions régulatrices américaines et européennes imposent à ces mastodontes des limites comportementales, d’hypothétiques abandons d’activités, et jouent la même partie à plus grande échelle qu’ils ne l’ont fait dans les années quatre-vingt à propos de l’éclatement d’ATT, qui a suivi soixante-dix ans plus tard le coup de théâtre du démantèlement de la Standard Oil of New Jersey dont nous parlions. Soit elles en sont incapables, inhibées par le poids des lobbys, le chantage des acteurs à l’innovation, l’imbrication avec les pouvoirs étatiques. On ne peut pas exclure une forme de démantèlement de certains d’entre eux comme Google et un encadrement par des règles en cours d’élaboration au Parlement européen et qui seront reprises par l’administration Biden en cas de majorité au Congrès.
citer l'article
Alain Minc, « Une page du capitalisme se tourne », Groupe d'études géopolitiques, Août 2022, 212.
à lire dans cette issue
voir toute la revue





