Mieux réguler le capitalisme

Philippe Aghion
Professeur au Collège de France et à la London School of EconomicsIssue
Issue #4Auteurs
Philippe Aghion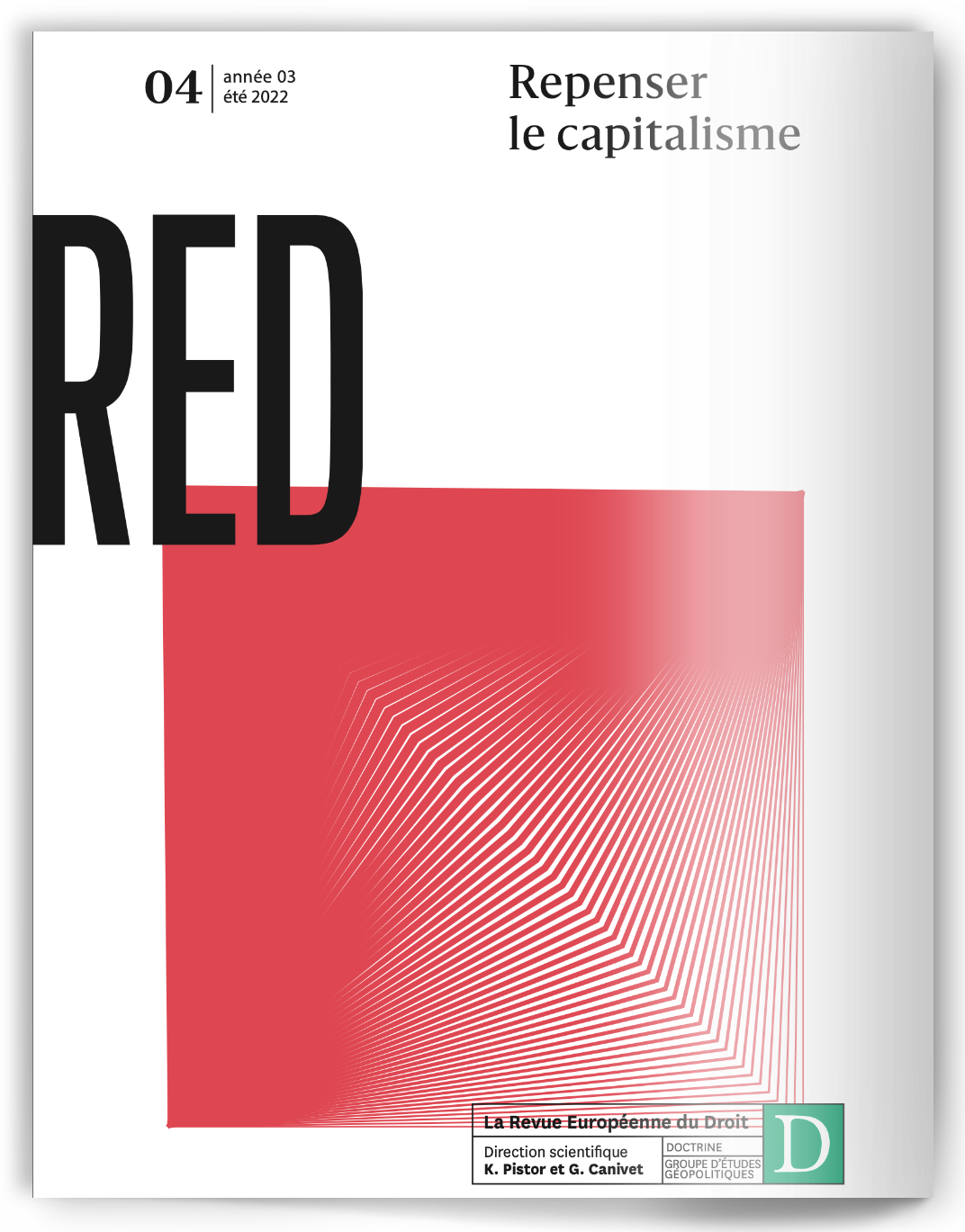
La Revue européenne du droit, été 2022, n°4
Repenser le capitalisme
Les deux dernières années ont été marquées par une littérature extrêmement dense invitant à réinventer ou repenser le capitalisme et nos modèles de société. Que dit selon vous la crise actuelle de notre économie et de notre modèle social ?
Le Covid-19 a agi comme un révélateur d’un certain nombre de dysfonctionnements existants qui affectent le capitalisme tel qu’il est pratiqué à travers le monde. La crise a en particulier mis en exergue l’incapacité du modèle social américain à protéger les plus vulnérables. Beaucoup d’américains ont perdu leur emploi à cause de la pandémie, ont perdu le bénéfice de leur assurance santé à un moment critique et sont tombés dans la pauvreté. En Europe, et en France en particulier, la pandémie a surtout mis en évidence un cruel déficit en matière d’innovation : le pays de Pasteur, de François Jacob et de l’ARN messager s’est révélé incapable de produire un vaccin contre le covid-19, seule voie vers une sortie de crise et la vulnérabilité d’une économie qui est allée trop loin dans la délocalisation de ses chaînes de valeur, y compris dans des secteurs stratégiques comme la santé, a été révélée. En Chine, le Covid-19 a montré les limites d’un capitalisme sans liberté d’expression, où la rétention d’information et l’autocensure ont retardé la prise de conscience de la dangerosité du nouveau virus, ce qui a grandement contribué à sa prolifération. Ces limites nous ont donc brutalement rappelé la nécessité de définir les traits d’une politique plus innovante, protectrice et plus inclusive en conjuguant les forces des capitalismes américain et européen sans se résoudre à une nécessaire dichotomie.
Le capitalisme se retrouve-t-il menacé aujourd’hui ?
Le capitalisme affronte une crise d’identité comme il n’en a jamais connu auparavant. Nul ne peut nier que le capitalisme, particulièrement lorsqu’il n’est pas régulé, a plusieurs conséquences néfastes : il exacerbe les inégalités et permet aux plus forts d’inhiber les faibles ; il peut conduire à des sociétés fragmentées et à une perte de sens de la collectivité ; il précarise le travail, accroissant le stress et détériorant la santé des individus ; il permet aux entreprises en place d’empêcher l’entrée de nouvelles entreprises innovantes par le lobbying ; il aggrave le réchauffement climatique et la détérioration de l’environnement ; il provoque des crises financières qui ensuite génèrent de grandes récessions comme en 1929 ou en 2008.
Pour autant, l’abolition du capitalisme n’est pas la solution. Au cours du siècle dernier, nous avons fait l’expérience d’un système alternatif, celui de la planification centralisée en Union soviétique et dans les pays communistes d’Europe centrale et orientale. Ce système n’a pas permis à ces pays de dépasser un niveau intermédiaire de développement, faute d’offrir aux individus la liberté et les incitations économiques nécessaires pour innover « à la frontière ». Nous avons aussi récemment fait l’expérience de la décroissance mais voulons-nous vraiment adopter durablement le mode de vie qui a été le nôtre pendant le premier confinement ? Le capitalisme est un cheval fougueux : il peut facilement s’emballer, échappant à tout contrôle. Mais si on lui tient fermement les rênes, alors il va là où l’on veut. En dépit d’évolutions favorables, les Etats-Unis sont encore loin d’un système qui protège les individus contre les risques de perte d’emploi ou de maladie, contre les chocs macroéconomiques tels que la crise de 2008 ou celle du Covid-19, ou encore contre le risque climatique. Quant aux pays européens, ils n’ont pas encore su créer l’écosystème – universités, investisseurs institutionnels, venture capitalistes, mécènes, DARPA – qui leur permettrait d’être des initiateurs et non des suiveurs dans les révolutions technologiques à venir, et ils risquent fort de se faire bientôt dépasser par la Chine. Je crois en la convergence de ces modèles plutôt qu’en un dépassement du système capitaliste.
Face à la « montée des inégalités », à « la concentration des rentes », à « la précarisation du travail » ou à « la détérioration de la santé et de l’environnement », vous appelez dans votre dernier ouvrage 1 à une meilleure régulation du capitalisme afin de diriger la destruction créatrice vers l’objectif d’une croissance plus juste et plus verte. Quelles en seraient les caractéristiques essentielles ?
Il faut chercher à mieux réguler le capitalisme plutôt que de vouloir à tout prix le dépasser. La destruction créatrice, qui en est le moteur, a permis une croissance considérable de nos niveaux de vie depuis la première révolution industrielle. Notre principal défi aujourd’hui est de mieux appréhender les ressorts de ce pouvoir pour ensuite l’orienter vers l’objectif d’une croissance plus verte et plus juste : de nouvelles innovations se produisent continuellement et rendent les technologies existantes obsolètes, de nouvelles entreprises viennent constamment concurrencer les entreprises en place, et de nouveaux emplois et activités sont créées et viennent sans cesse remplacer des emplois et activités existants. D’un côté il faut protéger : soutenir les entreprises viables afin de sauver des emplois et préserver le capital humain accumulé mais de l’autre réallouer afin d’encourager l’entrée de nouvelles entreprises et de nouvelles activités, soit plus performantes, soit qui répondent mieux aux besoins des consommateurs.
L’Etat, les entreprises et la société civile forment ici un triangle essentiel pour accompagner, sans empêcher, le processus de destruction créatrice.
L’intervention de l’État est indispensable pour rediriger le changement technique vers l’innovation verte, et ainsi éviter un désastre environnemental : sans se substituer aux entreprises, il doit agir sur les incitations. En l’absence d’intervention de l’État, les entreprises vont spontanément choisir d’innover dans les technologies polluantes et ce, de plus en plus intensément au cours du temps à cause de l’effet de dépendance au sentier. Une étude récente 2 a ainsi montré que les entreprises automobiles ayant innové dans les moteurs à combustion dans le passé tendent à innover dans les moteurs à combustion dans le futur, au préjudice de l’innovation verte. La conséquence sera une hausse de la pollution, et une accélération du réchauffement climatique. La mise en place d’une taxe carbone ou une subvention à l’innovation verte ont pour effet de rendre le changement de technologie moins couteux et de réorienter l’innovation des entreprises automobiles vers les moteurs électriques. Mais l’Etat ne peut être le seul acteur en matière de transition écologique. Il y a des limites à ce que l’État peut accomplir par lui-même, comme l’expliquent Roland Bénabou et Jean Tirole 3 . D’une part, les gouvernants sont souvent exposés au lobbying émanant de différents groupes d’intérêt. D’autre part, le réchauffement climatique est un problème mondial, sur lequel le gouvernement d’un pays particulier n’a que peu de prise.
La société civile peut aussi être à même de jouer un certain rôle, et en particulier les consommateurs, qui semblent vouloir intégrer de plus en plus des considérations sociales et environnementales dans leur choix de produits. Il se trouve en effet que les consommateurs ont le pouvoir d’influer grandement sur choix des entreprises 4 . Ainsi, dans les pays où les consommateurs expriment une véritable préoccupation pour l’environnement, une concurrence accrue sur le marché de l’automobile conduit les entreprises à innover davantage dans les technologies vertes, par exemple les moteurs électriques. L’idée, ici, est intuitive : la concurrence incitant les entreprises à innover davantage pour améliorer leur rapport qualité-prix et échapper à la concurrence des entreprises rivales, dans une économie où les consommateurs valorisent l’environnement et où l’innovation est orientée, une concurrence accrue incite les entreprises à innover pour faire baisser le rapport entre prix et coût environnemental du produit, autrement dit à innover dans la découverte de nouveaux produits plus écologiques pour échapper à la concurrence ; A l’inverse, dans une économie où les consommateurs se soucient davantage du prix des biens que de leur coût environnemental, une concurrence exacerbée ne va pas inciter à l’innovation verte et accentuera le problème environnemental. C’est le « syndrome chinois » : une concurrence accrue fait baisser les prix et augmente la demande des consommateurs ; la production augmente et, partant, la pollution.
Vous présentez d’ailleurs la société civile comme un outil pour garantir la mise en œuvre d’un « contrat incomplet ».
Les constitutions sont des « contrats incomplets », rien ne garantit dans la réalité que ces instruments vont être effectivement mis en place ou activés. Le rôle de la société civile est de donner corps aux contrepouvoirs traditionnels et de faire passer le contrôle de l’exécutif du notionnel à l’effectif. Comme l’ont montré Bowles et Carlin 5 , la société civile a constitué le nécessaire complément au couple « Etats-marchés » pour endiguer l’épidémie de Covid-19. Le rôle déterminant du marché et de la concurrence pour inciter à la découverte de nouveaux traitements et de nouveaux vaccins, le rôle irremplaçable de l’Etat pour gérer la crise sanitaire à court terme notamment à travers le « quoi qu’il en coûte » et pour permettre à l’économie de redémarrer à moyen terme ne doit pas occulter le rôle de la société civile comme troisième pilier -indispensable d’une stratégie de sortie de l’épidémie. La bonne performance coréenne lors de l’épidémie doit beaucoup à l’autodiscipline et à l’esprit civique qui prévalent dans ce pays et qui ont permis de mettre en œuvre très tôt les mesures de distanciation sociale et de prendre en charge les individus contaminés, sans se reposer uniquement sur le pouvoir de l’Etat et sur la coercition.
La mobilisation de la société civile continue donc à faire évoluer le système capitaliste vers un système mieux régulé, plus inclusif et protecteur, et davantage soucieux de l’environnement.
Ce qui semble miner aujourd’hui la cohésion de la société civile ce sont les inégalités. Traditionnellement, il est considéré que c’est la politique fiscale qui est l’outil de prédilection pour la redistribution des richesses, pour que toutes les parties prenantes bénéficient du système économique. Diriez-vous que la politique fiscale reste aujourd’hui le principal instrument de réduction des inégalités ?
L’outil fiscal est certainement indispensable pour stimuler la croissance et la rendre plus inclusive : à la fois parce qu’il permet à l’Etat d’investir dans les leviers de croissance que sont l’éducation, la santé, la recherche et les infrastructures ; et parce qu’il permet à l’Etat de redistribuer les richesses et d’assurer contre les risques individuels (pertes d’emploi, maladie, déqualification) ou macroéconomiques (guerres, crises financières, pandémies).
Mais l’impôt est un levier essentiel mais ne doit pas être considéré comme le seul levier à même de rendre la croissance plus juste. L’innovation est certes une source d’inégalités « en haut » de la distribution des revenus mais l’entreprise innovante est un formidable levier de mobilité sociale dans la mesure où elle permet de former et de promouvoir ses employés, en particulier les moins qualifiés d’entre eux. Une étude récente 6 réalisée à partir de données britanniques sur la période 2004-2015 a pu montrer qu’à tout âge, le salaire d’un individu peu qualifié est substantiellement plus élevé si celui-ci est employé par une entreprise innovante que s’il est employé dans une entreprise moins innovante. On remarque aussi que le salaire augmente beaucoup avec l’âge dans une entreprise innovante. L’Etat peut à son tour stimuler la mobilité sociale en incitant les entreprises innovantes à créer des emplois durables et qualifiants (en anglais on utilise l’expression good jobs) et à invertir réellement dans la formation professionnelle de leurs employés, en particulier les moins qualifiés.
La volonté d’une nouvelle politique industrielle raisonne de plus en plus fortement en Europe. Longtemps restée incontestée, la politique de concurrence européenne doit-elle être revue pour répondre à ces nouvelles ambitions ?
Concurrence et politique industrielle ne sont pas nécessairement antinomiques. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, les champions nationaux ont constitué les fers de lance de la politique industrielle dans de nombreux pays. C’est le cas en France où la politique industrielle a été un pilier de la reconstruction et de la croissance qui a caractérisé les Trente Glorieuses. Aux Etats-Unis elle s’est avérée déterminante, en particulier dans les domaines de la défense, de l’aéronautique et de l’aérospatiale pour acquérir une suprématie par rapport à l’Union soviétique. Si les différentes sources d’inefficacité de l’Etat – liées aux asymétries d’information ou à la possibilité de collusion entre l’Etat et certains acteurs privés – ont conduit à un recul de la politique industrielle, ils ne la disqualifient pas pour autant.
Au-delà des politiques horizontales, destinées à stimuler l’innovation et la croissance dans l’ensemble des secteurs de l’économie (via des investissements dans l’économie du savoir, la formation professionnelle ; ou des réformes du marché des biens et du travail), une politique industrielle verticale peut notamment se voir justifier par certaines rigidités, à l’image du poids des habitudes ou du coût élevé du changement (path dependance).
L’intervention de l’Etat peut aussi venir résoudre des problèmes de coordination et accélérer l’entrée dans des secteurs stratégiques lorsque cette entrée nécessite des coûts importants. C’est précisément la raison du succès des interventions étatiques dans le domaine de l’aéronautique (Boeing, Airbus) où les coûts fixes sont importants et la demande incertaine ou du programme DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) mis en place aux Etats-Unis en 1958 pour faciliter le passage de la recherche fondamentale à celui des applications et de la commercialisation pour les innovations de rupture (Internet, GPS, etc).
Ces interventions étatiques, nécessairement limitatives, doivent se focaliser sur les priorités économiques et sociales qui dictent les choix gouvernementaux (transition énergétique, santé, défense) dans des secteurs concurrentiels à haute valeur ajoutée. La politique industrielle conserve donc un rôle à condition de la rendre compatible avec la concurrence, et plus généralement avec la croissance par l’innovation.
Au-delà du cas de la politique industrielle, le droit de la concurrence doit-il selon-vous être plus largement rénové pour tenir compte des nouvelles caractéristiques de nos économies ?
Tout en affirmant la nécessité d’une politique de concurrence forte en Europe, telle qu’elle est menée par la Comissaire Vestager, il est en effet nécessaire aujourd’hui de revoir nos standards de concurrence. Notre politique est restée trop axée sur les concepts de market definition et de market shares et sur un ensemble de standards de preuve trop rigides. Il faut encourager le passage d’une vision trop passive et statique de la concurrence à une vision plus dynamique propre à encourager l’innovation et les projets industriels d’ampleur. Les mesures de l’intensité de la concurrence doivent être revus. Des secteurs très concentrés, au sein desquels n’opère qu’une seule entreprise, et qui sont néanmoins très concurrentiels dans la mesure où ils constituent des marchés contestables, dans la mesure où tout nouvel offreur serait en mesure d’y entrer librement ou d’en sortir sans surcoût : sur ces marchés, toute augmentation des prix par l’entreprise en place provoquerait immédiatement l’entrée d’une autre entreprise fabriquant le même produit. La décision Alstom Siemens, très mal comprise, doit provoquer un sursaut sur ces sujets.
Les travaux liés aux Digital Markes Act montrent aussi les défis posés par l’économie digitale et le pouvoir dit structurant d’un certain nombre de plateformes digitales qui en raison de leur taille, sont en mesure de limiter de manière significative la capacité des utilisateurs à exercer une activité économique ou à communiquer en ligne. Le premier critère doit être celui de savoir si un acteur empêche ou non l’entrée d’un nouvel acteur ou non sur le marché et donc l’innovation. Par leur nature, certains segments peuvent accueillir moins d’entreprises que d’autres d’où la nécessité d’une analyse par segments en intégrant la notion d’intégration verticale.
Notes
- P. Aghion, C. Antonin, S. Bunel, Le pouvoir de la destruction créatrice, Odile Jacob, 2020.
- P. Aghion, A. Dechezleprêtre, D. Hémous, R. Martin, J. Van Reenen, « Carbon taxes, Path dependency and directed technical change: Evidence from the auto industry » Journal of Political Economy, 2016, 124 (1) p. 1-51.
- R. Bénabou, J. Tirole, “Individual and corporate social responsibility”, Economica, 2010, 77 (305), p. 1-19.
- P. Aghion, R. Bénabou, R. Martin et A. Roulet, « Environmental preferences and technological choices: Is market competition clean or dirty?”, NBER Working Papers, avril 2020, n°26921.
- S. Bowles et W. Carlin, “The coming battle for the COVID-19 narrative”, Voxeu, 10 avril 2020.
- P. Aghion, A. Bergeaud, R. Blundell et R. Griffith, “The innovation premium to soft skills in low-skilled occupations”, mimeo, Collège de France, 2019
citer l'article
Philippe Aghion, Mieux réguler le capitalisme, Groupe d'études géopolitiques, Août 2022, 198-200.
à lire dans cette issue
voir toute la revue





