Changer la raison d’être des sociétés pour rééquilibrer le capitalisme

Rebecca N Henderson
Professeure à la Harvard Business School et chargée de recherche au National Bureau of Economic ResearchIssue
Issue #4Auteurs
Rebecca N Henderson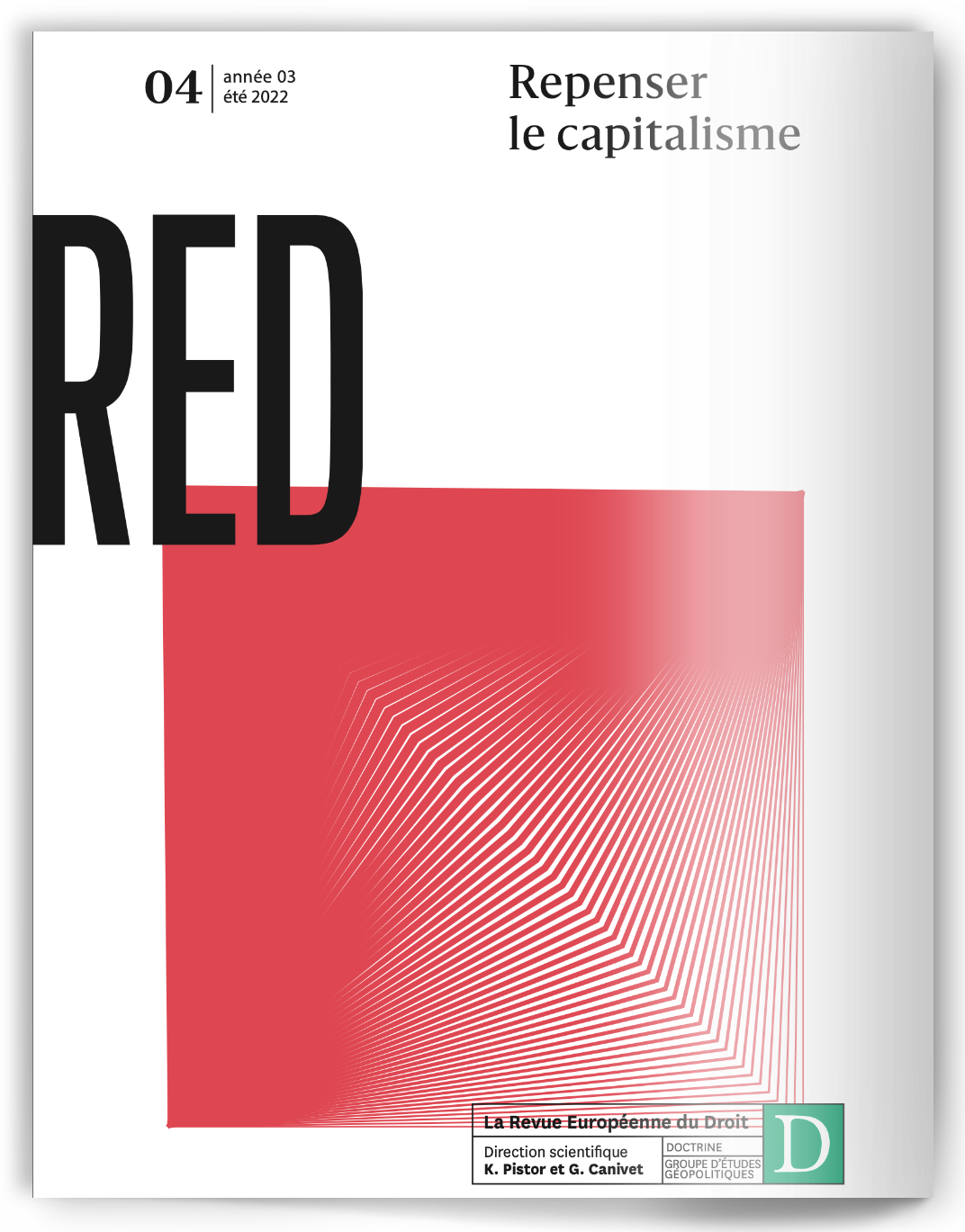
La Revue européenne du droit, été 2022, n°4
Repenser le capitalisme
I. Introduction
Le capitalisme est l’une des grandes inventions de l’humanité 1 . Mais à l’heure actuelle, il ne fonctionne pas pour la grande majorité de la population mondiale. Le changement climatique fait rage, de nombreux écosystèmes mondiaux sont au bord de l’effondrement, les inégalités continuent de s’accélérer et l’exclusion raciale et ethnique systémique caractérise presque toutes les sociétés de la planète.
La clé de la réforme du capitalisme consiste à reconstruire les institutions qui gouvernent et contraignent l’économie. Il est essentiel de revitaliser notre démocratie 2 , de reconstruire un gouvernement démocratiquement responsable et compétent 3 , de renforcer la société civile 4 , de réduire la corruption 5 , et de « recoupler » le capitalisme 6 . Mais si les progrès réalisés sur ces fronts sont d’une importance capitale, ils ne suffiront pas. Nous devons également changer la raison d’être des entreprise — passer de la maximisation de la valeur actionnariale à la « résolution rentable des problèmes publics en évitant de créer de nouveaux problèmes » 7 , afin que le secteur privé puisse devenir un partenaire actif dans la création d’une société juste et durable.
Prenons, par exemple, le cas du changement climatique. Comme le suggère une littérature abondante et vivante, la mise en place d’un régime efficace de tarification des émissions de gaz à effet de serre est plus essentielle que jamais 8 . Mais il est peu probable que cela soit suffisant. Le réchauffement climatique doit être limité à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels afin d’éviter un dérèglement potentiellement dangereux. Cet objectif est presque certainement réalisable d’un point de vue technologique 9 , mais il nécessitera des investissements soutenus au rythme d’environ 3 à 4 % du PIB mondial pendant de nombreuses années, et non seulement la restructuration complète des secteurs de l’électricité, des transports, de la construction et de l’agriculture, mais aussi des changements profonds dans le comportement des consommateurs. L’écologisation complète du réseau électrique, par exemple, nécessitera une multitude d’investissements systémiques — des systèmes de contrôle aux lignes électriques en passant par les systèmes de stockage — et des centaines d’approbations réglementaires. Dans l’environnement politique actuel, il sera très difficile de conduire ce type de changement transformateur sans le soutien actif d’un secteur privé qui s’engage activement à créer de la valeur sociale.
Il sera également beaucoup plus facile de s’attaquer efficacement à l’inégalité et à l’iniquité lorsque l’État et la société civile pourront s’associer à des entreprises qui comprennent que leur raison d’être ne se limite pas à la maximisation des profits. Les entreprises poursuivant une raison d’être sont beaucoup plus susceptibles de mettre en œuvre ce que l’on appelle des « systèmes d’emploi à fort engagement », c’est-à-dire d’augmenter les salaires, de traiter les employés avec dignité et respect, et de s’appuyer largement sur leur motivation intrinsèque 10 . En outre, comme le suggèrent Rodrik et Strancheva 11 et Shafik 12 , pour résoudre le problème des « bons emplois », il faudra établir un nouveau contrat social entre les employés et les entreprises, élaborer des politiques du marché du travail étroitement liées aux employeurs individuels et mettre en œuvre ce que Rodrik et Strancheva décrivent comme un « processus de collaboration stratégique » associé à un « processus de découverte collaborative » pour surmonter le problème du décalage réglementaire et créer des politiques efficaces. Les entreprises qui s’engagent à résoudre les problèmes publics sont beaucoup plus susceptibles d’être des partenaires volontaires dans ce processus.
Que faudra-t-il pour persuader les entreprises d’adopter une raison d’être prosociale, et pourquoi cela pourrait-il faire une si grande différence ?
Dans la plupart des pays du monde, les chefs d’entreprise ont longtemps cru que l’objet de l’entreprise était de maximiser la valeur actionnariale ou, pour reprendre les termes de Milton Friedman, que « la responsabilité (des dirigeants) est de conduire l’entreprise conformément aux (désirs des propriétaires de l’entreprise), qui seront généralement de gagner le plus d’argent possible » 13 . Ce cadre a peut-être été utile par le passé, mais il est aujourd’hui dangereux.
Cette idée repose sur trois piliers fondamentaux 14 . Le premier est que la maximisation du retour sur investissement des actionnaires maximise le bien-être public 15 . Le deuxième est que, puisque la capacité d’un individu à disposer librement de ses ressources et de son temps devrait être l’un des objectifs les plus élevés de la société, les marchés libres sont un fondement important de la liberté individuelle 16 . Le troisième est que, puisque les dirigeants sont les mandataires des investisseurs, ils ont le devoir de gérer l’entreprise comme leurs investisseurs le souhaiteraient — ce qui a été largement supposé la poursuite de tous les profits possibles. De ce point de vue, le fait de ne pas maximiser la valeur actionnariale constituerait non seulement une violation des devoirs des dirigeants, mais également une menace à la fois pour la prospérité et la liberté individuelle 17 .
Mais la maximisation de la valeur actionnariale ne maximise le bien-être social que lorsque les marchés sont pleinement concurrentiels, c’est-à-dire lorsque l’information est complète, que les externalités sont évaluées de manière appropriée, que l’entrée et la sortie sont relativement libres et que les entreprises ne peuvent pas fixer les règles en leur faveur. Ces conditions étaient peut-être à peu près vraies dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, lorsque les gouvernements étaient presque partout populaires et forts, mais elles ne le sont plus aujourd’hui, si tant est qu’elles l’aient jamais été.
Au cours des 50 années qui se sont écoulées depuis que le paradigme de la maximisation de la valeur actionnariale s’est imposé, le monde a changé de façon presque irréversible. Le capitalisme mondial ressemble de moins en moins au modèle classique de marchés libres et équitables sur lequel repose l’injonction de se concentrer uniquement sur la maximisation des profits. Les marchés libres n’exercent leur magie que lorsque les prix reflètent toutes les informations disponibles, lorsqu’il existe une réelle liberté d’action et lorsque les règles du jeu favorisent une véritable concurrence. Dans le monde d’aujourd’hui, de nombreux prix sont complètement détraqués, la liberté d’action est de plus en plus réservée aux personnes bien placées et les entreprises réécrivent les règles du jeu de manière à maximiser leurs propres profits tout en faussant la libre concurrence sur le marché. Si la maximisation de la valeur actionnariale implique de pêcher les océans, de nier la réalité du changement climatique, de lutter contre les politiques qui pourraient permettre une large participation au marché du travail et de corrompre le processus politique, il n’y a aucune raison de croire que cela maximise le bien-être social, la liberté individuelle ou — de plus en plus — répond aux souhaits des investisseurs. Les entreprises dont le seul objectif est la maximisation des profits détruisent de plus en plus la société, au lieu de contribuer à la construire. Il est temps de redécouvrir la vieille idée selon laquelle la raison d’être de l’entreprise devrait être de soutenir l’épanouissement de la société dans laquelle elle s’inscrit.
À quoi cela peut-il ressembler en pratique ? C’est une question qui est en pleine évolution. En août 2019, la Business Round Table — une organisation composée des dirigeants d’un grand nombre des plus grandes et des plus puissantes entreprises américaines — a publié une déclaration redéfinissant la raison d’être des entreprises américaines comme étant de « promouvoir une économie qui sert tous les Américains ». Plus de 180 dirigeants se sont engagés à diriger leur entreprise « dans l’intérêt de toutes les parties prenantes : clients, employés, fournisseurs, communautés et actionnaires ». Presque toutes les grandes sociétés de conseil et cabinets d’audit ont désormais des pratiques consacrées à la promotion de la « raison d’être des entreprises », ou à l’idée que les entreprises devraient chercher à « faire le bien » (do good) en plus de « gagner bien » (do well).
Une grande partie de cette ferveur est très certainement du pur marketing, mais un nombre croissant d’entreprises semblent s’engager véritablement à faire de la poursuite du bien-être social leur objectif premier. En 2010, par exemple, le géant européen Unilever s’est engagé à mettre en œuvre un Sustainable Living Plan, c’est-à-dire à « aider plus d’un million de personnes à améliorer leur santé et leur bien-être, à réduire de moitié l’empreinte environnementale de l’entreprise et à améliorer les conditions de vie de milliers de personnes dans sa chaîne d’approvisionnement » 18 . Natura, la société brésilienne de cosmétiques, affirme que sa « raison d’être » est de « créer et vendre des produits et des services qui favorisent la relation harmonieuse de l’individu avec lui-même, avec les autres et avec la nature » 19 .
Ces entreprises comprennent qu’elles doivent réussir financièrement si elles veulent survivre et attirer des capitaux, mais elles considèrent la rentabilité comme un moyen d’atteindre une fin, et non comme un but en soi, et elles signalent l’authenticité de cet engagement en sacrifiant régulièrement les rendements à court terme au service de la réalisation de leur objectif (prosocial). Par exemple, le jour où Paul Polman a pris la direction d’Unilever, il a exhorté les actionnaires à placer leur argent ailleurs s’ils n’adhéraient pas à ce modèle de création de valeur à long terme, qui est équitable, partagé et durable, et a annoncé qu’Unilever ne publierait plus de prévisions ni de rapports trimestriels sur les bénéfices. Le cours de l’action a chuté d’environ 6 %, réduisant de près de 2,2 milliards de dollars la capitalisation boursière d’Unilever (Paul Polman plaisantait plus tard en disant qu’il avait choisi ce jour-là pour faire son annonce car il pensait qu’il était peu probable que le conseil d’administration le revoque dès son premier jour).
Les entreprises dites « axées sur une raison d’être » ou « orientées vers les intérêts des parties prenantes » peuvent se permettre de prendre ce type d’engagements coûteux pour trois raisons interdépendantes. La première est que les clients et les employés exigent de plus en plus que les entreprises s’attaquent aux problèmes globaux contemporains. S’il est peu probable que les consommateurs paient davantage pour des produits ou des services plus durables, dans certains cas au moins, ils changeront de fournisseur s’ils pensent pouvoir le faire sans sacrifier la qualité ou le prix 20 . De même, de plus en plus d’études qualitatives intrigantes suggèrent que de nombreux employés — en particulier les jeunes — sont de plus en plus disposés à accepter des salaires plus bas pour travailler dans une entreprise qui, selon eux, incarne leurs valeurs 21 .
La deuxième raison est que les entreprises qui poursuivent une raison d’être sont mieux placées pour identifier (et exploiter) les opportunités commerciales que créent nos défis environnementaux et sociaux de plus en plus importants. Par exemple, au début des années 2000, Iberdrola et Enel — deux entreprises qui s’étaient engagées publiquement à « faire le nécessaire » en matière de changement climatique — ont investi massivement dans les énergies renouvelables, alors que les énergies renouvelables étaient nettement plus chères que les centrales traditionnelles à combustibles fossiles et que nombre de leurs concurrents remettaient ouvertement en question l’origine humaine du changement climatique et faisaient activement pression sur la réglementation en la matière. Dix ans plus tard, un changement majeur dans la réglementation européenne des services publics en faveur des énergies renouvelables a réduit de près d’un demi-milliard d’euros les évaluations des 20 principales entreprises européennes de services publics, tandis qu’Iberdrola et Enel sont devenus les leaders du secteur 22 .
Le troisième facteur qui peut rendre abordable l’adoption d’une raison d’être à finalité pro-sociale est l’effet qu’elle a sur la productivité des employés et sur l’agilité organisationnelle. Le fait qu’il existe des différences de productivité importantes et persistantes entre des entreprises « apparemment similaires » est bien documenté 23 . Par exemple, Syverson a constaté qu’au sein des industries à 4 chiffres SIC (Standard Industrial Classification) du secteur manufacturier américain, les usines situées au 90ème centile de la distribution de la productivité sont presque deux fois plus productives avec les mêmes investissements que les usines du 10ème centile. Ces résultats tiennent lorsqu’on contrôle pour la nature de la concurrence, pour la mesure de la production en unités physiques plutôt qu’en revenus, et pour les problèmes de sélection et de simultanéité 24 .
Une source importante de ces différences de productivité est la capacité variable des entreprises à adopter ce que l’on appelle le « travail à haute performance » 25 . En général, les entreprises dotées de systèmes de travail à haut rendement investissent massivement dans le développement des compétences, offrent des niveaux élevés de sécurité de l’emploi, accordent des promotions au mérite et font tout leur possible pour soutenir le travail d’équipe, les modèles de communication denses dans l’ensemble de l’organisation et la résolution locale de tout conflit.
Gibbons et Henderson 26 affirment que ces types de pratiques sont difficiles à adopter — et qu’elles constituent donc une source d’avantage durable — parce qu’elles reposent sur le développement de niveaux élevés de confiance, ou sur des « contrats relationnels » — des contrats fondés sur des critères subjectifs dont l’exécution n’est assurée qu’à la lumière des attentes des parties s’agissant de leur collaboration future — qui ne peuvent être simplement « décrétés » mais qui doivent être construits au fil du temps. Par exemple, Spector et McCarthy 27 affirment que, pendant de nombreuses années, le « manuel de l’employé » du détaillant Nordstrom (qui connaît un grand succès) consistait en un seul paragraphe :
Bienvenue chez Nordstrom
Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Notre objectif numéro un est de fournir un service client exceptionnel. Fixez vos objectifs personnels et professionnels à un niveau élevé. Nous avons une grande confiance dans votre capacité à les atteindre.
Les règles de Nordstrom : Règle n° 1 : Faites preuve de discernement dans toutes les situations.
Il n’y aura pas de règles supplémentaires.
N’hésitez pas à poser toute question à votre chef de service, votre directeur de magasin ou votre directeur général de division à tout moment.
Gibbons et Henderson suggèrent que le type de comportement qu’une telle annonce est censée susciter ne peut être obtenu par le biais d’un contrat formel, puisque, par définition, il n’est pas possible de savoir à l’avance quelle forme prendra cet « exercice du discernement ». Les employés doivent croire que les managers récompenseront des comportements inédits. Ils ont donc besoin de « clarté » et « crédibilité » — où la clarté est un ensemble partagé de croyances sur la nature du monde, la stratégie de l’entreprise et les effets probables d’un ensemble d’actions plausibles sur les résultats possibles, et la « crédibilité » est une croyance informée que — toutes choses égales par ailleurs — les parties au contrat relationnel sont susceptibles de respecter leurs engagements, ce qui implique que les contrats relationnels nécessitent des engagements coûteux et continus dans le temps comme gage d’un « bon comportement » 28 . Dans des travaux antérieurs, j’ai soutenu que ce processus est susceptible d’être beaucoup plus facile dans les entreprises qui poursuivent des objectifs autres que la maximisation des profits, à la fois parce que les employés sont plus susceptibles de comprendre les stratégies de leur employeur et parce que les entreprises sont plus susceptibles d’attirer des individus prosociaux, et il est beaucoup plus facile de créer les conditions d’un environnement coopératif lorsqu’un nombre significatif de parties impliquées ont une préférence claire pour les comportements coopératifs 29 .
Ces effets sont susceptibles d’être renforcés par le fait que l’adhésion d’une entreprise à des valeurs prosociales crée souvent un sentiment de sens et d’identité partagé par les employés. La conviction que le travail accompli a un sens est l’une des principales « motivations intrinsèques », et un élément déterminant pour un travail plus qualitatif et plus créatif 30 . Elle peut également créer un fort sentiment d’identité partagée, autre source importante de motivation intrinsèque 31 . Dans la mesure où la poursuite de cet objectif partagé permet aussi aux employés de vivre une vie authentique — c’est-à-dire en accord avec leurs valeurs les plus profondes — il augmente également leurs émotions positives, ce qui est fortement corrélé à la capacité de voir de nouveaux liens, de développer de nouvelles compétences, de rebondir après des moments difficiles et d’être plus résistant aux défis ou aux menaces 32 .
En bref, un nombre important d’études corrobore l’idée selon laquelle l’engagement authentique d’une entreprise envers des objectifs prosociaux permet non seulement de recruter et d’attirer plus facilement des clients et d’identifier de nouvelles opportunités de croissance liées à la durabilité, mais est également susceptible d’accroître la productivité et la créativité de ses employés. En effet, une abondante littérature suggère qu’en moyenne, il n’y a aucune raison de croire que les entreprises poursuivant des objectifs autres que la maximisation des profits soient moins performantes que leurs concurrentes 33 , et certaines raisons de penser qu’elles peuvent en fait être plus rentables 34 .
II. Pourquoi les entreprises dotées d’une raison d’être peuvent-elles contribuer à un changement systémique ?
Les entreprises commerciales ne peuvent pas résoudre à elles seules des problèmes tels que le changement climatique ou l’inégalité, car il y a beaucoup trop de problèmes qui ne peuvent pas être abordés de manière efficace et qui ne peuvent être résolus que par la réglementation. La construction d’une économie juste et durable nécessitera, comme je l’ai suggéré au début, de reconstruire nos institutions. Mais il y a au moins trois façons dont les entreprises commerciales pourraient être utiles.
La première réside dans leur capacité à catalyser le changement au sein des différents secteurs. La décarbonisation des systèmes de transport dans le monde, par exemple, nécessitera une multitude d’innovations systémiques et un engagement étroit avec les autorités locales et nationales. Même en présence d’une réglementation solide et bien conçue, il sera difficile de persuader les entreprises d’adopter ce type de changement radical 35 . Les grandes entreprises qui réussissent développent des cultures, des processus organisationnels et des structures d’incitation qui reflètent les besoins de leurs activités existantes. Les entreprises établies — en particulier lorsqu’elles sont excessivement concentrées sur la nécessité de générer des profits financiers à court terme — ont souvent de grandes difficultés à comprendre la façon dont le monde évolue et à agir de manière nouvelle 36 .
De nombreuses recherches suggèrent que les entreprises poursuivant des objectifs autres que financiers sont idéalement placées pour être les pionnières de ce type d’innovation systémique. Comme je l’ai suggéré plus haut, leur engagement en faveur d’une finalité plus large est susceptible de les alerter sur l’importance de ces changements, puisqu’elles sont susceptibles d’avoir une vision beaucoup plus large de leur secteur et sont souvent dirigées par des leaders qui possèdent ce que le psychologue Robert Kegan a appelé un esprit « autotransformateur » et la capacité de voir les systèmes comme malléables et capables de transformation systémique 37 .
Les entreprises qui maîtrisent l’innovation systémique doivent être « ambidextres » — c’est-à-dire qu’elles doivent être capables de combiner, d’une part, la capacité de jongler avec la nécessité de s’occuper des affaires courantes, et, d’autre part, la capacité de gérer les unités dynamiques, qui évoluent plus rapidement, qui sont nécessaires pour incuber des changements profonds. Cette capacité exige de l’équipe dirigeante qu’elle développe une vision partagée de l’état du monde et de la stratégie de l’entreprise, qu’elle la communique efficacement au reste de l’organisation et qu’elle gère l’entreprise par un mélange judicieux de mesures subjectives et objectives qui doivent être constamment mises à jour 38 . Les caractéristiques qui font que ces entreprises sont susceptibles d’être plus productives que leurs rivales sont également susceptibles de faciliter considérablement ce processus 39 .
Les entreprises dotées d’une raison d’être s’avèrent également être des leaders dans la mise en place des efforts de coopération public-privé qui sont également essentiels pour progresser. Leur engagement à faire ce qui est juste les incite souvent à essayer de persuader leurs concurrents de les rejoindre dans la lutte contre les problèmes sociaux. Unilever, par exemple, s’est initialement engagé à n’acheter que de l’huile de palme cultivée de manière durable, car il tenait à protéger sa marque et la viabilité à long terme de sa chaîne d’approvisionnement. Mais l’huile de palme issue de l’agriculture durable s’est avérée coûteuse, si coûteuse que l’entreprise ne pouvait se permettre de respecter son engagement que si ses concurrents acceptaient de prendre le même engagement. Unilever a réussi à persuader les acheteurs de plus de 65 % de l’huile de palme commercialisée dans le monde de coopérer pour tenter de réduire la déforestation, amorçant ainsi un processus d’engagement public-privé qui se poursuit à ce jour 40 . Comme le suggèrent les recherches d’Ostrom, il est difficile mais tout à fait possible de maintenir ce type d’efforts d’autorégulation, et les entreprises dotées d’une raison d’être sont souvent incitées à investir l’effort nécessaire pour construire des ponts et développer de mesures communes essentiels pour atteindre leur objectif 41 .
Enfin et surtout, les entreprises dotées d’une raison d’être sont souvent incitées à soutenir les types de réglementation qui améliorent le bien-être social et à défendre les institutions qui peuvent les générer. Les entreprises qui ont pris des engagements ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, seront nettement mieux loties si les gouvernements peuvent être persuadés d’adopter une réglementation contraignante en matière de carbone. Ce n’est certainement pas une coïncidence si bon nombre des entreprises qui plaident le plus visiblement en faveur de la réglementation climatique sont également celles qui s’engagent publiquement en faveur d’objectifs sociaux et si certaines d’entre elles sont de plus en plus disposées à défendre les droits de vote et la vigueur de la démocratie 42 .
III. Implications pour l’action publique
Si changer les objectifs poursuivis par les entreprises est si essentiel, comment y parvenir ? Je me concentre ici sur trois leviers qui pourraient s’avérer utiles : des changements dans les normes comptables et dans les critères utilisés pour gouverner les entreprises, des changements dans le droit des sociétés et, enfin et surtout, des changements dans le cadre normatif et culturel dans lequel les entreprises opèrent.
Une modification des critères de contrôle
Pour changer les objectifs poursuivis par les entreprises, il faut changer les critères utilisés pour mesurer et contrôler leur gestion. Sans mesures matérielles, vérifiables et reproductibles de l’impact environnemental et social de l’entreprise, il sera impossible de demander des comptes aux entreprises à vocation sociale. Pour convaincre les clients d’acheter chez elles ou les employés de travailler pour elles parce qu’elles sont authentiquement engagées en faveur du bien social, les entreprises poursuivant une raison d’être doivent être en mesure de communiquer de manière crédible qu’elles ont effectivement un impact positif (ou qu’elles s’abstiennent véritablement de causer des dommages). Il est essentiel de disposer de meilleures mesures pour que ces entreprises puissent impacter les motivations privées de leurs employés et mesurer les progrès qu’elles accomplissent vers leurs objectifs.
De nouvelles mesures sont également essentielles si l’on veut changer la nature de la conversation entre les entreprises et les investisseurs. Les chefs d’entreprise se plaignent souvent que la dynamique du marché des capitaux est telle qu’ils ne peuvent pas réaliser les types d’investissements à long terme qui sont nécessaires s’ils veulent investir dans la création de valeur sociale. En octobre 2015, par exemple, lorsque Doug McMillon, le PDG de Walmart, a annoncé que les ventes de l’entreprise seraient stables pour l’année et que le bénéfice par action baisserait de 6 à 12 %, la valeur de l’action a chuté de près de 10 %, emportant avec elle environ 20 milliards de dollars de capitalisation boursière. M. McMillon a tenté d’expliquer que la baisse des bénéfices reflétait non seulement un investissement de 2 milliards de dollars dans le commerce électronique, mais aussi un investissement de près de 3 milliards de dollars dans la rémunération des employés — un investissement qui, selon lui, améliorerait non seulement les performances de l’entreprise en augmentant considérablement l’engagement des employés, mais qui était également un premier pas essentiel dans la lutte contre les inégalités croissantes — mais Wall Street n’a pas été impressionnée. Les actions de Walmart sont toujours détenues majoritairement par la famille Walton, qui a fortement soutenu la décision, et McMillon a donc conservé son poste, mais de nombreux PDG craignent de ne pas avoir autant de chance dans des circonstances similaires. Tant que les entreprises ne pourront pas faire état de mesures crédibles d’actifs tels que la « réputation » et l’ « engagement » et/ou de mesures crédibles de leur « impact », il sera difficile pour les entreprises dotées d’une raison d’être de persuader les investisseurs de les soutenir.
De meilleures mesures sont également essentielles si les investisseurs doivent demander aux entreprises de rendre compte de leur impact sur le monde en général. Selon certaines mesures, près d’un tiers du capital investi publiquement prétend chercher à investir dans des entreprises qui minimisent leur impact environnemental et maximisent leur contribution sociale. Sans de bonnes mesures de l’impact d’une entreprise dans ces deux domaines, les investisseurs seront incapables d’allouer leurs capitaux de la manière dont ils le souhaitent — et les entreprises dotées d’une raison d’être seront incapables d’attirer les capitaux dont elles ont besoin.
Dans le cas de la très grande majorité des actions cotées en bourse qui sont détenues par des gestionnaires d’actifs professionnels, de bonnes unités de mesure permettront également aux investisseurs de traduire leur souci du long terme et des performances sociales et économiques dans des instructions spécifiques pour les gestionnaires en charge de leurs investissements. Bon nombre d’investisseurs — les employés qui épargnent pour leur retraite ou les parents qui épargnent pour l’éducation de leurs enfants — ont à la fois des horizons temporels beaucoup plus longs que leurs gérants d’actifs et un fort intérêt à s’assurer que les entreprises se comportent de manière éthique et durable.
L’élaboration de ce type de mesures ne sera pas facile. Des centaines d’indicateurs dits « ESG » (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont utilisés, dont beaucoup sont spécialisés dans des secteurs particuliers, et peu sont régulièrement audités ou comparables entre entreprises. Mais la situation est en train de changer. Des groupes tels que le Sustainability Accounting Standards Board ont investi massivement dans l’élaboration de normes utiles, et une proposition récente des IFRS (International Financial Reporting Standards, l’organisme qui définit les normes internationales d’information financière pour le monde entier) suscite une très grande attention et un fort soutien de la part des plus grandes banques et auditeurs du monde. Une politique publique appropriée pourrait jouer un rôle puissant dans l’accélération de ce processus.
Un changement des lois existantes
De nombreux dirigeants — en particulier dans la sphère anglo-américaine — pensent que leur devoir fiduciaire les oblige à maximiser la valeur actionnariale. En réalité, c’est rarement le cas. Nulle part dans le monde, les entreprises ne sont légalement tenues de maximiser les profits des investisseurs et, en général, il est tout à fait légal pour les entreprises cotées en bourse d’adopter d’autres objectifs prosociaux.
En vertu de la loi de l’État du Delaware, par exemple, les administrateurs ont des obligations fiduciaires de soin, de loyauté et de bonne foi envers la société et ses actionnaires. Cela signifie que les administrateurs peuvent — et doivent — parfois prendre des décisions qui ne maximisent pas la valeur actionnariale à court terme afin de poursuivre la réussite à long terme de l’entreprise. Les administrateurs américains confrontés à des offres publiques d’achat hostiles le font régulièrement, en refusant des offres qui valorisent l’entreprise à un prix nettement supérieur au cours actuel de l’action, s’ils sont convaincus que le changement de contrôle ne serait pas dans l’intérêt à long terme de la société. Il est probablement illégal de prendre une décision de gestion qui détruirait certainement la valeur actionnariale à long terme, mais, à l’exception de quelques situations étroitement définies, comme lorsqu’ils se sont engagés à vendre l’entreprise et que les « obligations Revlon » sont invoquées, les administrateurs sont protégés par la règle du business judgment rule et peuvent adopter un objectif prosocial s’ils peuvent démontrer de manière convaincante qu’il augmentera la valeur de l’entreprise à long terme.
Néanmoins, dans presque toutes les juridictions, les investisseurs restent très largement maîtres de la société, et leur capacité à remplacer les administrateurs à volonté rend de nombreux dirigeants réticents à s’engager publiquement en faveur d’un objectif prosocial. Comme je l’ai suggéré plus haut, améliorer la capacité à mesurer à la fois la présence et l’impact d’un tel objectif serait certainement utile, tout comme le serait le fait de modifier les règles qui régissent les actionnaires activistes pour rendre leurs actions plus transparentes, d’augmenter la période obligatoire de détention pour appliquer le régime d’imposition sur les gains en capital à long terme, de d’établir une modeste taxe sur les transactions financières 43 . Mais une modification du droit des sociétés pourrait également faire une différence significative.
Une option consiste à exiger des dirigeants qu’ils tiennent compte du bien-être des autres parties prenantes lorsqu’ils prennent des décisions. Par exemple, le principe B du nouveau code britannique de gouvernance d’entreprise stipule que « le conseil d’administration doit définir la raison d’être, les valeurs et la stratégie de l’entreprise, et s’assurer que ceux-ci et sa culture sont alignés ». Le projet de la British Academy sur l’avenir de la société (Project on the Future of the Corporation) suggère que les administrateurs des sociétés soient tenus de définir la raison d’être de leur entreprise, d’agir de manière à promouvoir la réalisation de cette finalité et de tenir compte des conséquences de toute décision sur les intérêts des actionnaires et des parties prenantes 44 .
Bien que ce type de recommandations puisse sembler relativement inoffensif dans la mesure où il laisse le contrôle de l’entreprise aux investisseurs, il pourrait jouer un rôle important en rassurant les dirigeants sur le fait qu’ils ne peuvent pas être pénalisés pour avoir pris en compte les besoins des autres parties prenantes, et en changeant la nature de la conversation au sein de l’entreprise et entre l’entreprise et ses investisseurs. La croyance répandue selon laquelle l’accent mis sur la création de valeur sociale réduira la rentabilité financière est autant un artefact idéologique ou culturel qu’une appréciation de bonne foi de la stratégie à adopter à long terme. Le fait de forcer les entreprises à se demander activement si l’adoption d’une perspective plus large ne serait pas en fait dans l’intérêt à long terme de l’entreprise — ainsi que de ses parties prenantes — pourrait jouer un rôle important dans l’évolution de la conversation et de l’attention qui sont fondamentales pour un changement systémique à long terme.
Une autre possibilité consiste à exiger des entreprises qu’elles deviennent des « sociétés à mission » (benefit corporation) 45 . Les benefit corporations sont légalement tenues de poursuivre le bien public tout en cherchant à offrir à leurs investisseurs des rendements décents. Elles doivent publier une stratégie décrivant la manière dont elles prévoient d’y parvenir et produire chaque année un rapport (soumis au contrôle des auditeurs) détaillant leurs progrès vers la création du bien public qu’elles ont promis de créer. Les membres du conseil d’administration sont tenus de prendre en compte les intérêts collectifs dans toutes les décisions qu’ils prennent.
Il est essentiel que, lorsque les administrateurs se sont engagés à vendre l’entreprise, ils puissent choisir l’acheteur qui créera le plus de valeur pour toutes les parties prenantes de l’entreprise, plutôt que celui qui offre le plus d’argent aux actionnaires actuels. Dans une entreprise conventionnelle, le fait de savoir qu’il existe toujours un risque que les administrateurs soient contraints de vendre l’entreprise au mieux disant peut rendre beaucoup plus difficile la réalisation du type d’investissements à long terme — instaurer la confiance, bien traiter ses employés — dont la valeur pourrait être ignorée dans une guerre d’enchères. De plus, le fait que les entreprises conventionnelles soient soumises aux caprices des marchés financiers en fait des partenaires peu dignes de confiance, ce qui peut à son tour rendre beaucoup plus difficile l’établissement de relations de confiance à long terme qui sont si essentielles à la création d’entreprises dotées d’une raison d’être. Les benefit corporations sont donc bien placées pour jouer un rôle important dans la démonstration de la manière dont les entreprises dotées d’une raison d’être peuvent créer à la fois des avantages sociaux et privés.
Toutefois, ce modèle dépend fortement de la capacité de l’entreprise à attirer des investisseurs qui partagent l’objectif affiché par l’entreprise ou qui pensent que ce mode de fonctionnement est un moyen fiable d’accroître sa rentabilité. Dans une entreprise commerciale, les investisseurs détiennent tout le pouvoir. Eux seuls peuvent élire les administrateurs. Eux seuls peuvent intenter une action en justice pour faire respecter les objectifs affichés. Obliger chaque entreprise à devenir une benefit corproation pourrait constituer un énorme pas en avant vers la création d’un univers d’entreprises axées sur des valeurs plus larges, mais risque de créer un monde dans lequel les investisseurs ne se préoccupent que du bout des lèvres de la création d’un bien public et ne font que recréer dans les faits des entreprises conventionnelles.
Une autre possibilité, bien sûr, est de réduire simplement le pouvoir des investisseurs et de confier le contrôle de l’entreprise aux employés, aux clients ou à une forme de fiducie ou de fondation. Toutes ces formes sont clairement viables : Mondragon, l’une des entreprises espagnoles les plus prospères au niveau mondial, est détenue par ses employés, les coopératives agricoles américaines détenues par leurs clients ont un chiffre d’affaires d’environ 120 milliards de dollars et Novo Nordisk, une entreprise pharmaceutique dont l’actionnaire majoritaire est une fondation qui se consacre à la poursuite du bien public à long terme, a connu un énorme succès. Ce sont tous des modèles qui méritent d’être explorés, et la réduction des obstacles juridiques et réglementaires qui rendent leur création difficile pourrait favoriser une vague d’expérimentation qui pourrait être immensément précieuse. Cependant, il n’est pas encore certain qu’ils puissent accéder efficacement aux marchés de capitaux modernes à grande échelle, ce qui pourrait limiter leur portée.
Une approche potentiellement complémentaire à l’une de ces mesures consiste à modifier les règles qui définissent les obligations fiduciaires des gestionnaires d’actifs. Les gestionnaires d’actifs agissent en tant que mandataires des propriétaires des actifs qu’ils gèrent, mais ces propriétaires n’ont souvent pratiquement aucun contrôle sur la manière dont leur mandataire investit et, dans de nombreux cas, il est possible qu’ils souhaitent que leur argent soit investi dans des entreprises qui se consacrent à la création de valeur sociale. En réponse, Leo Strine, ancien président de la Cour suprême du Delaware, a suggéré que les investisseurs institutionnels soient tenus de prendre en compte les objectifs et horizons d’investissement spécifiques de leurs bénéficiaires effectifs dans le cadre de leurs obligations fiduciaires, et d’expliquer « comment leurs politiques de vote et autres pratiques de gestion garantissent l’accomplissement fidèle de leurs nouvelles obligations fiduciaires et tiennent compte des nouvelles informations communiquées par les grandes entreprises sur les questions relatives aux employés, à l’environnement, à la société et à la gouvernance » 46 .
Un changement de normes
En fin de compte, comme le suggèrent Bowles et Carlin 47 , persuader les entreprises de se concentrer autant sur la création de valeur sociale que sur la création de valeur financière nécessitera non seulement des changements importants dans les normes comptables et dans le droit des sociétés, mais aussi des changements majeurs des normes sociales du milieu des affaires et de la société au sens large.
En Allemagne, par exemple, un système dédié au bien-être de l’ensemble de la communauté a généré de forts rendements économiques, d’importants investissements dans la protection de l’environnement et de très faibles niveaux d’inégalité. Le droit allemand des sociétés diffère sensiblement du droit anglo-américain des sociétés en exigeant une « codétermination » active et, par exemple, la présence de représentants des employés dans les conseils d’administration des sociétés dépassant une certaine taille, mais l’engagement général en faveur du bien-être de toutes les parties prenantes s’appuie également sur un fort consensus social autour de l’idée qu’il s’agit effectivement de la meilleure manière de gérer les entreprises, partagé par des investisseurs qui ont une profonde expérience de son succès et qui s’engagent à la maintenir, et soutenu par une forte pression exercée par un mouvement syndical puissant et un gouvernement compétent et puissant.
Au Japon, en revanche, l’engagement fort en faveur d’un capitalisme soucieux des intérêts de toutes les parties prenantes a été initialement très fructueux mais a récemment été critiqué pour avoir contribué aux faibles performances récentes du Japon. Après la Seconde Guerre mondiale, le milieu des affaires a explicitement adopté un modèle de capitalisme qui mettait l’accent sur le bien-être des employés, un intérêt pour les performances à long terme, un engagement étroit avec les fournisseurs et une attention presque obsessionnelle pour les intérêts des clients. Cela été complété par des relations étroites avec quelques grands investisseurs qui ne jouaient généralement aucun rôle formel dans la gouvernance de l’entreprise. Les entreprises japonaises se procuraient la majeure partie de leurs capitaux auprès des banques et, dans la plupart des entreprises, le conseil d’administration était composé exclusivement d’initiés (insiders) et présidé par le directeur général. Si de nombreuses entreprises étaient cotées en bourse, elles étaient protégées de la menace d’une prise de contrôle hostile par un système complexe de participations croisées entre les entreprises.
Cette approche a permis aux entreprises japonaises de conquérir le monde avec des produits innovants, à faible coût et d’une qualité inégalée, et entre 1960 et 1995, le PIB du Japon a connu une croissance extraordinaire. Mais le marché boursier japonais a connu des difficultés depuis lors, l’écart entre le PIB japonais par heure travaillée et la moyenne du G7 n’a cessé de se creuser, et en 2016, les taux de croissance de la productivité au Japon étaient tombés à environ la moitié de ceux des États-Unis et de l’Europe. De nombreux experts imputent ces faibles taux de rendement à un système de gouvernance d’entreprise qui protège de nombreux PDG japonais de la pression des investisseurs qui pourrait les obliger à réaffecter le capital à des usages plus productifs, ce qui suggère que la manière dont les modèles de gouvernance orientée vers les intérêts de toutes les parties prenantes (stakeholder approach) sont mises en œuvre, et les attentes sociales qui entourent les entreprises, comptent tout autant que les détails de la loi.
Au niveau mondial, aider les entreprises à trouver le bon équilibre entre un engagement envers les investisseurs et un engagement envers le bien-être de la société au sens large prendra du temps. Cela sera grandement facilité par les types de changements sociaux et politiques préconisés ici — par la revitalisation de la démocratie, par l’émergence d’une sorte de plateforme pour l’expression des préférences des employés, et par un engagement renouvelé envers un gouvernement compétent et démocratiquement responsable. Mais les entreprises poursuivant des objectifs fondés sur des valeurs pourraient être des partenaires importants pour mener à bien ce programme.Un changement généralisé des raisons d’être des entreprises pourrait avoir bien plus que des effets locaux — même si ces derniers sont importants. Les entreprises dotées d’une raison d’être peuvent devenir un modèle pour de nouvelles façons de traiter les employés — augmenter les salaires, traiter les gens avec dignité et respect, et s’appuyer sur la motivation intrinsèque, plutôt que sur les menaces ou la peur, pour motiver les comportements. Elles peuvent catalyser le changement à travers les industries, en persuadant les entreprises moins visionnaires que la résolution des problèmes sociaux peut être un moteur important de la croissance économique. Elles ont la motivation, les compétences et les antécédents nécessaires pour cultiver la coopération entre les entreprises, et la coopération entre les entreprises, les gouvernements et les communautés locales — une coopération qui peut résoudre des problèmes qu’aucun acteur ne pourrait résoudre seul. Le secteur privé est l’une des institutions les plus puissantes de la planète, et il exerce une influence considérable sur des millions de vies. Une enquête récente suggère que l’institution à laquelle les gens font le plus confiance est l’entreprise pour laquelle ils travaillent 48 . Les entreprises dotées d’une raison d’être peuvent contribuer à faire évoluer les valeurs culturelles, les visions partagées et les valeurs profondément ancrées. Nous avons besoin d’un changement institutionnel à grande échelle et d’une refonte fondamentale de nos cadres normatifs. Nous avons besoin que les entreprises s’engagent à aller au-delà de la simple maximisation du profit.
Notes
- Une version de cet article a été publiée pour la première fois dans Oxford Rev. Econ. Policy, vol. 37, numéro 4, hiver 2021, pages 838-850 (https://doi.org/10.1093/oxrep/grab034).
- Levi, M. (2021), ‘Capitalism : What Has Gone Wrong ? How Can It Be Fixed ?’, Oxford Review of Economic Policy, 37(4), 773-82.
- Admati, A. (2021), ‘Capitalism, Laws and the Need for Trustworthy Institutions’, Oxford Review of Economic Policy, 37(4), 678-89 ; Levi, M. (2021), ‘Capitalism : What Has Gone Wrong ? How Can It Be Fixed ?’, Oxford Review of Economic Policy, 37(4), 773-82.
- Bowles, S., et Carlin, W. (2021), ‘Shrinking Capitalism : Components of a New Political Economy Paradigm’, Oxford Review of Economic Policy, 37(4), 794-810.
- Admati, A. (2021), ‘Capitalism, Laws and the Need for Trustworthy Institutions’, Oxford Review of Economic Policy, 37(4), 678-89.
- Kelly, C., et Snower, D. (2021), ‘Capitalism Recoupled’, Oxford Review of Economic Policy, 37(4), 851-63.
- Mayer, C. (2018), Prosperity : Better Business Makes the Greater Good, Oxford, Oxford University Press ; Mayer, C. (2019), ‘The Future of the Corporation : Principles for Purposeful Business’, Rapport de la British Academy sur l’avenir de la société, disponible sur https://www.thebritishacademy.ac.uk/publications/future-of-the-corporation-principles-for-purposeful-business/.
- Aldy, J., et Stavins, R. (eds) (2007), Architectures for Agreement, Cambridge, Cambridge University Press.
- Goodall, C. (2020), What We Need To Do Now, Londres, Profile Books.
- Henderson, R. (2020a), Reimagining Capitalism in a World on Fire, New York, Hachette, PublicAffairs.
- Rodrik, D., et Stantcheva, S. (2021), ‘Fixing Capitalism’s Good Jobs Problem’, Oxford Review of Economic Policy, 37(4), 824-37.
- Shafik, M. (2021), ‘Capitalism Needs a New Social Contract’, Oxford Review of Economic Policy, 37(4), 758-72.
- Friedman, M. (1970), ‘The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits’, New York Times, 13 septembre 1970.
- Pour une histoire intellectuelle, voir Burgin, A. (2012), The Great Persuasion: Reinventing Free Markets since the Depression, Cambridge, MA, Harvard University Press.
- Pour une première articulation de ce modèle, voir Stigler, G. (1952), The Theory of Price, Londres, Macmillan.
- Friedman, M. (1962), Capitalism and Freedom, Chicago, IL, University of Chicago Press.
- Jensen, M., et Meckling, W. (1976), ‘Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure’, Journal of Financial Economics, 3(4).
- Voir le rapport annuel 2010 d’Unilever, disponible à l’adresse https://www.unilever.com/Images/unilever-ar10_ tcm244-421849_en.pdf.
- https://www.naturabrasil.com/pages/about-us
- Henderson, R. (2020a), Reimagining Capitalism in a World on Fire, New York, Hachette, PublicAffairs.
- Archor, S., Reece, A., Rosen Kellerman, G., et Robichaux, A. (2018), ‘9 out of 10 People are Willing to Earn Less Money to Do More Meaningful Work’, Harvard Business Review, 6 novembre.
- Henderson, R., et Serafeim, G. (2020), ‘Tackling Climate Change Requires Organizational Purpose’, American Economic Review, Papers and Proceedings, May, 177-80, disponible à l’adresse https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pandp.20201067.
- Bartelsman, E., et Doms, M. (2000), ‘Understanding Productivity : Lessons from Longitudinal Microdata’, Journal of Economic Literature, 38, 569-94 ; Syverson, C. (2004), ‘Market Structure and Productivity : A Concrete Example’, Journal of Political Economy, 112, 1181-222.
- Gibbons, R., et Henderson, R. (2013), ‘What Do Managers Do ? Exploring Persistent Performance Differences among Seemingly Similar Enterprises’, ch. 17 in R. Gibbons et J. Roberts (eds), The Handbook of Organizational Economics, Princeton, NJ, Princeton University Press, 680-731.
- Bloom, N., et Van Reenen, J. (2007), ‘Measuring and Explaining Management Practices across Firms and Countries’, Quarterly Journal of Economics, 122, 1351-408 ;
- Gibbons, R., et Henderson, R. (2013), ‘What Do Managers Do ? Exploring Persistent Performance Differences among Seemingly Similar Enterprises’, ch. 17 in R. Gibbons et J. Roberts (eds), The Handbook of Organizational Economics, Princeton, NJ, Princeton University Press, 680-731.
- Spector, R., et McCarthy, P. (2012), The Nordstrom Way to Customer Service, 2e édition, Hoboken, NJ, Wiley.
- Zaheer, A., et Bachmann, R. (eds), (2008), The Handbook of Trust Research, Cheltenham, Edward Elgar.
- Henderson, R., (2020b), ‘Innovation in the 21st Century : Architectural Change, Purpose, and the Challenges of Our Time’, Management Science.
- Pink, D. H. (2011), Drive: The Surprising Truth about What Motivates Us, New York, Penguin Random House.
- Henderson, R., et Van Den Steen, E. (2015), ‘Why do Firms have Purpose? The Firm’s Role as a Carrier of Identity and Reputation’. American Economic Review, Papers and Proceedings, mai.
- Henderson, R., (2020b), ‘Innovation in the 21st Century : Architectural Change, Purpose, and the Challenges of Our Time’, Management Science.
- Voir, par exemple, Eccles, R., Ioannou, I. et Serafeim, G. (2014), ‘The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance’, Management Science, 60(11), 2835-57; Edmans, A. (2020), Grow the Pie : How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit, Cambridge, Cambridge University Press.
- Voir par exemple Gartenberg, C., Prat, A. et Serafeim, G. (2019), ‘Corporate Purpose and Financial Performance’, Organization Science, 30(1), 1-18 ; Ton, Z. (2014), The Good Jobs Strategy: How the Smartest Companies Invest in Employees to Lower Costs and Boost Profits, New Harvest.
- Henderson, R., et Clark, K. (1990), ‘Architectural Innovation : The Reconfiguration of Existing Product Technologies and The Failure of Established Firms’, Administrative Science Quarterly, 35, 9-30 ; Gans, J. (2016), The Disruption Dilemma, Cambridge, MA, MIT Press.
- Henderson, R. (2020a), Reimagining Capitalism in a World on Fire, New York, Hachette, PublicAffairs.
- Kegan, R. (1982), The Evolving Self : Problem and Process in Human Development, Cambridge, MA, Harvard University Press.
- Voir par exemple Tushman, M., et O’Reilly, C. (2016), Lead and Disrupt, Cambridge, MA, Harvard Business Review Press.
- Henderson, R. (2020b), ‘Innovation in the 21st Century : Architectural Change, Purpose, and the Challenges of Our Time’, Management Science.
- Henderson, R. (2020a), Reimagining Capitalism in a World on Fire, New York, Hachette, PublicAffairs.
- Ostrom, E. (1990), Governing the Commons : The Evolution of Institutions for Collective Action, New York, Cambridge University Press.
- Henderson, R. (2020c), ‘The Business Case for Saving Democracy : Why Free Markets Need Free Politics’. Harvard Business Review, 10 mars.
- Strine, L. E., Jr (2019), ‘Towards Fair and Sustainable Capitalism’, document de recherche n° 19-39, Institute for Law and Economics, faculté de droit de l’université de Pennsylvanie, disponible à l’adresse https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3461924.
- Mayer, C. (2019), ‘The Future of the Corporation : Principles for Purposeful Business’, Rapport de la British Academy sur l’avenir de la société, disponible sur https://www.thebritishacademy.ac.uk/publications/future-of-the-corporation-principles-for-purposeful-business/.
- Voir https://benefitcorp.net/. Devenir une benefit corporation est très différent de devenir une société certifiée B, qui exige seulement que l’entreprise s’engage à se mesurer à des critères autres que financiers. Voir https://bcorporation.net/.
- Strine, L. E., Jr (2019), ‘Towards Fair and Sustainable Capitalism’, document de recherche n° 19-39, Institute for Law and Economics, faculté de droit de l’université de Pennsylvanie, disponible à l’adresse https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3461924.
- Bowles, S., et Carlin, W. (2021), ‘Shrinking Capitalism : Components of a New Political Economy Paradigm’, Oxford Review of Economic Policy, 37(4), 794-810.
- Edelman (2021), Edelman Trust Barometer 2021, disponible sur https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-03/2021%20Edelman%20Trust%20Barometer.pdf.
citer l'article
Rebecca N Henderson, Changer la raison d’être des sociétés pour rééquilibrer le capitalisme, Groupe d'études géopolitiques, Août 2022,
à lire dans cette issue
voir toute la revue





