Il n’y a pas d’impasse climatique. Comment naviguer dans le triangle politique de l’anthropocène

Pierre Charbonnier
Philosophe, chargé de recherche CNRS à Sciences PoIssue
Issue #4Auteurs
Pierre Charbonnier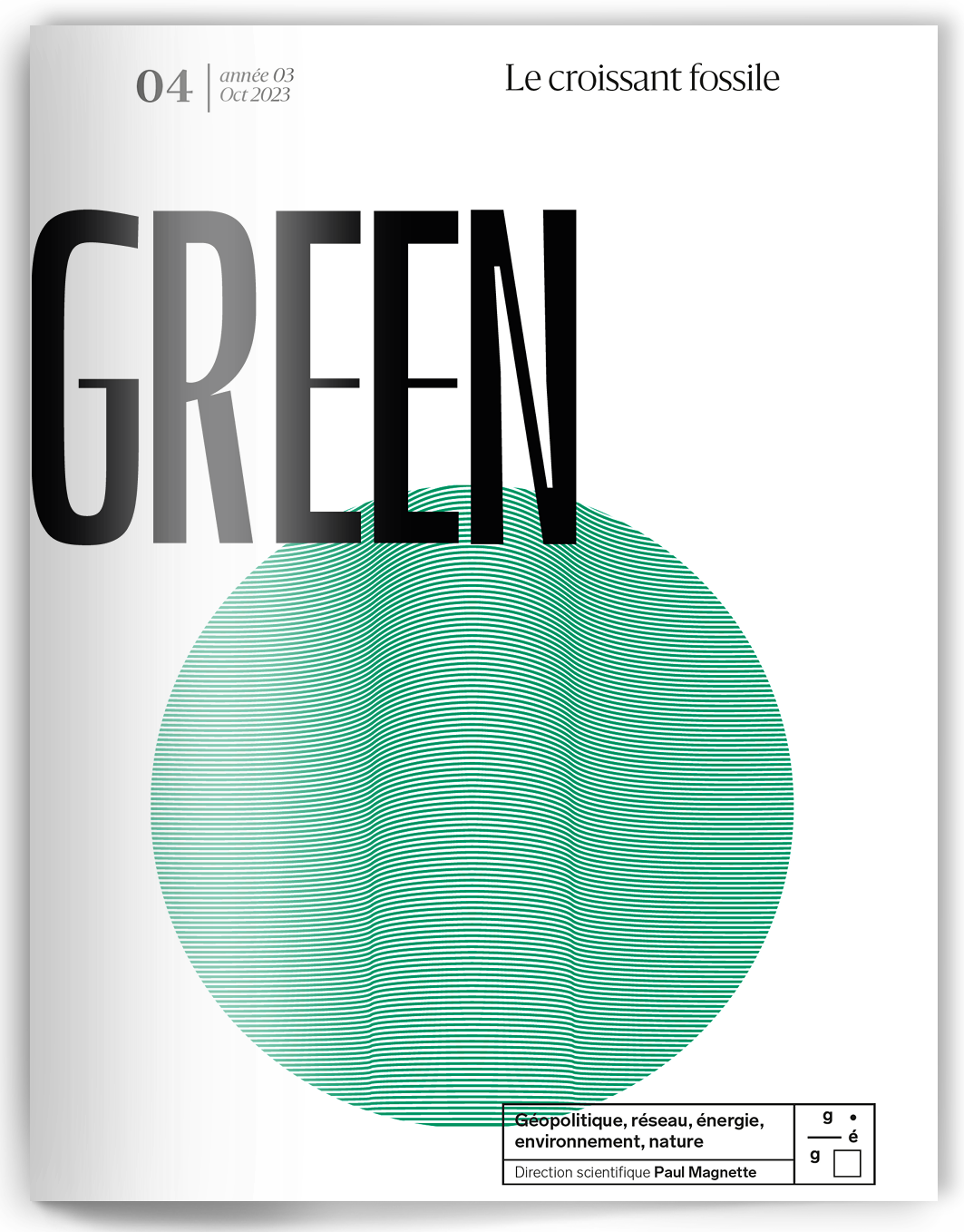
Publié par le Groupe d'études géopolitiques, avec le soutien de la Fondation de l'École normale supérieure
Le croissant fossile
L’une des choses les plus surprenantes à propos de la question climatique et écologique est qu’il n’y a plus aucune difficulté à imaginer un monde décarboné, un monde dans lequel l’organisation socio-économique relâche sa pression sur les milieux tout en assurant une vie digne au plus grand nombre. Les politiques actuelles d’inaction, de délai, de déni, de relativisation, l’accumulation des catastrophes et des conflits, ne s’expliquent pas par un défaut de possibilités objectives : elles se déploient dans un moment où les savoirs, les techniques, les dispositifs institutionnels nécessaires à une transition rapide et rigoureuse sont en train d’apparaître. Bien qu’ils bouleversent des schémas économiques et politiques bien installés et des intérêts en place, ils sont en mesure de nous sortir et de nous épargner les conséquences les plus dramatiques de la crise climatique.
L’imagination ne suffit pas en politique, mais laissons la fonctionner un instant. Le monde idéalement reconstruit selon l’impératif climatique est un monde où les biens publics — l’eau, le sol, l’air — sont protégés par une armature juridique et démocratique contraignante, où l’on ne brûle presque plus de carburants fossiles pour se chauffer ou produire des biens de consommation car la substitution renouvelable est achevée partout où elle peut l’être, où les infrastructures de transports publics sont fiables, également distribuées dans l’espace et efficaces, où les systèmes alimentaires sont largement végétalisés et locaux, où les procédés industriels sont décarbonés, capables de réutiliser de façon optimale les ressources, et où la distinction sociale par la consommation est marginalisée. L’électrification des usages 1 , la régénération des sols et des puits de carbone, une efficace combinaison de sobriété et de substitutions techniques, tout cela porté par un courage politique affirmé, peuvent nous sortir de l’ornière. Ainsi décrit, le monde ayant pacifié ses relations à la planète n’est absolument pas une utopie. C’est plutôt l’actualisation de possibilités bien réelles, assez largement en continuité avec les promesses d’amélioration techno-scientifique du quotidien et de démocratisation de l’espace public. Une nouvelle étape de la modernité en somme, que l’on pourrait définir avec Robert Boyer comme « anthropogénique » 2 plutôt que bêtement compétitive, mais certainement pas sa remise en question subversive : l’État, la division du travail, la prévision des risques, la rationalisation de l’expérience collective, l’idéal de justice et même la compétition entre les États sont toujours là, au centre de l’histoire, mais ils remplissent simplement des fonctions nouvelles dictées par le présent.
Nous sommes aujourd’hui cernés par l’imaginaire visuel et narratif de la catastrophe, et émergent çà et là quelques scénarios véritablement utopiques de retour à la nature ou d’abandon plus ou moins total de l’univers industriel. Ces possibilités, qui sont à la fois les moins souhaitables et les moins réalistes, laissent peu de place à un imaginaire culturel où prévaut le scénario rapidement esquissé plus haut. À l’exception par exemple du courant Solarpunk, que l’on peine à trouver dans les grandes productions cinématographiques, sur les plateformes de diffusion de contenus, dans la publicité ou la communication politique mainstream, l’idée même d’un monde commun soutenable semble ne pas prendre racine dans la conscience collective. S’agit-il d’une défaite idéologique traduite dans les représentations culturelles ? On sait combien le rêve moderniste de la ville, de l’émancipation par la consommation, de la liberté de mouvement, a été promu aux XIXe et XXe siècles via la production tous azimuts d’images, de discours dominants 3 . On sait que pour faire exister une réalité il faut d’abord la représenter. Alors pourquoi ne sommes nous pas bombardés quotidiennement par un arsenal médiatique d’images, de récits, de personnages et de symboles qui convergent dans la constitution d’un système visuel où prolifèrent les éoliennes, les fermes régénératrices, les bâtiments zéro émissions, les trains à grande vitesse, pourquoi le modèle social du partage, de l’efficacité et de la sobriété ne fait-il pas l’objet d’une vaste campagne de communication, voire, disons-le, de propagande ? Pourquoi ce surprenant sous-investissement, y compris par les milieux censés promouvoir la transition, dans l’imaginaire du monde post-fossile ? Le mouvement climat, en particulier, se limite souvent à un catéchisme accusatoire qui tout en désignant les bons ennemis — le système économique et politique qui soutient les fossiles — continue à invoquer la défense la planète ou du vivant comme une cause en elle-même, un principe d’action aussi vague que dénué de quelconque prise sur le réel et les intérêts.
On se trouve donc dans une situation où une bonne partie de la population sait que le modèle socio-économique dans lequel elle vit n’est pas soutenable, mais n’a aucune idée de ce à quoi ressemblerait le monde vers lequel il faut aller. Comment alors pourrait-elle vouloir de ce monde? Comment échanger une réalité instable mais bien tangible contre une autre, totalement abstraite et sans séduction. À défaut de cet imaginaire là, celui, obsolète, des libertés fossiles — voiture, avion, viande, pavillon de banlieue, etc. — conserve sa puissance d’attraction et, pire, devient un bastion à défendre dans le cadre d’une guerre culturelle.
L’explication de ce paradoxe — celui d’un monde objectivement souhaitable mais subjectivement non désiré — réside peut-être dans l’ampleur des obstacles qui se dressent au milieu du chemin vers cette démocratie symbiotique. Même en admettant que l’objectif final soit réalisable et fasse consensus, les entraves socio-économiques qui nous tiennent à distance de ces potentialités seraient de nature à engendrer défaitisme et découragement. On sait certes imaginer un paysage transformé par la révolution écologique, mais pas mobiliser pour l’exiger ni constituer le bloc social qui en sera le vecteur. La puissance de traction de l’idéal serait ainsi annulée ou amoindrie par l’idée selon laquelle ce monde souhaitable et possible, voire nécessaire, reste en définitive lointain et peu probable. Alors peut-être est-il temps de mieux comprendre ces entraves, de démontrer qu’elles peuvent être levées, pour que l’imaginaire culturel et politique d’un monde post-fossile se fasse enfin une place dans notre quotidien. Car répétons-le, il n’y a absolument pas d’impasse climatique, si ce n’est dans notre incapacité à croire en notre puissance de transformation.
*
Il faut dire dans un premier temps que ce chemin est rendu complexe par des obstacles structurels, liés aux attentes collectives et aux formes d’action politiques qui prédominent dans le monde social où survient la crise climatique. L’un des principaux est celui que l’on peut résumer par le débat entre gradualisme et radicalité. D’un côté, on trouve un groupe d’acteurs qui recommande la prudence dans l’action transformatrice : de sorte à ne pas froisser trop d’intérêts, et donc à ne pas compromettre les étapes ultérieures de la transition, il s’agirait de procéder avec précaution, en récoltant d’abord les fruits de mesures bipartisanes, qui ne soulèvent pas ou peu d’oppositions. Le gradualisme plaide une stratégie socialement réaliste, qui vise à ne pas échauder l’électorat et à constituer, nécessairement lentement, un public réceptif aux bénéfices de la transition. De l’autre, les radicaux avancent l’impératif absolu de la transition et son urgence, ils acceptent de bouleverser de manière transitoire les intérêts en place au nom d’une obligation qui met en jeu la survie 4 . Le dosage entre gradualisme et radicalité anime une bonne partie du discours politique sur le climat de nos jours, il détermine l’espace des positions par rapport au capitalisme, à l’État, aux mobilisations sociales. Il existe un gradualisme hypocrite, qui contribue à donner du crédit aux intérêts fossiles en supposant que même ces derniers ne peuvent être trop froissés ; il existe réciproquement une radicalité incantatoire, inattentive aux leviers sociaux de transformation sur lesquels elle peut effectivement s’appuyer. Cette polarité, surtout, tend à créer les conditions d’un attentisme artificiel, puisque chaque camp prend prétexte de l’existence de l’autre pour ne pas engager une voie de transformation qui, lente ou rapide, soit au moins tangible.
Ce débat est lui-même enchâssé dans une réflexion plus méta-politique, sur la nature du défi qui nous est imposé. L’une des caractéristiques déstabilisantes de la question climatique est en effet qu’elle tend à absolutiser les enjeux. Si dans le passé les conflits politiques mettaient aux prises des groupes sociaux assez bien identifiés, qu’il s’agisse d’ordres, de groupes religieux, de classes, de nations, la crise climatique introduit une forme de politisation dans laquelle l’humanité comme catégorie abstraite est engagée, et dans laquelle le théâtre sur lequel on se battait jadis fait désormais partie de l’intrigue. D’où le reflux de catégories de pensée théologico-politiques comme celle du salut, ou l’ensemble du lexique de la fin du monde, du planétaire. Cela ne revient pas à dire que les inégalités socio-économiques intra et internationales soient obsolètes, loin de là, mais que la réflexion sur les clivages internes au monde social doit être reprise à l’aune d’une expérience qui en déborde en partie le cadre. L’entrée dans l’Anthropocène bouleverse les appartenance sociales, les intérêts, les logiques de coalition et d’opposition telles qu’on les hérite du passé — elle les remet en jeu. La conséquence la plus visible de cette mutation est que l’espace politique officiel, fait de partis, de promesses, d’agendas, se trouve en porte-à-faux par rapport à un nouvel impératif qui n’a pas de clientèle sociale pré-constituée. Il n’existe pas de « classe géosociale », pour reprendre le terme de Latour 5 , il n’existe même pas réellement de bloc socio-écologique visible et ayant atteint sa masse critique, et donc il n’existe pas de porte-parole légitime pour cette question.
À son tour, cette question en soulève une autre. L’un des prérequis pour ancrer dans la société ce nouveau jeu de questions politiques — et donc être en mesure d’y répondre — est l’existence d’un espace public sain, structuré par un système scolaire en état de marche et une économie des média raisonnablement indépendante. Il faut en d’autres termes un public formé et intégré d’une manière suffisamment efficace pour que les transformations en cours n’apparaissent pas comme aberrantes, comme une source d’anomie, ou pire comme des menaces. Le rêve républicain de l’instruction généralisée et de la démocratisation des aptitudes à décoder le monde a tout son sens dans le contexte d’une crise épistémologique et sociale comme celle que nous vivons. Or de ce point de vue, il faut bien admettre que la crise politique du climat intervient au pire moment possible (ou plus radicalement que son développement non contraint est une conséquence de la désagrégation de l’espace public). L’investissement dans le capital humain est dans la plupart des pays dits développés dans une dynamique négative, il tend à accroître les inégalités d’accès aux savoirs essentiels, et à compromettre la capacité collective à entrer dans l’Anthropocène 6 . La presse, surtout en France, est largement aux mains d’une oligarchie financière qui n’a aucun scrupule à l’instrumentaliser pour ses intérêts immédiats 7 . Les réseaux sociaux peuvent aussi alimenter cette situation d’anomie en obscurcissant la frontière entre l’information et le bruit. Dans ces conditions, l’espace public nécessaire à la formation d’un idéal social de transition a peu de chances de se former.
Enfin, quatrième et dernier aspect de ces coordonnées structurelles qui entravent le développement d’une réelle politisation du climat, l’incertitude plus ou moins sciemment entretenue sur les bénéfices de la transformation écologique. Pour beaucoup, y compris de façon surprenante du côté des écologistes, la transition serait autant un risque qu’une opportunité. S’il existe, en dehors de ses lobbyistes, un accord sur la nécessité de se passer des énergies fossiles, il n’y en a pas à ce jour sur les modalités de la substitution énergétique et technique, ni sur l’ampleur du levier qu’est la sobriété choisie : en somme, quelle est la part respective de l’innovation /substitution et de la sobriété dans le processus de décarbonation? Souvent épris d’un rêve édénique de vie discrète et sans accrocs, les environnementalistes hésitent à endosser le tournant énergétique des renouvelables : ils rappellent fréquemment que les éoliennes occupent de l’espace, demandent des matériaux, que les usines de batteries et les mines de lithium polluent, que l’ouverture de nouveaux secteurs industriels et l’innovation technologique qui les soutient ressemblent trop aux solutions du passé. L’imperfection manifeste de la transition, le fait qu’elle déplace parfois plus qu’elle n’annule les déprédations environnementales 8 , obscurcit la nécessité brute, évidente, massive, de la décarbonation et de l’économie de matériaux, et plus encore l’opportunité socio-économique qui se profile derrière elle. Historiquement, l’environnementalisme est né en Europe comme une critique de la modernité industrielle, et le fait que les politiques climatiques aient aujourd’hui le visage de sa renaissance crée un électrochoc chez ses acteurs principaux. Autrement dit, il existe une ambiguïté y compris et surtout dans les segments de l’espace politique qui sont en position de défendre la transition. Voit-on les Verts européens noyer l’espace politique d’images du monde post-fossile ? Cela ne s’est produit que dans le contexte de la guerre en Ukraine 9 . Les voit-on revendiquer l’autorité intellectuelle et politique permettant de se projeter dans un avenir sûr ? Non. Faute de le faire, il est assez facile pour les opposants à cette transition de l’accuser de tous les maux : augmentation des prix de l’énergie, menaces sur la sécurité de l’approvisionnement, menaces sur l’emploi et la croissance, tout peut être mis sur le dos de la transition si celle-ci n’est pas présentée au public avec l’énergie qui convient.
Ces quatre freins, ces quatre conditions défavorables à la transition si l’on peut dire, relativisent sans doute notre constat de départ selon lequel il n’y a pas d’impasse climatique. On comprend en réalité que, si impasse il y a, elle ne se situe pas au niveau de la faisabilité technique et institutionnelle — nous avons les machines et le cadre normatif à portée de main pour y parvenir et il n’y a pas d’impossibilité anthropologique profonde —, ni même au niveau de sa désirabilité objective, mais au niveau de la mobilisation des intérêts. La panne de l’imaginaire politique renvoie alors à la dégradation des conditions sociales générales, à l’incapacité de créer et de diffuser un message clair et suffisamment universel pour qu’il ait un effet de traction sur les attentes et les pratiques collectives. Mais ce constat ne fait que rendre plus regrettable, plus rageante pourrait-on dire, cette panne de l’imaginaire, car il pourrait tout à fait venir combler le déficit actuel de mobilisation pour la transition.
*
Pour se convaincre que l’impasse climatique n’est que relative, ou subjective, et ainsi croire en nos forces de transformation, il est essentiel que la communauté politique ait conscience à la fois de la nature des obstacles à renverser et du fait qu’ils peuvent l’être. Pour qu’un certain niveau de confiance dans un chemin de transition apparaisse et se diffuse, il faut en d’autres termes que la guerre climatique apparaisse bien pour ce qu’elle est, et apparaisse comme pouvant être gagnée. La description de la ligne de front, si l’on veut prolonger cette métaphore, est donc nécessaire pour identifier les points de bascule possibles entre statu quo et transformation, ainsi que les forces à engager sur chacun d’entre eux.
La transition vers un système de production et de distribution de la richesse, vers un système de libertés publiques décarboné et soutenable repose fondamentalement sur l’art de piloter les dilemmes qu’elle engendre. Ces dilemmes, nous les rencontrons désormais quotidiennement : nous nous demandons comment maintenir l’emploi et le développement humain sans le recours aux infrastructures héritées du passé, comment financer cette transition sans peser trop fort sur le budget des ménages, comment articuler la réindustrialisation des économies nationales sans compromettre la coopération internationale par un excès de protectionnisme, comment intégrer des nouvelles pratiques de consommation, de déplacement, d’alimentation aux expériences ordinaires de la population sans provoquer de guerre culturelle ou de sentiment de déclassement. Ces dilemmes sont au coeur des nouveaux mouvements sociaux comme celui des gilets jaunes en France, des révoltes liées au prix des marchandises de base qui parcourent le monde, et des conflits internationaux sur l’innovation technologique.
Pour relâcher la pression sur les milieux naturels et préserver les biens publics mondiaux comme l’atmosphère, les océans, et plus largement les fonctions écologiques élémentaires qui assurent l’habitabilité de la planète, il faut en d’autres termes un art politique du compromis entre nations, entre classes sociales, entre secteurs d’influence. Il faut en d’autres termes que se constitue une coalition post-fossile plus puissante que la coalition fossile issue du passé 10 . Nous commençons à entrevoir le déploiement de cet art politique dans les stratégies industrielles et climatiques des États-Unis, de la Chine, de l’Union, mais ces stratégies n’ont pas encore atteint leur vitesse et leur masse critique, le point à partir duquel elles impriment leur mouvement à la société toute entière. C’est la raison pour laquelle nous nous trouvons dans ce que l’on pourrait appeler une « drôle de guerre climatique » : nous savons que le conflit est déclenché, que l’ordre ancien ne reviendra pas, mais nous restons au milieu du chemin, les vainqueurs et perdants ne sont pas déclarés, les coups les plus forts n’ont pas même encore été portés. Le récent discours sur l’état de l’Union de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen témoigne de cet entre-deux 11 : l’horizon historique avait été défini par le Pacte vert et un premier round de financements stimulés par la conjoncture de la guerre en Ukraine (RePowerEU, NZIA), mais le soulèvement des droites européennes qui agitent la menace d’une transition déstabilisatrice et demandent un ralentissement des mesures provoque un refroidissement de l’establishment 12 .
En élevant artificiellement le coût politique de la transition et en agitant la crainte d’une société post-fossile ingouvernable ou indésirable, les droites européennes augmentent le coût futur des catastrophes. C’est la raison pour laquelle une analyse lucide de cette transition, dans ses différentes dimensions industrielle, financière, scientifique, géopolitique, ne peut pas prendre la forme d’une mise en regard neutre des coûts et des bénéfices. Elle doit démontrer de façon performative comment la conduite de la transition peut intégrer l’abaissement de son coût socio-politique, en construisant une coalition d’intérêts sociaux qui en est bénéficiaire, et ultimement demandeuse 13 . La multiplication des discours d’auto-satisfaction sur la grande marche vers l’innovation et le développement industriel vert traduit le déséquilibre entre la facilité qu’il y a à définir un horizon technique et industriel de décarbonation, et la difficulté, dans le cadre politique actuel, à définir les contours de cette coalition. L’Union, mais peut-être est-ce également le cas des États-Unis, définit un programme de reconversion ajusté à la contrainte climatique, mais qui n’est pas conçu pour répondre aux demandes de justice qui animent la société et le salariat. Un programme, en d’autres termes, qui risque de tourner à vide.
*
Encore une fois, sortir de ces incantations passe par l’abandon d’une conception fataliste de la transition. Que l’on y voie la marche automatique de l’histoire, selon une nouvelle téléologie verte, ou une impossibilité socio-économique radicale, comme c’est le cas des droites fossilisées un peu partout dans le monde, le défaut est le même : les forces sociales restent absentes de l’équation. Aussi faut-il reprendre chacun des trois grands pivots historiques qui se déploient sous nos yeux autour du problème climatique pour mieux comprendre comment se présente la ligne de front sur laquelle nous devons combattre, et comment les forces sociales réelles peuvent s’y retrouver et s’y mobiliser, pour le climat et pour elles-mêmes.
Ces trois piliers sont d’ordre géopolitique, socio-économique, et culturel — faute d’un meilleur terme.
On peut commencer par l’échelle géopolitique, ou internationale, dans la mesure où il s’agit de la plus englobante. L’histoire et la problématique de la crise climatique est en effet en très large partie une question de guerre et de paix, une question qui met en jeu le socle des États modernes, à savoir le principe de sécurité. En effet, depuis les Lumières et la naissance de l’économie politique moderne, il est admis par l’essentiel des élites politiques que le meilleur substitut à la guerre est le commerce, et que l’extension des circuits commerciaux rend possible à la fois une meilleure connexion entre les humains, et une domestication accrue de la nature 14 . La société marchande, telle qu’elle a été conçue par Hume, Smith, puis par exemple par Bentham, Spencer, mais aussi par des théoriciens d’inspiration socialiste comme Saint-Simon ou Marx, a cela de fantastique qu’elle crée en même temps l’unification du genre humain et la transfiguration d’une nature réputée dangereuse par les forces productives. La théodicée moderne du progrès est en très large partie motivée par les dilemmes de l’État territorial, c’est-à-dire par le besoin de créer de la coopération entre nations sur une planète unique et finie, tout en préservant un avantage domestique. Au cours du XIXe siècle, avec le développement des technologies fossiles, l’utopie commerciale s’est muée en utopie industrielle 15 , et la vocation historique de l’humanité a été identifiée de façon quasiment universelle avec l’effort productif, auquel on prêtait une vertu pacificatrice et civilisatrice. L’élimination tendancielle de la violence par la substitution de la production à la guerre a pris racine dans le système international, sous la forme de l’ouverture du commerce mondial, de transferts technologiques, de dispositifs d’aide au développement. Mais cet idéal est paradoxalement devenu aujourd’hui le principal frein à l’action climatique puisqu’il lie profondément la stabilité de ce système international à la poursuite d’une mobilisation productive totale. Ce lien entre stabilité internationale et intensité fossile se manifeste aussi négativement : le fait par exemple de dénoncer des contrats d’approvisionnement énergétique, de refuser l’importation de marchandises au nom du climat, le fait de choisir ses partenaires au nom de principes environnementaux, revient à déclarer la guerre — ou du moins à remettre en question l’ordre international tel qu’il a été façonné après la Seconde Guerre mondiale.
Dans ce contexte, les stratégies industrielles de transition induisent la formation d’un nouveau dilemme géopolitique, que l’on pourrait ainsi résumer. L’enjeu climatique nécessite un haut niveau de coordination internationale, parce qu’il s’agit d’un intérêt partagé de l’humanité, parce que les émissions de CO2 et le climat sont indifférentes aux frontières territoriales inter-étatiques, et parce qu’il est nécessaire de négocier un partage équitable du fardeau entre nations. Mais dans la mesure où la décarbonation de l’économie doit être intégrée à la recherche de la légitimité par les prétendants au pouvoir (il faut pouvoir se faire élire sur la base d’un programme climatique), chaque nation tend à vouloir capturer pour elle-même les bénéfices socio-économiques de cette transition — et à rejeter sur les autres ses inconvénients. Le résultat de ce dilemme est tout à fait présent dans le discours politique dominant sur ces enjeux, que ce soit chez Emmanuel Macron et son nouveau slogan de “l’écologie à la française” 16 , ou dans le récent discours de Rishi Sunak au Royaume-Uni, qui conditionne l’action climatique au développement de filières nationales dans la green tech 17 .
Ce dilemme géo-écologique structure désormais les relations internationales, comme en témoignent les conflits économiques entre les États-Unis, l’Union et la Chine qui ont été alimentés notamment par l’IRA et le Green Deal, mais aussi l’attitude des prétendants du Sud global à une voie de développement soutenable dans le contexte de la guerre en Ukraine. C’est l’hypothèse que nous faisons dans la revue GREEN 18 .
Or il n’y a à ce jour pas réellement de synthèse doctrinale proposée par le mouvement démocratique et social, une synthèse qui permettrait d’intégrer sa stratégie politique à ce jeu de contraintes historiques. Pour sortir du dilemme climatique international, il est pourtant nécessaire de définir un point d’équilibre entre la pression à exercer sur les partenaires économiques et politiques trop dépendants des fossiles, et l’assistance tout aussi nécessaire que les pays les plus développés doivent apporter aux autres pour accélérer leur décarbonation. Ainsi par exemple la vogue actuelle du protectionnisme écologique, défendue sur la quasi-totalité du spectre politique, ne peut-elle être cohérente que si elle correspond à l’émergence d’une coalition inter-étatique résolue à diffuser des normes de production décarbonées par des instruments réglementaires et douaniers. On doit donc se demander si l’Union a l’impact économique suffisant pour le faire, ou si elle doit s’allier à cette fin avec d’autres partenaires, et si oui lesquels. En complément de cette utilisation stratégique du pouvoir économique, qui risque de créer des frustrations, voire des répliques, les pays riches doivent cesser leur réticence aux transferts technologiques, à l’assistance à l’adaptation, c’est-à-dire à des mesures plus positives qui pourraient à la fois tempérer les rivalités suscitées par les mesures punitives, et anticiper des risques futurs.
L’équilibre entre ces deux registres d’action doit être défini par la rationalité stratégique, c’est-à-dire une balance entre promesses et menaces.
Sur le volet socio-économique, énormément de choses ont déjà été écrites pour alimenter le débat sur la compatibilité entre fin du monde et fin du mois. J’ai développé dans Abondance et liberté une réflexion sur le processus historique qui a abouti à la confiscation des structures de l’État social par la croissance fossile, et au-delà par la formation d’une imaginaire social de l’émancipation par la consommation, à la fois outil de distinction et levier de négociation socio-politique.
On pourrait faire à ce sujet trois remarques similaires à ce qui a été dit plus haut à propos de l’échelle géopolitique. Premièrement il s’agit d’un héritage historique à réinventer, deuxièmement la question prend fondamentalement la forme de dilemmes à trancher, et troisièmement il n’existe pas de synthèse théorique et politique aboutie.
Sur le premier point, il est évident désormais que dans le cadre des démocraties sociales où le budget de l’État a vocation à assumer le coût de la transition et de l’exposition à de nouveaux risques, l’aggravation de la crise climatique correspond à une menace supplémentaire sur son équilibre. On observe partout un phénomène de chantage au financement des prestations sociales dès que la question climatique est évoquée : comment ralentir le rythme de production d’automobiles ou d’avions de ligne dans ce contexte, puisqu’il faut des revenus à l’État ? Comment remettre en question, plus largement, les moteurs de la croissance si la transition énergétique est un poids budgétaire en augmentation ? Ce dilemme est réplicable à la question de l’emploi : comment assumer des pertes d’emploi dans les secteurs les plus émetteurs s’il faut construire une plateforme politique de transition qui s’adresse aux classes moyennes et défavorisées déjà touchées par le chômage et la précarité ? Il est tout à fait frappant de noter que la crise climatique intervient dans un contexte où l’affaiblissement des services publics est déjà un phénomène relatif, et non pas absolu : leur efficacité baisse car les besoins augmentent plus vite que les équipements 19 , et on sait combien ce processus a servi dans le passé à construire un discours sur leur inefficacité structurelle. Un mécanisme similaire de remise en question de l’accès aux droits et infrastructures publiques via l’enjeu climatique est déjà en cours, et il est évidemment urgent d’y répondre.
Comme dans le cas des relations internationales, les dilemmes sont réels mais pas insolubles. Il est possible, dans un premier temps, d’en desserrer l’étau en montrant que l’émancipation à l’égard des modes de production et de consommation les plus néfastes au climat et à la biodiversité a des co-bénéfices importants, notamment en termes de santé. Mais cela ne suffit pas à rétablir la balance. On peut ensuite, et c’est un argument devenu omniprésent aujourd’hui, montrer que le processus de destruction créative qui conduit à fermer les secteurs carbonés pour ouvrir des filières de production et de consommation alternatives est créateur de richesse. Mais là non plus, l’équilibre n’est pas totalement retrouvé, d’autant que la phase de transition elle-même coûte assez cher 20 , s’il faut financer et accompagner de nouveaux parcours de formation et de requalification de la force de travail. Il faut en effet en passer, pour revenir dans les limites planétaires, à un sérieux changement d’échelle des flux de matières qui structurent notre réalité économique, en d’autres termes à des mécanismes de sobriété obtenus par la discipline des comportements individuels et par l’élaboration de dispositifs de partage et de coopération. Dans ce cadre, le renouveau industriel et la croissance verte ne peuvent avoir un effet que limité sur les structures générales de l’économie nationale, et les mécanismes de l’endettement, de la fiscalité doivent être remis sur la table, ainsi que le développement d’une rationalité macroéconomique compatible avec les objectifs climatiques 21 : émancipation à l’égard du PIB, non comptabilisation des investissements climat dans le budget national, développement de la double matérialité.
La raison pour laquelle il n’existe pas encore de synthèse théorique et stratégique pour naviguer dans les incertitudes et les risques de la transition est que le spectre politique est désormais clivé entre un bloc qui s’affaire à démontrer les bénéfices économiques de la transition (elle apporterait croissance, emplois, innovation, compétitivité, c’est-à-dire tout ce que la doctrine économique classique recommande d’apporter), et un bloc d’opposition essentiellement occupé à mener la critique des pathologies économiques et des intérêts en place. Le grand défaut des premiers, qu’on trouve essentiellement au centre et chez une partie des écologistes, est de promettre une réinvention de l’économie politique classique autour de la décarbonation, quitte à se donner la tâche facile en ne percevant de la crise objective que les aspects facilement incorporables à une doctrine préexistante. La transition serait ainsi une panacée un peu trop miraculeuse. Quant aux seconds, leurs limites sont différentes en fonction de leur culture politique, d’inspiration socialiste ou écologiste. Chez les premiers, en France le mouvement insoumis, on tend à considérer que la crise écologique est une crise exogène : elle vient d’ailleurs, d’intérêts privés, d’influences étrangères, de structures économiques externes au corps social, ou au « peuple ». C’est évidemment une limite importante car elle interdit de mener l’analyse des raisons pour lesquelles la coalition fossile s’étend à de larges pans de ce fameux peuple, pourquoi la voiture, le barbecue, les chaudières à gaz et les week-ends Easyjet sont un ennemi intérieur à éliminer 22 . Dans ces conditions, la promotion opportune d’une planification écologique par ce mouvement entre en contradiction avec le discours politique général, qui en devient difficile à lire. Du côté des écologistes, l’impasse est inverse : ce mouvement investit avant tout une critique des comportements de consommation, qui provoque depuis longtemps un rejet des groupes sociaux les plus captifs des émissions contraintes et des perspectives de distinction par la consommation — ceux-là même qu’il faudrait rapatrier dans la coalition écologique.
Il n’y a pas de solution miraculeuse pour trancher ces dilemmes, pour définir un juste point d’équilibre entre les opportunités bien réelles de la transition et les bouleversements non moins prévisibles qu’elle va engendrer. Néanmoins, il est possible de mieux présenter les différentes options en termes de choix technologiques, de stratégies industrielles, de dispositifs d’accompagnement et d’adaptation, c’est-à-dire de reconstruire un projet pour l’État social centré autour de cette transition 23 . Il est également possible, de façon accrue depuis 2022, de lier la nécessaire transition à des risques de plus grande échelle, notamment l’influence idéologique de la Russie et des acteurs internationaux qui entendent prolonger l’existence de la civilisation fossile 24 , de reconstruire l’impératif écologique comme un principe de sécurité et de stabilité, et ainsi d’en faire un élément constitutif de la légitimité et de l’autorité politique, au cœur de l’État et de ses missions, au cœur de la production de l’avenir collectif. Un principe en d’autres termes au nom duquel quelques sacrifices temporaires et contrôlés peuvent être consentis s’ils sont justement distribués dans une période de crise profonde. Les politiques climatiques s’intègrent ainsi à un récit plus large de lutte contre l’extrême droite et de réinvention de la nationalité et des frontières.
Le troisième et dernier sommet de ce triangle des politiques climatiques est d’ordre culturel. J’emploie ce terme pour faire écho à ce qu’il est désormais convenu d’appeler « culture wars », c’est-à-dire le développement d’identités sociales très marquées, très férocement opposées les unes aux autres, et bien évidemment exploitées par les acteurs politiques pour faire avancer leur agenda. En France, nous avons un aperçu de cette guerre culturelle dans le débat interminable entre Fabien Roussel et Sandrine Rousseau au sujet de la consommation de viande et du symbole culturel du barbecue, mais il est en passe de devenir le cœur d’un clivage social plus large au sujet de la transition. Durant le mouvement des Gilets Jaunes, et parallèlement à l’émergence d’un conflit socio-économique sur la répartition de l’effort écologique, nous avions déjà entrevu quelques aspects de la guerre culturelle sur l’écologie avec l’expression d’un sentiment d’abandon des groupes sociaux se vivant comme périphériques, à distance des centres de décision, de savoir, de communication : ce moment avait déjà laissé l’impression que la transition écologique ne pouvait résonner qu’au sein d’une élite culturelle urbaine, et au détriment de ses laissés pour compte.
Le premier point à noter au sujet de la bataille culturelle qui se noue autour de l’écologie est que la stratégie historique de l’environnementalisme européen est en échec. Celle-ci se caractérisait justement par l’idée de « guerre culturelle », l’idée étant qu’une modification graduelle des normes de comportement, de consommation, des attentes sociales, allait se produire sous l’égide d’une avant garde verte — un peu à la manière de l’émergence des formes de politesse telle que Norbert Elias l’avait décrite. Mais si l’écologie est un enjeu hautement culturel, et si cette dimension de la guerre climatique est en train de s’intensifier sous nos yeux, c’est précisément parce que la transformation des normes sociales n’est jamais un processus pacifique et uniforme : dans le cas présent, le fait que l’avant-garde culturelle en question se trouve être principalement composée de personnes plutôt privilégiées tend à associer le mode de vie écologique à ces privilèges, et à susciter par contrecoup les réticences des groupes moins favorisés.
Aux États-Unis, cette guerre culturelle est devenue un élément absolument central dans la vie politique, au moins depuis la campagne présidentielle de Trump. En 2016, par exemple, le milliardaire Charles Koch, qui a fait fortune dans le pétrole, se déclarait inquiet des politiques climatiques, qui d’après lui devait sévèrement toucher les classes populaires dépendantes de l’énergie bon marché (et lui aussi par la même occasion) 25 . La société, et la transition climatique, sont ainsi prises en étau par une alliance entre élites fossiles et classes populaires, dont les intérêts convergent par la force des circonstances, et dont l’expression la plus manifeste au quotidien est cette insistance répétée, à droite et dans l’écosystème médiatique qu’elle entretient, pour qualifier toute action climatique de crime contre les valeurs traditionnelles de l’homme ordinaire. Le clin d’oeil du Président Macron à la culture automobile dans une récente intervention médiatique (« J’adore la bagnole ») est une nouvelle manifestation de cette bataille culturelle : il est désormais quasiment impossible de ne pas rassurer les habitudes de l’âge fossile, pour prévenir le douloureux backlash de la transition.
Plus frappant encore, une bonne partie de cette bataille culturelle se focalise sur l’aspect esthétique de la transition. Il est vrai que le développement de l’énergie éolienne, la place de plus en plus grande occupée par ces moulins modernes dans l’environnement visuel des résidents de la ruralité, constitue une transformation absolument gigantesque de la vie quotidienne. La critique de cette nuisance esthétique devient alors un élément central des droites et de l’extrême droite, qui peuvent se prévaloir d’un discours de préservation du milieu tout en donnant des garanties à la coalition fossile 26 . Le grand avantage des énergies fossiles était en effet que leur formidable concentration, et le fait qu’elles étaient extraites hors de nos frontières, les rendaient quasiment invisibles, ayant l’effet paradoxal de libérer notre environnement de l’emprise énergétique. C’est ainsi que, par ce croisement entre agitation des craintes au sujet de la transition, appel aux valeurs traditionalistes et à l’égoïsme Not In My Backyard, l’extrême droite devient un choix électoral massif chez les groupes sociaux les plus dépendants des fossiles. Le facteur strictement socio-économique se double en effet d’un élément de politique identitaire absolument central.
L’Europe doit se préparer au déferlement de cette guerre culturelle. Récemment, la présidente du Parlement Européen, Roberta Metsola, a demandé à Ursula von der Leyen de ralentir son programme de régulations environnementales en agitant la crainte d’une vague populiste déclenchée, encore une fois, par les craintes de déstabilisation qu’elle entraînerait 27 . En d’autres termes, les droites se réorganisent autour de la résistance contre les politiques climatiques sur un socle idéologique qui a une dimension économique, mais qui s’exprime avant tout dans le registre de la frustration culturelle des classes moyennes et populaires (ou plutôt de leur instrumentalisation).
Quelle doit alors être la stratégie pour faire face à cette guerre culturelle ? Le point le plus évident est qu’il est impératif pour les acteurs et promoteurs de la transition de se défaire des stéréotypes culturels qui y sont généralement attachés : celui d’une bourgeoisie urbaine éduquée qui investit dans le mode de vie écologique par stratégie de distinction. Réciproquement, rassurer les tenants du stéréotype inverse n’a aucun sens, parce qu’il s’agit plus d’un stéréotype que d’une réalité sociale cohérente. Dans son récent petit livre, Léa Falco donne une indication à la fois théorique et stratégique clé : ce qu’elle appelle « écologie by design » signifie que la modification des habitudes ne peut pas prendre la forme d’un acquiescement explicite, mais d’une réorganisation des modes de production, de circulation, de consommation par défaut 28 .
Quelques exemples : la viande doit être plus chère et de meilleure qualité pour en limiter la demande, le vrac doit être généralisée par les distributeurs, les voitures électriques doivent être moins chères et plus commodes d’usage que les voitures thermiques, les transports en commun encore moins chers et plus commodes que le véhicule individuel, etc. C’est l’architecture normative et l’organisation des infrastructures matérielles qui doivent intégrer les principes écologiques, exactement comme par le passé l’ébriété énergétique a été imposée par défaut. Ainsi il n’est nul besoin de faire appel à un positionnement culturel très marqué de la part des citoyens, et le front de la bataille se déplace de l’espace culturel vers l’espace proprement politique (puisqu’il faut gagner des batailles politiques pour imposer à l’industrie les normes décrites plus haut).
En complément de cette stratégie de dédramatisation des conflits identitaires qui commencent à se nouer autour de la transition, et pour revenir aux premières lignes de ce texte, il faut investir dans le développement d’un imaginaire politique propre à une écologie sociale de construction. Une troisième culture écologique, si on peut dire, qui ne se résume ni à l’idéalisme contestataire ni au défaitisme catastrophiste, mais qui reprend, affine et développe les codes esthétiques et narratifs du mouvement Solarpunk en montrant les aboutissements réels d’une stratégie industrielle verte pour la ville, les transports, le travail, l’agriculture. Si il doit y avoir une bataille culturelle autour de l’écologie, alors autant s’y lancer avec les bonnes armes.
*
Il n’y a donc pas d’impasse climatique, mais il y a de nombreux acteurs sociaux qui réussissent très bien à l’inventer, à la mettre en scène. Et d’autres, moins puissants, qui cèdent au pouvoir de conviction de cette stratégie par intérêt ou en fonction d’intérêts imaginés. Cette confrontation, qui se déploie à l’échelle internationale, sur le plan socio-économique et culturel, ne permet pour l’instant que des avancées très limitées. Ce qui manque à la coalition post-fossile, ou socio-écologique, est la capacité à imposer les termes du débat telle qu’elle les comprend: la transition est une question de justice internationale et de sécurité, une question d’égalité fondamentale entre groupes sociaux au sein de la division du travail, et si elle engage chacun et chacune d’entre nous en fonction de ses habitudes et systèmes de valeurs, elle ne peut pas être le fait d’une minorité active.
Dans la conjoncture historique actuelle, quelques éléments permettent de donner du poids à cette stratégie. On les a rappelés : le développement des stratégies industrielles de transition, surtout depuis l’adoption du plan IRA aux États-Unis, l’accentuation des conflits de répartition du coût de la transition, qui sont susceptibles de réveiller les forces sociales, et l’ouverture du front ukrainien, qui permet de donner à l’impératif climatique une dimension de sécurité internationale.
Mais comme nous l’indiquions au début de ce texte, il manque encore à la coalition socio-écologique le soft power qui pourrait la propulser plus vite dans l’imaginaire collectif, et lui permettre de lutter contre le fatalisme. Cet imaginaire dans lequel la transition n’est ni un renoncement ni une somme d’incertitudes, mais plutôt l’actualisation de tendances modernisatrices encore latentes autour de l’égalité, de la sécurité, de la science au service du commun, de la prise de contrôle sur notre destin collectif.
Notes
- International Energy Agency, 2023. Voir https://www.iea.org/energy-system/electricity/electrification.
- Robert Boyer, Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie, Éditions La Découverte, 2020, p. 200.
- Kristin Ross, Fast Cars, Clean Bodies. Decolonization and the Reordering of French Culture, The MIT Press, 1996, p. 274.
- Alyssa Battistoni, “There’s No Time for Gradualism”, in The Wire, 2018. Voir https://thewire.in/environment/climate-change-earth-no-time-for-gradualism.
- Pierre Charbonnier, Bruno Latour et Baptiste Morizot, « Redécouvir la terre », in Tracés. Revue de Sciences humaines, n°33, 2017, pp. 227-252.
- Peter Achterberg, Willem de Koster, Jeroen van der Waal, “Science confidence gap : Education, trust in scientific methods, and trust in scientific institutions in the United States”, in Public understanding of science, n°26, 2017, pp. 704–720.
- Olivier Godard, “Le climato-scepticisme médiatique en France : un sophisme moderne”, in Cahier du département d’économie de l’école Polytechnique, n°20, 2011, p. 33.
- Maeve Campbell, “In pictures: South America’s ‘lithium fields’ reveal the dark side of our electric future”, Euronews, 2018.
- Greens / EFA, “Stand with Ukraine: Let’s stop fuelling war!”. Voir https://act.greens-efa.eu/ukraine.
- Thomas Oatley, Mark Blyth, “The Death of the Carbon Coalition. Existing models of U.S. politics are wrong. Here’s how the system really works.”, Foreign Policy, 2021.
- Discours sur l’état de l’Union de la Présidente von der Leyen, septembre 2023. Voir également Alberto Alemanno, L’état de l’Union d’Ursula von der Leyen : un appel ou un accident de l’histoire ? le Grand Continent, septembre 2023.
- Andy Bounds, Climate regulation is driving support for populism, says EU parliament chief, in The Financial Times, 2023.
- Neil Makaroff, “Réindustrialiser l’Europe, prochaine étape du pacte vert européen”, Fondation Jean Jaurès, 2023.
- Istvan Hont, Jealousy of Trade. International Competition and the Nation-State in Historical Perspective, Harvard University Press, 2010, p. 560.
- Arnault Skornicki, « La deuxième vie du doux commerce. Métamorphoses et crise d’un lieu commun à l’aube de l’ère industrielle », Astérion, n° 20, 2019.
- Matthieu Goar, “Emmanuel Macron dessine les contours de son “écologie à la française” : inciter sans contraindre”, Le Monde, 2023.
- Discours du Premier ministre Rishi Sunak, 20 septembre 2023.
- GREEN. Géopolitique, réseaux, énergie, environnement, nature, no2, Écologie de guerre : un nouveau paradigme ? année 2, Paris, Groupe d’études géopolitiques, 2022.
- Rapport sur l’état des services publics, 2023.
- Les incidences économiques de l’action pour le climat. Rapport de synthèse, 2023.
- Eric Monnet, La Banque Providence. Démocratiser les banques centrales et la monnaie, La République des idées, 2021, p.132.
- Antonin Pottier, Emmanuel Combet, Jean-Michel Cayla, Simona de Lauretis, Franck Nadaud, Qui émet du CO2 ? Panorama critique des inégalités écologiques en France, Dans Revue de l’OFCE 2020/5 (169), pages 73 à 132.
- Colin Hay, “The ‘New Orleans effect’: The future of the welfare state as collective insurance against uninsurable risk”, in Renewal: A journal of social democracy, vol. 31 n°3, 2023, pp. 63-81.
- Aleksandra Krzysztoszek, Extrême droite polonaise : le nouveau patron veut reprendre les importations de charbon russe, Euractiv, 2022.
- Matea Gold, “Charles Koch on the 2016 race, climate change and whether he has too much power”, The Washington Post, 2015.
- Communiqué de presse de André Rougé, député (RN) au Parlement européen, 2022.
- Andy Bounds, “Climate regulation is driving support for populism, says EU parliament chief”, The Financial Times, 2023.
- Léa Falco, Faire écologie ensemble. La guerre des générations n’aura pas lieu, Rue de l’échiquier, 2023, p.96
citer l'article
Pierre Charbonnier, Il n’y a pas d’impasse climatique. Comment naviguer dans le triangle politique de l’anthropocène, Groupe d'études géopolitiques, Jan 2024, 30-36.
à lire dans cette issue
voir toute la revue





