Le pouvoir de la raison d’être

Alex Edmans
Professeur de Finance à la London Business SchoolIssue
Issue #4Auteurs
Alex Edmans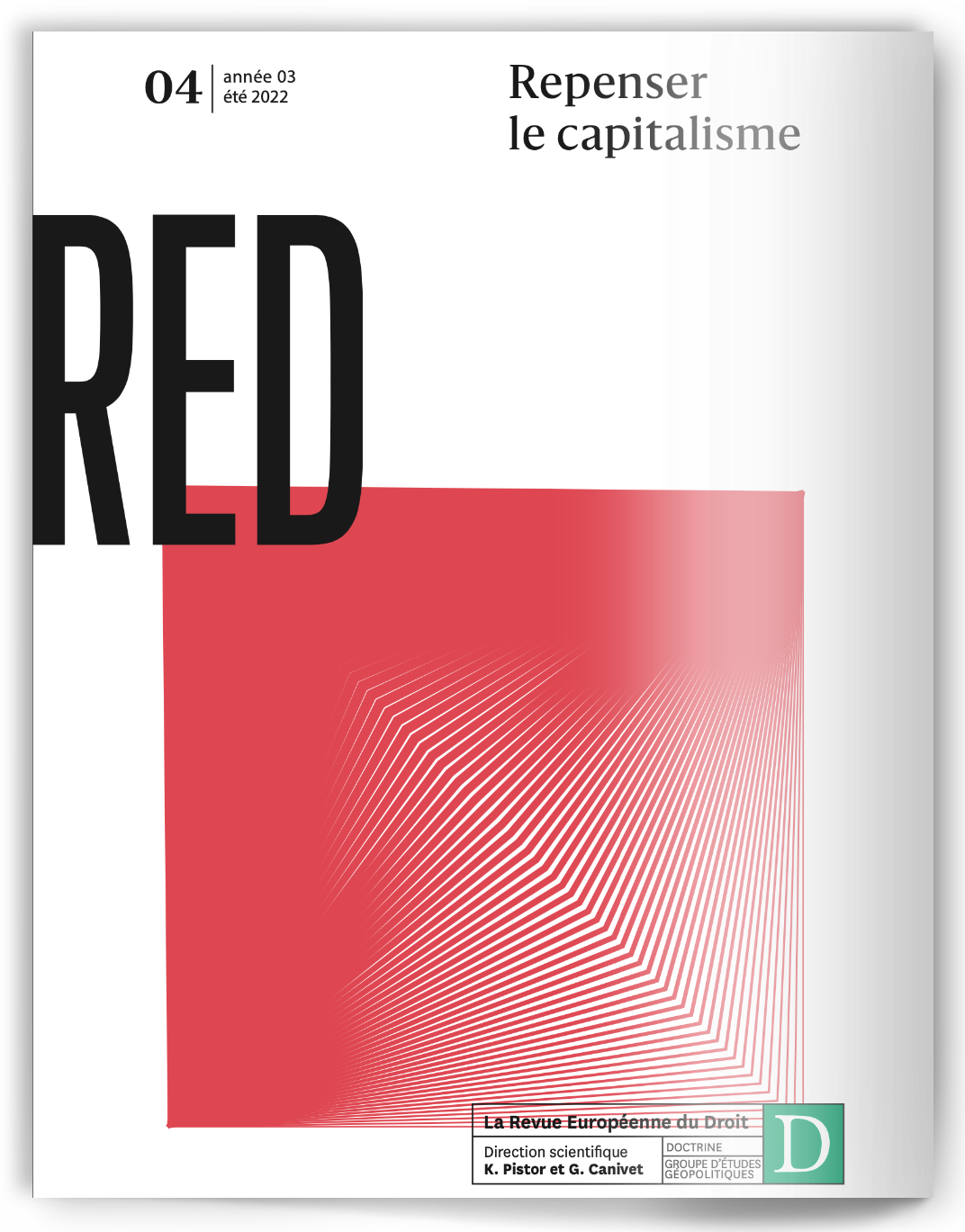
La Revue européenne du droit, été 2022, n°4
Repenser le capitalisme
Avant même que la COVID-19 ne bouleverse le monde, le capitalisme était en crise. La crise financière de 2007 a coûté à 9 millions d’américains leur emploi et à 10 millions d’entre eux leur maison. Bien que la situation se soit rétablie, la reprise a surtout largement profité aux patrons et aux actionnaires, tandis que les rémunérations des travailleurs continuaient de stagner. En 2019, les 22 hommes les plus riches du monde détenaient plus que toutes les femmes d’Afrique. Alors que 100 millions de personnes sont plongées dans l’extrême pauvreté, la richesse des milliardaires de la tech s’accroit massivement. La pandémie ne fera qu’accentuer ces inégalités.
Les entreprises ne sont pas seulement des bénéficiaires passifs des grandes tendances que connait le monde, elles y contribuent activement. Afin de capter la plus grande part du profit, beaucoup d’entre elles paient leurs salariés aussi peu que possible et les font travailler ad nauseam, au mépris des règles de santé et de sécurité. Chaque jour, 7.500 personnes meurent ainsi de maladies et d’accidents du travail. L’impact d’une entreprise est si grand qu’elle peut nuire à des personnes qui ne sont même pas ses clients ou ses salariés. En juin 2020, le fournisseur d’électricité américain PG&E a plaidé coupable pour 84 homicides involontaires liés aux feux de forêt en Californie causés par ses équipements défectueux.
Les préjudices ne concernent pas seulement les humains, mais aussi la planète. En 2010, l’explosion de la plateforme de forage Deepwater Horizon de BP a entraîné le déversement de l’équivalent de 4,9 millions de barils de pétrole dans la mer, menaçant huit parcs nationaux américains, mettant en danger 400 espèces et abîmant 1.000 miles de côtes. Cinq ans plus tard, Volkswagen a admis avoir installé un dispositif de contournement dans ses voitures qui a permis de fausser le résultat des tests d’émissions et a contribué à 1.200 décès rien qu’en Europe. En mai 2020, la compagnie minière Rio Tinto a fait exploser la gorge de Juukan en Australie, un site sacré pour les peuples indigènes Puutu Kunti Kurrama et Pinikura, qui avait été occupé sans discontinuité par les humains depuis 46.000 ans. Plus généralement, les coûts environnementaux engendrés par les entreprises sont estimés à 4.700 milliards de dollars par an.
Les citoyens se défendent. Le 15 avril 2019, le groupe militant Extinction Rebellion a organisé des manifestations dans 80 villes de 33 pays, bloquant des routes, des ponts et des bâtiments pour dénoncer les conséquences de l’activité humaine sur le changement climatique. Parmi les myriades d’autres réactions, citons les mouvements Occupy, le Brexit, l’élection de dirigeants populistes, les restrictions au commerce et à l’immigration et les réactions hostiles à l’encontre des rémunérations de certains dirigeants d’entreprise. Tous ces événements ont en commun d’être nourris par le même sentiment : « ils » profitent au détriment de « nous ».
En réaction, les entreprises ont répondu – ou du moins semblent elles le faire. Le développement durable est devenu un poncif de leurs discours. C’était le thème du Forum économique mondial de Davos en 2020. En août 2019, la Business Roundtable, un groupe de dirigeants influents de grandes sociétés américaines, a radicalement redéfini sa conception de la raison d’être (business purpose) pour y inclure les intérêts des parties prenantes autres que les actionnaires. En juin 2020, Danone a été la première entreprise cotée française à modifier ses statuts pour devenir une société à mission.
Mais il n’est pas aisé de déterminer si ces dirigeants sont sincères. Les critiques affirment que Davos repose davantage sur une mise en scène de la vertu que sur une démarche visant à être effectivement vertueux. Les sceptiques affirment que la déclaration de la Business Roundtable était un exercice de relations publiques visant à échapper à toute nouvelle contrainte réglementaire. En effet, plusieurs signataires ont licencié des milliers de travailleurs lors de la pandémie de coronavirus, tout en versant d’énormes dividendes aux actionnaires. Quelques mois après être devenue une société à mission, Danone a ainsi annoncé 2 000 suppressions d’emplois. D’autres détracteurs ont affirmé que l’accent mis par Danone sur son nouveau statut était une tentative de masquer ses mauvaises performances – le cours de son action est resté stable au cours des six ans et demi de mandat du PDG Emmanuel Faber contre une hausse de 50 % pour son concurrent Nestlé et l’ensemble du CAC-40.
Pourquoi certains dirigeants ne font-ils pas ce qu’ils disent ? Pourquoi réduisent-ils la durabilité à un sujet accessoire cantonné au département responsabilité sociale des entreprises (RSE) plutôt que de l’intégrer pleinement à l’activité essentielle ? Parce que beaucoup d’entre eux craignent que cela ne se fasse au détriment des bénéfices. Dans l’imaginaire le plus répandu, la valeur créée par l’entreprise est un gâteau dont la taille est fixe. Ainsi, toute part du gâteau donnée à la collectivité implique une lésion pour les actionnaires. L’objectif d’un dirigeant est donc de minimiser les coûts, en maintenant les salaires bas, en trompant les clients et en faisant peu de cas de l’environnement. Cette conception entraine logiquement une approche timorée de la durabilité réduite à des initiatives de relations publiques peu coûteuses mais très visibles.
Cette approche est paradoxalement partagée par de nombreux progressistes. Si la taille du gâteau est fixe, la seule façon d’augmenter la part qui revient à la collectivité est d’imposer aux entreprises une réglementation lourde afin d’équilibrer le partage de la valeur créée.
Ce modèle qui persiste depuis plusieurs siècles et qui a atteint son apogée avec le paradigme marxiste décrivant au milieu du XIXème siècle la lutte entre capital et travail, conduit à percevoir les intérêts des entreprises et de la société comme étant opposés. Depuis lors, nous assistons à un mouvement de balancier entre les entreprises et la société. L’émergence de barons voleurs à la fin du XIXème siècle et de leurs monopoles géants tels que la Standard Oil a entrainé une réaction du gouvernement qui a fait le choix du démantèlement. L’apogée des syndicats dans les années 1970 aux Etats-Unis a été suivie d’une législation qui a provoqué leur déclin. L’essor des grandes banques au début du XXème siècle au sommet de leur puissance à la veille de la crise financière de 1929 a conduit à les réglementer sévèrement par le Glass-Steagall Act – lui-même partiellement déconstruit depuis les années 1980, contribuant à une nouvelle crise en 2007. À moins qu’une autre voie ne soit trouvée, ce film est condamné à être rejoué.
Mais la bonne nouvelle c’est qu’il existe une autre solution.
En appliquant une approche radicalement différente de l’activité économique des entreprises, la réconciliation entre la création de profits pour les actionnaires et de valeur pour la société devient possible. La mentalité visant la croissance de la taille du gâteau souligne que cette dernière n’est pas figée. En tenant compte des intérêts des parties prenantes, une entreprise ne réduit pas la part du gâteau 1 revenant aux actionnaires, comme le supposent certains dirigeants, elle la fait croître, ce qui profite in fine aux actionnaires. Une entreprise peut améliorer les conditions de travail par souci sincère pour ses salariés, qui deviennent alors plus motivés et plus productifs. Elle peut encore développer un nouveau médicament pour résoudre une crise sanitaire, sans se demander si les personnes concernées sont en mesure de le payer, tout en réussissant à le commercialiser avec succès. Elle peut enfin réduire ses émissions bien en-deçà des seuils réglementaires en raison de son sens des responsabilités à l’égard de l’environnement, bénéficiant alors d’un bénéfice d’image auprès de ses clients, salariés et investisseurs.
Si l’entreprise adopte une mentalité visant la croissance de la taille du gâteau, son objectif premier est de servir la société plutôt que de générer des profits. Étonnamment, cette approche s’avère généralement plus rentable que si les bénéfices étaient l’objectif final. L’explication repose sur le fait qu’une telle approche permet de réaliser de nombreux investissements qui finissent par produire des bénéfices substantiels à long terme. Certes, une entreprise n’adhérant pas à ce paradigme investira quand même au profit des parties prenantes, mais uniquement si elle anticipe que cet investissement augmentera les gains au-delà du coût de l’investissement. Effectivement, les manuels de finance affirment clairement que les entreprises doivent orienter leurs investissements selon une analyse du rapport coûts/bénéfices.
Mais la vie réelle n’est pas un manuel de finance. En pratique, il est très difficile de déterminer le rendement futur d’un investissement. Dans le passé, cela était plus aisé car les investissements portaient davantage sur des actifs corporels. Par exemple, dans le cas de la construction d’une usine, il est possible d’anticiper un niveau de production et un prix de vente. Mais la plupart de la valeur d’une entreprise du XXIème siècle provient d’actifs incorporels, tels que les marques et les cultures d’entreprise. Si une entreprise améliore les conditions de travail, il est impossible d’estimer dans quelle mesure les travailleurs seront plus productifs et dans quelle mesure cette productivité accrue se traduira par des bénéfices plus élevés. Il en va de même de l’effet des performances environnementales sur les bénéfices de réputation. Une entreprise libérée de l’obligation de justifier chaque investissement par un calcul coûts/bénéfices investira davantage et pourra finalement devenir plus rentable.
Cette nouvelle approche est le sujet de mon dernier ouvrage, Grow the Pie : How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit 2 . J’ai écrit ce livre parce que je m’inquiète de la polarisation entre les entreprises et la société dans laquelle le monde se trouve aujourd’hui. Face à ce conflit, il s’agit d’un livre fondamentalement optimiste. Pourtant, cet optimisme n’est pas fondé sur un espoir aveugle, mais sur des preuves rigoureuses que cette approche de l’entreprise fonctionne, dans tous les secteurs d’activité et pour toutes les parties prenantes, dans un cadre d’action permettant de la concrétiser.
Passons aux faits. L’idée que les entreprises et la société puissent voir leurs intérêts converger peut sembler être une chimère trop belle pour être vraie. Cependant, des preuves rigoureuses suggèrent que les entreprises qui favorisent leurs parties prenantes offrent aux investisseurs des rendements supérieurs à long terme. Par exemple, l’une de mes propres recherches montre que les entreprises dont les employés ont un haut niveau de satisfaction atteignent des performances supérieures à celles de leurs homologues de 2,3 à 3,8 % par an sur une période de 28 ans 3 . Cela représente en cumulé 89 à 184 %. Des études dans le même sens suggèrent que c’est la satisfaction des employés qui conduit à de bonnes performances, plutôt que l’inverse. D’autres analyses montrent que la satisfaction des clients 4 , la gestion 5 de l’environnement 6 et les politiques de durabilité 7 sont également associées à des rendements boursiers plus élevés.
Ainsi, créer de la valeur pour les parties prenantes ne revient pas seulement à se conformer à un idéal louable, c’est aussi faire preuve d’un bon sens des affaires. Lorsque je m’adresse à des praticiens pour leur parler de l’importance de la raison d’être, je suis présenté comme un professeur de finance, ce qui suscite en général de la surprise dans l’auditoire. Les directions financières sont souvent les ennemis des entités qui se sont dotées d’une raison d’être car les financiers perçoivent cette préoccupation comme une distraction éloignant l’entreprise du chemin de la poursuite des bénéfices économiques. Cela peut être vrai à court terme, mais les données à long terme montrent que toute direction financière victime de ce préjugé se révèle défaillante. La relation positive entre poursuite d’une raison d’être et rendements à long terme suggère également que les entreprises ont tout intérêt à transformer leur mode de fonctionnement et à prendre très au sérieux leur impact sur la société. Il est urgent qu’elles le fassent au risque sinon de voir des réglementations contraignantes adoptées, et les clients ainsi que les salariés se tourner vers des concurrents dont ils partagent les valeurs. Servir la société n’est pas une option facultative relevant des seuls départements RSE mais devrait être au cœur de la gestion de l’entreprise.
Un changement de mentalité
La mentalité de la croissance de la taille du gâteau modifie notre façon de penser certains des aspects les plus controversés des activités des entreprises. Tout d’abord, il transforme le régime de responsabilité des dirigeants et des sociétés, ainsi que la manière dont la collectivité devrait les tenir responsables. Nous nommons et dénonçons (name and shame) souvent les entreprises qui commettent des erreurs de commission, c’est-à-dire des actions perçues comme visant à partager de manière inéquitable le gâteau, par exemple en par la réalisation de bénéfices excessifs. Toutefois des bénéfices élevés peuvent être le résultat d’une activité vertueuse. Nous devrions donc plutôt tenir les entreprises responsables de leurs erreurs d’omission, c’est-à-dire de leur incapacité à saisir les occasions d’accroître la taille du gâteau. Par exemple, Kodak n’a pas investi dans les appareils photo numériques et a fini par faire faillite. Pourtant, cette affaire est rarement considérée comme un échec de gouvernance, car les actionnaires n’en ont pas profité – mais ce n’est pas une consolation pour les 150 000 salariés qui ont été licenciés. Une entreprise irresponsable est une entreprise dont la gestion conduit à rétrécir la taille du gâteau ou ne parvient pas à le faire croître, au détriment de toutes les parties prenantes.
Deuxièmement, le paradigme de la croissance du gâteau amène à repenser la manière de structurer la rémunération des dirigeants. Leur niveau de rémunération est peut-être la preuve la plus souvent employée pour mettre en évidence la déconnection entre les entreprises et la société. Aux États-Unis, le directeur général moyen d’une société du S&P 500 a gagné 14,8 millions de dollars en 2019, soit 264 fois plus que le salarié moyen. Cette critique s’appuie sur l’idée est que si les dirigeants n’étaient pas aussi avides, leur rémunération pourrait être redistribué à leurs collaborateurs ou investie. Mais cela revient à réfléchir dans le cadre du paradigme du partage du gâteau. Or, le montant qui peut être réaffecté en redistribuant le gâteau est minuscule. La valeur médiane des capitalisations boursières du S&P 500 est de 24 milliards de dollars. 14,8 millions de dollars ne représentent que 0,06% du gâteau – bien moins que les 2,3 à 3,8% qui peuvent être créés en augmentant le gâteau par l’amélioration de la satisfaction des salariés.
En outre, tout comme les bénéfices élevés, les salaires élevés pourraient être une conséquence de la création de valeur. Il est juste que les dirigeants soient payés comme les propriétaires de leur entreprise grâce à la détention d’une partie du capital de sorte qu’ils soient directement impactés en cas de contre-performance. A l’inverse, s’ils font croître le cours de l’action, ils seront automatiquement récompensés. Par exemple, Bob Iger, le patron de Disney, a été critiqué pour avoir gagné 66 millions de dollars alors même que la capitalisation boursière de Disney avait augmenté de 578 % au cours de ses quatre années à la tête de l’entreprise, et que 70.000 emplois avaient été créés. Nous ne devrions donc pas critiquer les rémunérations élevées des dirigeants sans d’abord nous demander si elles résultent d’une croissance de la taille du gâteau, ou simplement de son partage favorable aux dirigeants.
C’est sur ce point que les efforts doivent se concentrer. Certains dirigeants ne sont pas rémunérés comme des propriétaires de long terme. Ils reçoivent plutôt des primes fondées sur des objectifs à court terme, ce qui leur permet de gagner des millions en exploitant les travailleurs et les clients. La solution ne repose donc pas tant dans la modération des niveaux de rémunération, même s’ils cristallisent l’attention, mais plutôt dans leur structure : il faut abandonner les objectifs à court terme et payer les dirigeants avec des actions incessibles pendant 5 à 7 années. En créant des incitations à long terme pour les dirigeants on les récompense pour la croissance de la taille du gâteau et on les dissuade des actions visant à simplement le diviser. En effet, les recherches empiriques montrent que les incitations à court terme conduisent les dirigeants à réduire les investissements pour atteindre les objectifs de bénéfices trimestriels 8 , alors que les incitations à long terme sont associées non seulement à des performances financières plus élevées, mais aussi à une innovation supérieure et au bien-être des parties prenantes 9 . Notons que les études en question documentent des relations de causalité, et pas seulement de corrélation.
Il est nécessaire que le dirigeant continue à détenir ses actions après son départ afin de s’assurer que son horizon s’étende au-delà de son mandat. Par ailleurs, des actions devraient être attribuées à tous les salariés, afin de garantir que chacun bénéficie de la croissance de l’entreprise. Si l’entreprise se porte bien, ce n’est pas seulement grâce au dirigeant mais aussi aux collaborateurs, que l’on traite alors en partenaires de l’entreprise et non simplement comme des salariés.
Troisièmement, la mentalité de croissance de la taille du gâteau change notre façon de voir les investisseurs. Ces derniers sont souvent considérés comme des capitalistes sans nom et sans visage qui s’enrichissent au détriment de la société. Un livre affirme par exemple que « les actionnaires activistes (…) ressemblent davantage à des terroristes qui gèrent par la peur et dépouillent l’entreprise de ses actifs essentiels sous-jacents (…) en extrayant des liquidités de tout ce qui pourrait autrement générer une valeur à long terme » 10 . Des hommes politiques, tant au Royaume-Uni qu’aux États-Unis, ont d’ailleurs fait des propositions visant à restreindre les droits des investisseurs. Mais ces approches ne sont pas justifiées par les données empiriques. Des études rigoureuses montrent que, si l’activisme actionnarial augmente effectivement les bénéfices des entreprises, cela ne résulte pas des actions visant simplement à partager autrement le gâteau, mais d’une croissance de sa taille, c’est-à-dire d’une amélioration de la productivité et de l’innovation, qui profite à son tour à la collectivité 11 .
Les investisseurs ne sont pas « eux », ils sont « nous ». Nous le répétons, ils sont aussi les citoyens ordinaires qui épargnent pour leur retraite, ou encore les fonds communs de placement et les fonds de pension qui investissent en leur nom. Les politiques qui s’attaquent aux investisseurs ne rendent pas seulement les entreprises moins utiles et moins productives, mais nuisent également aux citoyens. Les investisseurs ne sont pas des ennemis, mais des alliés pour faire croître la taille du gâteau. Toute proposition sérieuse de réforme des entreprises devrait donc placer l’engagement des investisseurs au premier plan.
Mise en pratique
Comment une entreprise peut-elle réellement « faire croître la taille du gâteau » ? Elle doit en premier lieu définir sa raison d’être et son rôle. Une raison d’être peut consister à développer des traitements qui améliorent la santé des citoyens, fournir un réseau ferroviaire efficace qui relie les individus à leur lieu de travail, leur famille et leurs amis, produire des jouets qui divertissent et éduquent les enfants.
Il est important de noter que l’objectif d’une entreprise ne peut pas être de réaliser des bénéfices, mais que les bénéfices sont le fruit de la réalisation de la raison d’être. De la même manière, l’ambition d’un individu n’est pas de gagner sa vie, mais dans l’idéal de choisir une carrière qui lui plaît et dans laquelle il s’épanouit.
Il est néanmoins crucial que l’objectif soit bien circonscrit. De nombreuses entreprises ont des raisons d’être très générales, tels que « servir les clients, les collaborateurs, les fournisseurs, l’environnement et les communautés tout en générant des bénéfices pour les actionnaires ». Il est séduisant de pouvoir servir tout le monde. Toutefois un objectif qui tente d’atteindre le meilleur pour toutes les parties est condamné à rester sans implications pratiques, car il fait fi de la réalité et des compromis qu’elle implique nécessairement. Les dirigeants doivent prendre des décisions difficiles qui profitent à certaines parties prenantes au détriment d’autres.
En novembre 2016, l’énergéticien français Engie a annoncé la fermeture de sa centrale d’Hazelwood, située dans la vallée de Latrobe, dans l’État de Victoria, en Australie. Cette décision a fait perdre leur emploi à 450 employés d’Engie et à 300 sous-traitants. Les clients ont également souffert puisque Hazelwood fournissait un cinquième de la capacité de production d’électricité de Victoria, les factures moyennes d’électricité des foyers ont augmenté de 16 % au cours de l’année qui a suivi. Mais Engie a pris cette décision parce que l’entreprise s’était engagée cette même année dans un plan de transformation visant à donner la priorité aux questions environnementales. Comme l’a déclaré Isabelle Kocher, alors directrice générale de l’entreprise : « Nous voulons concentrer nos investissements uniquement sur la production d’énergie à faible émission de carbone (…) nous remanions l’ensemble de notre portefeuille ». Hazelwood était la centrale la plus polluante d’Australie, responsable de 3 % des émissions de gaz à effet de serre du pays, et l’une des centrales les plus polluantes au monde. En 2005, le World Wide Fund for Nature l’avait désignée comme la centrale la moins efficiente en termes d’émissions de dioxyde de carbone de l’OCDE.
Ce positionnement aussi univoque a permis à Engie de prendre cette décision difficile. L’environnement étant considéré comme encore plus important que les intérêts des salariés et des clients, la décision s’imposait. Engie a d’abord choisi de fermer l’usine, puis a cherché à limiter les conséquences des licenciements en trouvant des emplois pour ses salariés dans des entreprises voisines.
Les faits mettent en évidence combien un ciblage pertinent compte. Les entreprises qui obtiennent de bons résultats sur l’ensemble des dimensions ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) ne surperforment pas par rapport à la moyenne du marché. En revanche, celles qui n’obtiennent de bons résultats que sur les dimensions directement liées à leur activité et passent au second plan les autres facteurs, enregistrent des performances nettement supérieures 12 .
Mon récent ouvrage présente trois principes (le principe de multiplication, le principe de l’avantage comparatif et le principe de matérialité) afin de fournir un cadre pratique visant à orienter les entreprises dans leurs politiques d’investissement en faveur des parties prenantes et les aider à faire preuve de retenue quand cela s’impose. Cet équilibre est essentiel. Certains dirigeants interprètent à tort l’appel à « servir la société » comme un impératif d’investir autant que possible, avec la bénédiction de nombreux décideurs politiques. Il existe nombre de récits d’échecs cuisants en raison de surinvestissements, Daewoo étant à ce titre un exemple particulièrement frappant.
Naturellement, une raison d’être doit aller au-delà des simples déclarations et doit être mise en pratique. L’ouvrage aborde cinq outils permettant à une entreprise d’y parvenir : la convergence de sa stratégie, de son modèle opérationnel, de sa culture, de ses politiques de reporting et de sa gouvernance. Il met également l’accent sur le rôle des actionnaires dans la mise en œuvre de la raison d’être, en demandant aux dirigeants de rendre des comptes sur l’intégration de cet objectif dans toutes les strates de l’organisation et en s’assurant de l’existence d’un organe de gouvernance indépendant en charge des objectifs de long terme. Je propose un guide pratique sur la manière dont les actionnaires peuvent remplir efficacement cette fonction. Je reviens notamment sur les relations entre les différents acteurs de l’industrie financière (gestionnaires d’actifs, investisseurs, conseillers en investissement et proxy advisors) et la façon dont elles peuvent être réformées pour passer d’un modèle transactionnel à des rapports de confiance favorable au développement de l’investissement responsable.
Les citoyens ont également un rôle majeur à jouer. Le discours dominant présente les entreprises comme des mastodontes sur lesquelles les citoyens ne peuvent exercer aucune influence. Mais j’insiste sur le fait que les citoyens – dans leur rôle de salariés, de clients et d’investisseurs – jouissent d’un pouvoir de volition, c’est-à-dire de la capacité à agir de manière indépendante et à influencer leur environnement, plutôt que de le subir. Une de ses composantes est le pouvoir des individus d’investir du temps et de l’argent dans des entreprises agissant conformément à leurs valeurs. L’effet massif de boycotts de clients en raison de comportements perçus comme non vertueux est sans doute sans précédent grâce aux médias sociaux, comme le montrent les campagnes #boycottvolkswagen et #DeleteUber. Quant au capital humain, il est plus important que jamais, le départ de salariés clés nuisant gravement à la compétitivité d’une entreprise.
Une deuxième composante de ce pouvoir repose sur la capacité des individus à influencer l’organisation des entreprises dont ils choisissent de faire partie. Chaque soir, Abdul Durrant travaillait dur pour nettoyer les bureaux londoniens de la HSBC, y compris celui du président Sir John Bond. Mais il avait du mal à faire vivre ses cinq enfants avec son faible salaire. Abdul a donc assisté à l’assemblée générale annuelle de la HSBC et s’est adressé à Sir John en disant : « Je suis ici au nom de tous les sous-traitants au service de la HSBC et des familles de l’est de Londres. Nous recevons 5 £ de l’heure – 5 £ de l’heure ! – pas de droit à la retraite, et un régime de couverture en cas de maladie indigent. Nos enfants vont à l’école sans déjeuner digne de ce nom. Nous ne pouvons pas leur offrir les livres nécessaires à leur éducation. Ils sont privés des sorties scolaires ». Touché par ce plaidoyer, Sir John a accordé une augmentation de salaire de 28% aux agents d’entretien de la HSBC. Cela illustre le pouvoir d’un seul employé pour changer la politique salariale d’une grande multinationale.
Raison d’être en période de pandémie
L’importance de percevoir la raison d’être comme un moyen d’accroître la taille du gâteau, plutôt que d’en moduler la répartition, se révèle pleinement en cas de pandémie. Pendant ces derniers mois de pandémie, certaines entreprises se sont mises au service de la société en partageant autrement le gâteau. Par exemple, Unilever a fait don de 100 millions d’euros de nourriture et de gel hydro-alcoolique aux communautés locales et a préservé les emplois de ses 155 000 travailleurs – y compris les sous-traitants, tels que les agents d’entretien et le personnel de restauration.
De telles actions sont tout à fait louables et ne doivent pas être déconsidérées. Mais une telle logique se heurte aux situations de beaucoup d’entreprises qui n’ont simplement pas de gâteau à partager, en particulier en période de pandémie. Que faire pour celles qui n’opèrent pas dans les secteurs de l’agroalimentaire et des produits d’hygiène et qui n’ont rien d’utile à partager ? Qu’en est-il des petites entreprises qui n’ont pas des millions à donner ?
En concevant leur responsabilité comme d’abord centrée sur l’accroissement de la taille du gâteau, on permet à toutes les entreprises de jouer leur rôle. Contrairement à la modulation de sa répartition, la croissance de la taille du gâteau se révèle peu couteuse. Bien davantage, ce qui est requis est un état d’esprit favorable à la création de valeur pour la collectivité. Un dirigeant responsable se demande : « Qu’est-ce que j’ai en main ? Quelles sont les ressources et l’expertise dont dispose mon entreprise, et comment puis-je les employer de manière innovante pour servir la société ? »
Un tel état d’esprit peut inspirer de grandes idées. Les parfums de luxe de LVMH sont effectivement un luxe dans une pandémie. Mais le groupe qui dispose d’une capacité de production pour confectionner des produits intégrant de l’alcool, l’a redéployé pour produire du gel hydroalcoolique. De nombreux avions de JetBlue ont été cloués au sol alors que le nombre de passagers s’effondrait. JetBlue s’est donc associé à des organisations caritatives telles que la Croix-Rouge et Médecins Sans Frontières pour utiliser ses avions afin de transporter des professionnels de santé, des appareils et des fournitures médicales.
Ce modèle se prête particulièrement au cas des petites entreprises qui n’ont pas de gâteau à partager. Prenons l’exemple des salles de sport Barry’s. Cette société disposait de son expertise en matière de fitness qu’elle a utilisée pour proposer des sessions d’entraînement gratuites diffusées en ligne et en direct, offre particulièrement précieuse en cas de confinement. Mais là ne réside pas la réelle innovation, qui est à chercher du côté de la réorganisation du travail des salariés de bureau. Certains d’entre eux occupaient également un emploi d’acteur, Barry’s leur a donc offert la possibilité de mettre leur talent à son service et leur a ainsi assuré un revenu dans un contexte de grande instabilité. Ainsi Barry’s a lancé le programme « Barry’s Cares » dans le cadre duquel ses employés lisaient des histoires et divertissaient les enfants par Zoom, soulageant ainsi les parents qui travaillaient et dont les enfants restaient à la maison en raison de la fermeture des écoles.
Les citoyens ont également suivi la mentalité de la croissance de la taille du gâteau pendant la pandémie. Certains disposaient de temps, ils ont fait les courses pour leurs voisins vulnérables. D’autres disposaient d’argent. Un de mes amis a ainsi payé à l’avance 100 cafés dans son commerce de quartier assurant ainsi à ce dernier une précieuse entrée d’argent. Enfin une troisième catégorie de personnes disposait de mots. Les mots souvent considérés comme dérisoires par rapport aux actions « concrètes » ou aux contributions financières peuvent pourtant faire une grande différence quand il s’agit de téléphoner à une personne isolée ou de remercier sincèrement un livreur débordé.
Ces exemples inspirants nous donnent de l’espoir, même dans les périodes sombres. Malgré le chaos qu’elle a semé autour d’elle, cette crise nous aura au moins conduit définitivement à changer notre appréhension de ce qu’est une entreprise responsable. Nous délaissons la répartition du gâteau pour sa croissance par l’utilisation innovante de nos ressources. Cette approche peut être celle des entreprises, grandes ou petites, dans les périodes difficiles comme dans les périodes fastes, et des individus, y compris les plus jeunes salariés, non pas seulement les cadres supérieurs.
Un effort de collaboration
Il n’est pas question de l’entreprise ou de la société, mais bien de l’entreprise et de la société. Ce constat est source d’un grand espoir, mais aussi d’une grande responsabilité. Non seulement toutes les parties prenantes peuvent bénéficier d’un gâteau dont la taille croît, mais il est également de leur devoir de travailler ensemble pour y parvenir. Lorsqu’elles le font, unies par un objectif commun et dirigé vers le long terme, elles créent de la valeur de sorte à accroître les parts de chacun – actionnaires, salariés, clients, fournisseurs, environnement, communautés et contribuables. Il est prouvé que les dirigeants visionnaires peuvent transformer une entreprise, en augmentant la taille du gâteau au profit de tous comme peuvent le faire des actionnaires engagés intervenant dans une organisation défaillante ou de manière ascendante des salariés motivés et innovants.
La conduite des affaires orientées par une raison d’être est généralement plus rentable à long terme qu’une tentative de maximisation de la valeur actionnariale. C’est donc cette approche que les dirigeants devraient adopter volontairement, même en l’absence de défiance de l’opinion ou de menaces réglementaires. Créer de la valeur sociale n’est ni défensif ni simplement moral – c’est aussi une bonne affaire. Ce ne sont pas des vœux pieux, des preuves rigoureuses en attestent : pour atteindre les rives du profit suivez la constellation de la raison d’être.
Notes
- Note de la rédaction : nous traduisons ainsi le concept développé par l’auteur sous le nom anglais de pie growing mentality.
- Alex Edmans, Grow the Pie: How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit, 2020, Cambridge University Press (traduction française à paraître aux éditions Dunod).
- Alex Edmans, ‘Does the Stock Market Fully Value Intangibles? Employee Satisfaction and Equity Prices’, Journal of Financial Economics, 101, 2011, 621-640 ; Alex Edmans, ‘The Link Between Job Satisfaction and Firm Value, With Implications for Corporate Social Responsibility’, Academy of Management Perspectives 26, 2012, 1-19.
- Fornell, Claes, Sunil Mithas, Forrest V. Morgeson III et M.S. Krishnan, ‘Customer Satisfaction and Stock Prices: High Returns, Low Risk’, Journal of Marketing, 70, 2006, 3-14.
- Note de la redaction : l’auteur utilise dans la version originale le terme de stewardship.
- Derwall, Jeroen, Nadja Guenster, Rob Bauer et Kees Koedijk, ‘The Eco-Efficiency Premium Puzzle’, Financial Analysts Journal, 61, 2005, 51-63.
- Eccles, Robert, Ioannis Ioannou et George Serafeim, ‘The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance’, Management Science, 60, 2014, 2835–2857.
- Alex Edmans, Vivian W. Fang et Katharina Lewellen, ‘Equity Vesting and Investment’, Review of Financial Studies 30, 2017, 2229-2271.
- Caroline Flammer et Pratima Bansal, ‘Does Long-Term Orientation Create Value? Evidence from a Regression Discontinuity’, Strategic Management Journal 38, 2017, 1827-1847.
- Peter Georgescu, Capitalists, Arise!: End Economic Inequality, Grow the Middle Class, Heal the Nation, 2017, Berrett-Koehler Publishers, 118 (traduction par nos soins).
- Alon Brav, Wei Jiang, Frank Partnoy et Randall Thomas ‘Hedge Fund Activism, Corporate Governance, and Firm Performance’, Journal of Finance, 63, 2008, 1729-1775 ; Brav, Alon, Wei Jiang and Hyunseob Kim, ‘The Real Effects of Hedge Fund Activism: Productivity, Asset Allocation, and Labor Outcomes’, Review of Financial Studies, 28, 2015, 2723–2769 ; Alon Brav, Wei Jiang, Song Ma et Xuan Tian, ‘How Does Hedge Fund Activism Reshape Corporate Innovation?’ Journal of Financial Economics, 130, 2018, 237–264.
- Mozaffar Khan, George Serafeim et Aaron Yoon: ‘Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality’, The Accounting Review, 91, 2016, 1697-1724.
citer l'article
Alex Edmans, Le pouvoir de la raison d’être, Groupe d'études géopolitiques, Août 2022,
à lire dans cette issue
voir toute la revue





