Pour une gouvernance mondiale démocratique

Dominique Rousseau
Juriste et professeur de droit constitutionnelIssue
Issue #2Auteurs
Dominique Rousseau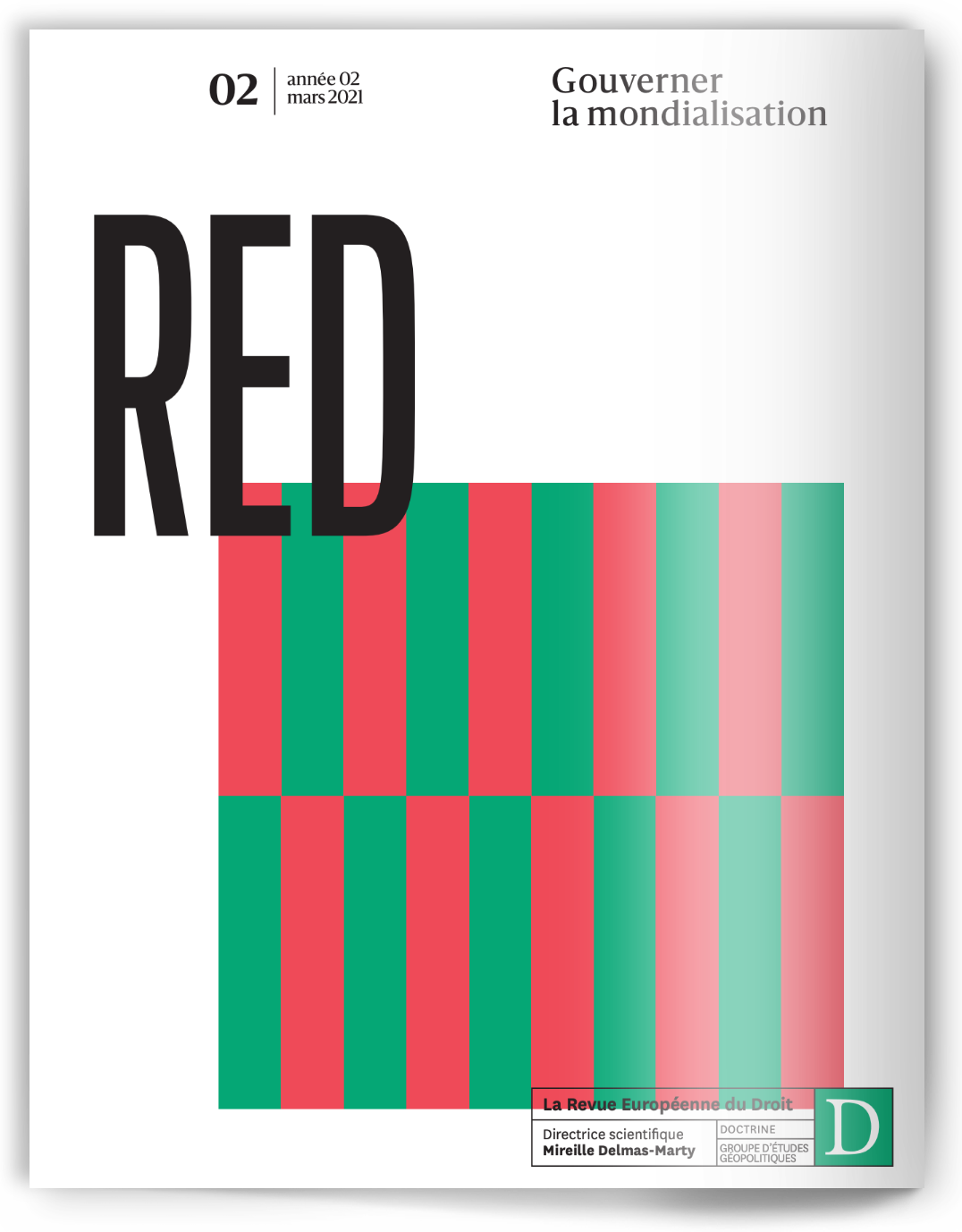
21x29,7cm - 186 pages Issue #2, printemps 2021 24€
Gouverner la mondialisation
Le coronavirus est une affaire mondiale. Les flux migratoires sont une affaire mondiale. Le réchauffement climatique est une affaire mondiale. Les inégalités sociales sont une affaire mondiale. La fraude fiscale est une affaire mondiale. L’égalité homme-femme est une affaire mondiale. La liberté de la presse est une affaire mondiale. Ces « affaires » n’engagent pas l’existence d’un peuple, d’un État ou d’un continent ; elles engagent l’existence de tous les peuples, de tous les États, de tous les continents. Au même moment. Il serait donc illusoire de penser ou laisser croire que chaque peuple, chaque État, chaque continent peut régler ces affaires « à sa manière », « selon sa libre décision ». Il faut abandonner le principe de souveraineté, principe devenu inutile et dangereux, abandonner le cadre national-étatique et proposer le principe de solidarité pour (re)fonder l’ordre politique mondial qui vient.
En 1941, Ernesto Rossi et Alterio Spinelli, militants antifascistes enfermés dans la prison de l’île de Ventotene écrivent un manifeste encore plus d’actualité en ce début de XXIe siècle : « L’idéologie de la souveraineté nationale a constitué un puissant levain de progrès ; elle a permis de surmonter bien des divergences basées sur l’esprit de clocher dans l’optique d’une plus vaste solidarité contre l’oppression des dominateurs étrangers. Elle portait cependant en soi les germes de l’impérialisme capitaliste. La souveraineté absolue des États nations a conduit à la volonté de domination de chacun d’eux, vu que chacun se sent menacé par la puissance des autres et considère comme son ‘espace vital’ des territoires de plus en plus vastes devant lui permettre de se mouvoir librement et de s’assurer ses moyens de subsistance sans dépendre de personne. En conséquence de cela, de garant de la liberté des citoyens, l’État s’est transformé en patron de sujets tenus à son service. Le problème qu’il faut résoudre tout d’abord – sous peine de rendre vain tout autre progrès éventuel – c’est l’abolition définitive de la division de l’Europe en États nationaux souverains ».
Cette conclusion en forme d’invitation n’a pas été entendue au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Elle doit l’être aujourd’hui, en 2021, pour sortir de la polycrise. Comme la Renaissance a fait émerger le principe de souveraineté et l’État, la mondialisation impose un autre principe d’organisation politique : le principe de solidarité entre les peuples pour gérer leurs biens communs en se dotant d’institutions mondiales.
Objectivement, toutes les économies, toutes les musiques, toutes les idées, toutes les émotions sont connectées. Objectivement, tous les peuples forment une communauté humaine mondiale multiculturelle. Objectivement, les humains partagent les mêmes situations, connaissent les mêmes conditions et vivent les mêmes évènements qui les constituent en un Être historique mondial. Et ce depuis longtemps s’il faut en croire Montaigne affirmant que « chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition ». Mais, subjectivement, cette humaine condition, cet Être historique mondial, cette communauté d’existence n’était pas ressentie par les peuples. Parce que tous les savoirs conduisaient chaque peuple à se vivre comme une singularité irréductible. Parce que la réaction spontanée, aujourd’hui encore, est d’objecter que les différences culturelles, démographiques, religieuses, économiques et politiques au sein du Monde interdisent de poser l’existence d’un Être historique mondial.
Mais, à ce titre, il deviendrait vite impossible de parler d’un Être historique français au regard des pratiques sociales qui varient parfois fortement d’un bout à l’autre de l’hexagone. Sauf à définir la société comme une réunion de clones, la diversité et même les différences n’empêchent pas de faire société ; elle en est au contraire la condition puisque faire société c’est toujours s’associer avec un autre que soi-même en trouvant avec cet autre les intérêts, les principes, les valeurs qui peuvent faire lien. L’Être historique mondial n’est pas l’expression d’un devenir hégélien de l’Être historique européen ou occidental. Il est construit et il se construit par la faculté des peuples de raisonner les uns avec les autres leurs ressemblances, leurs différences, leurs correspondances.
L’Être historique mondial n’est pas l’expression d’un devenir hégélien de l’Être historique européen ou occidental. Il est construit et il se construit par la faculté des peuples de raisonner les uns avec les autres leurs ressemblances, leurs différences, leurs correspondances.
dominique rousseau
Aujourd’hui, le subjectif rejoint l’objectif. Par la multiplication des crises – sociale, environnementale, sanitaire, etc – les peuples prennent conscience de « leur communauté de destins » selon les mots d’Edgar Morin, ressentent dans leur être ce que les artistes chantaient en 1985 : « we are the world ». Avec le coronavirus, chaque peuple fait l’expérience de la nécessaire coordination mondiale des scientifiques – qui ne sont pas tous dans un même pays ! – pour trouver le bon traitement ; fait l’expérience de la formule jusque-là abstraite et lointaine « la santé est un bien commun mondial » ; fait l’expérience des systèmes économiques qui les lient et les obligent à penser ensemble les modes de sortie de crise.
Cette expérience sensible ne doit pas être perdue ; elle doit se faire expérimentation selon le processus décrit par John Dewey, c’est-à-dire, manifestation par des actes et par des institutions de la conscience qu’ont les peuples de leurs expériences relationnelles. Si la santé est maintenant ressentie comme un bien commun mondial et non comme un concept, il devient possible de déconnecter ce bien des institutions étatiques-nationales pour le confier à une institution mondiale. Et il en est ainsi de la question du climat, de biodiversité, des flux migratoires, de la fraude fiscale, etc.
Que le moment historique invite à penser une gouvernance qui ne soit pas seulement mondiale mais aussi démocratique conduit à s’interroger sur l’acte juridique par lequel s’exprime le principe démocratique : la constitution. Le constitutionnalisme « global », « international », « mondial », « post-national » est, récemment, devenu un thème de réflexion des juristes internistes comme internationalistes. Et, à quelques exceptions près, les auteurs font ressortir les caractères contradictoire, illogique et aberrant de cette notion. Et ils ont raison.
Il est contradictoire de penser une constitution post-nationale alors que la constitution est « le génie d’un peuple » et qu’il n’existe pas de peuple post-national. Il est illogique de concevoir une constitution mondiale s’imposant aux États alors que l’ordre démocratique international est fondé sur le respect du principe de souveraineté de chaque État. Il est aberrant d’imaginer qu’une constitution mondiale puisse exprimer le vivre-ensemble de peuples aux histoires, traditions et cultures différentes. Ils ont raison … si et seulement si la réflexion reste enfermée dans le cadre conceptuel hérité des XVIIIe et XIXe siècles, c’est-à-dire, un cadre qui pense lier ensemble constitution, État, Nation et souveraineté. Or, ce cadre, qui, à son époque, a « révolutionné » le régime de compréhension et de perception de l’ordre des choses, doit, aujourd’hui, être repensé à l’aune de la société globale. Tous les cadres conceptuels bougent sous l’effet de la globalisation ; celui qui raconte le droit aussi.
Ce cadre conceptuel hérité des XVIIIe et XIXe siècles qui, à son époque, a « révolutionné » le régime de compréhension et de perception de l’ordre des choses, doit, aujourd’hui, être repensé à l’aune de la société globale. Tous les cadres conceptuels bougent sous l’effet de la globalisation ; celui qui raconte le droit aussi.
dominique rousseau
Jusqu’à une époque récente et peut-être encore aujourd’hui, les rapports entre droit international et droit constitutionnel étaient représentés sous la double figure opposée du monisme et du dualisme.
Pour les partisans de la représentation dualiste comme l’allemand Heinrich Triepel ou l’italien Dionisio Anzilotti, le droit interne et en particulier le droit constitutionnel et le droit international constituent deux systèmes juridiques égaux, deux disciplines étrangères l’une à l’autre, indépendantes et isolées l’une de l’autre. La validité des normes internes est indépendante de leur conformité au droit international. Cette séparation des deux disciplines est fondée, selon les dualistes, sur la différence des sources, des instruments juridiques et des destinataires. Le droit constitutionnel s’exprime par la volonté d’un État, le droit international par l’accord de plusieurs États ; le droit constitutionnel se manifeste par la constitution qui est un acte unilatéral, le droit international par un traité qui est un acte contractuel ; le droit constitutionnel a pour destinataires les citoyens, le droit international les États. Les deux ordres étant séparés, il ne peut y avoir de conflits normatifs entre eux et les normes d’un ordre ne sont pas obligatoires dans et pour l’autre ordre.
Pour les partisans de la thèse moniste, le droit international et le droit interne constituent un seul et même ordre au sein duquel les deux types de normes, internationales et internes, sont subordonnés l’un à l’autre. Pour les uns, par exemple l’École de Bonn représentée notamment par Erich Kaufmann, Max Wenzel (1920), le monisme est à primauté du droit interne puisque c’est la constitution de l’État qui fonde les compétences internationales de l’État et la place des traités internationaux. Pour d’autres, et par exemple « l’École normativiste autrichienne représentée par Kelsen et Verdross et défendue en France par Duguit et Scelle, le monisme est à primauté du droit international car ce dernier conditionne le droit interne et se trouve « au sommet de l’édifice juridique universel » selon la formule de Verdross.
Le choix serait donc entre l’indifférence ou la soumission. L’indifférence entre le droit international et le droit constitutionnel pour l’école dualiste qui ne permettrait pas de penser l’internationalisation du droit constitutionnel. Ou la soumission du droit international au droit constitutionnel ou du droit constitutionnel au droit international pour l’école moniste. Kelsen est certainement celui qui a le plus fortement théorisé cette soumission par sa métaphore de la pyramide des normes : « il ne saurait y avoir entre deux ordres normatifs, écrit-il, qu’un seul type de relation, celui d’ordres partiels et subordonnés dans l’unité supérieure d’un ordre total ».
Or, ces représentations ne sont plus aptes aujourd’hui à rendre compte des rapports entre droit constitutionnel et droit international. Le moment présent de l’internationalisation sociale oblige à repenser la structure de l’ordre juridique (I) et la légitimité de cette nouvelle structure (II).
1. L’affirmation d’une nouvelle représentation d’une gouvernance mondiale démocratique
1.A. La représentation d’une gouvernance en réseaux
L’inadéquation de la représentation kelsénienne – monisme avec primauté du droit international – ne tient pas seulement à la mondialisation. Elle tient d’abord à la structure logique de la théorie kelsénienne. En effet, sa conception pyramidale heurte sa propre conception de l’interprétation des normes puisque, selon Kelsen, les juges ne sont pas dans une situation de subordination par rapport aux normes ; ils doivent, pour les appliquer, déterminer leur signification, c’est-à-dire, les faire passer de la qualité d’énoncés juridiques à celle de normes juridiques et par conséquent le juge interne se trouve maître de la norme internationale. D’autre part, la pyramide ne tient debout selon Kelsen lui-même que par la norme hypothético-logique, la fameuse « Grundnorm » ; or, alors que la constitution devrait découler de la norme fondamentale, c’est la constitution, norme inférieure, qui est censée appeler l’hypothèse de norme qui lui est supérieure pour qu’elle lui apparaisse inférieure !
Évidemment, l’internationalisation, c’est-à-dire, l’émergence d’un espace mondial commun d’application des droits a mis au jour les contradictions logiques de la représentation pyramidale en montrant un enchevêtrement non hiérarchisé des droits. Le XIXe siècle fut celui où chaque État a mis de l’ordre dans le chaos par la production d’une constitution ; le XXe siècle celui où les États ont construit les relations entre les ordres internes, ce qu’on appelle le temps des rapports de système ; le XXIe siècle est celui où le droit ne se pense plus en termes « interne / externe » mais en termes d’ordre global. Sur le plan sémantique, il peut être intéressant d’observer que le droit européen se raconte de plus en plus dans le vocabulaire constitutionnel : la CEDH dit que la Convention est « l’instrument constitutionnel de l’ordre juridique européen » et la Cour de Luxembourg qualifie les traités instituant l’Union européenne de « charte constitutionnelle ». Et il en est de même pour les textes instituant l’ONU, l’OIT, l’OMS, etc.
Ce glissement sémantique ouvre sur des théories alternatives à celle de la hiérarchie des systèmes de droits. Certains essaient de sauver la vision kelsénienne est proposant le modèle d’une pluralité de pyramides normatives. D’autres, comme Ingolf Pernice, opposent au modèle pyramidal celui du « multilevel constitutionnalism ». D’autres aussi, comme François Ost ou Mireille Delmas-Marty, proposent un changement radical de paradigme en pensant les droits non plus sous la figure de la pyramide mais sous celle du réseau. L’internationalisation se manifeste par des processus d’interactions des systèmes constitutionnels qui mettent en œuvre une communicabilité juridique. Dans ce système en réseau, aucun élément du réseau n’est privilégié par rapport à un autre, aucun n’est uniquement subordonné à tel ou tel autre. Les droits constitutionnels sont connectés les uns aux autres, rétroagissent les uns sur les autres, cassent ainsi et la conception classique d’un droit constitutionnel national incommunicable et la conception d’un droit international séparé des droits constitutionnels.
L’ordre juridique mondial peut se raconter sous le signe d’une étoile. Il se construit par et avec les identités constitutionnelles. Il n’est pas une pyramide mais une étoile dont les branches sont les identités constitutionnelles, une étoile qui tire son énergie vitale de ses branches et qui donne à ses branches leur rayonnement et leur luminosité.
dominique rousseau
L’ordre juridique mondial peut se raconter sous le signe d’une étoile. Il se construit par et avec les identités constitutionnelles. En d’autres termes, il n’est pas une pyramide mais une étoile dont les branches sont les identités constitutionnelles, une étoile qui tire son énergie vitale de ses branches et qui donne à ses branches leur rayonnement et leur luminosité. L’ordre juridique mondial n’est pas le seul niveau de production normative ni un niveau autonome. Il puise dans les traditions constitutionnelles des États membres ses principes généraux, il prend dans les jurisprudences constitutionnelles son raisonnement, il laisse aux États une marge d’appréciation dans la mise en œuvre des droits fondamentaux, … En un mot, il fait vivre et vit de plusieurs niveaux de production normative, local, régional, national et international sans qu’un de ces niveaux soit, une fois pour toutes, en position de surplomb. Tous concourent et participent à la production de l’étoile constitutionnelle mondiale. En ce sens rencontre le mouvement d’internationalisation désétatique le constitutionnalisme contemporain.
Si le droit se pense désormais en réseau ou en étoile, alors il est possible de penser l’émergence d’une nouvelle discipline, d’un nouveau savoir, d’un nouveau régime d’intelligibilité de l’ordre juridique : le droit constitutionnel global ou international.
1.B. L’affirmation d’un constitutionnalisme mondial
La première condition de possibilité d’un droit constitutionnel international est la pensée d’une constitution mondiale ou globale. Elle se construit par le canal des standards constitutionnels mondiaux. Un standard désigne « un principe généralement partagé et reconnu » ; dès lors le droit constitutionnel global doit définir les modalités de la découverte de cette généralité partagée. Une des pistes possibles est celle ouverte par les travaux récents d’une jeune génération d’historiens qui redessine une « Histoire connectée » tendant à comprendre l’histoire en retenant des points de vue plus divers que ceux des européens ou des occidentaux, comme l’illustre notamment l’ouvrage de Romain Bertrand, « Histoire à part égales » 1 .
Ces travaux sont peut-être une voie à suivre par les juristes pour découvrir les standards constitutionnels mondiaux sous l’égide du « droit connecté », c’est-à-dire, un droit qui aurait pour avantage de s’attacher aux situations de contacts et aux circulations de concepts. Les standards ne seraient pas recherchés par la juxtaposition de systèmes juridiques présentés comme pérennes ni dans un « modèle », présenté comme universel et donc censé s’appliquer à l’ensemble du système constitutionnel mondial. Ils seraient construits par la connexion des réseaux constitutionnels qui constituerait l’espace constitutionnel mondial.
Dans le paradigme classique du droit constitutionnel et du droit international tout entier structuré autour des principes État et Souveraineté, il est souvent soutenu que cet espace n’est pas pensable. À tort. Car, sans avoir besoin de changer de paradigme, en restant à l’intérieur du régime classique d’intelligibilité constitutionnelle et internationale, il est permis de poser l’hypothèse d’un espace constitutionnel mondial. Les trois éléments habituellement retenus par les juristes pour identifier un ordre juridique sont, en effet, présents : un territoire (la planète), un peuple (l’humanité) et un pouvoir légitime sur ce territoire à l’endroit de cette humanité (l’ONU et ses institutions dont la Cour internationale de Justice). Dans cet espace constitutionnel mondial, des standards constitutionnels mondiaux peuvent ainsi émerger de la connexion des réseaux constitutionnels auxquels participent de multiples acteurs, publics, associatifs et privés.
La seconde condition de possibilité d’un droit constitutionnel global est de repenser le cadre d’analyse traditionnel des liens entre constitution, État et peuple. Deux objections sont, en effet, immédiatement opposées : une constitution a pour objet l’État et puisqu’il n’y a pas d’État mondial il ne peut y avoir de constitution mondiale et donc de droit constitutionnel global ; une constitution étant le « génie d’un peuple », le peuple mondial n’existant pas il ne peut pas davantage y avoir de constitution globale.
Mais, il faut relire l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution ». Autrement dit, l’objet d’une constitution n’est pas seulement l’État mais la société à laquelle elle donne forme et non seulement l’État puisque toutes les activités des individus saisies par le droit peuvent être rapportées à la constitution ; ce qui, dans le langage juridique, se traduit par les expressions « constitutionnalisation » du droit civil, du droit du travail, du droit social, du droit commercial, du droit administratif, du droit pénal, etc., c’est-à-dire, par l’idée que toutes les branches du droit, et pas seulement le droit politique, trouvent leurs principes dans la constitution. Au demeurant, que la constitution soit l’acte qui informe – au sens philosophique du terme – la société n’est une rupture qu’au regard de l’habitude prise de penser la constitution comme acte organisant les pouvoirs publics.
Quand Montesquieu imagine la constitution idéale, il part d’une analyse de la société, d’une analyse des « puissances sociales » – noblesse, bourgeoisie, etc. – et recherche une structure de pouvoir exprimant la structure sociale ; quand Rousseau rédige son projet de constitution pour la Corse, il prend explicitement pour base et objectif de son travail la structuration du corps social corse. Cette conception de la constitution-expression de la société s’est effacée lorsque s’est imposée, tout au long du XIXe siècle, l’idée qu’elle était seulement le statut particulier des gouvernants ; elle réapparaît logiquement aujourd’hui avec l’émergence et le développement de l’idée de constitution-garantie des droits qui contribue à déployer la constitution sur l’ensemble des activités sociales.
De même, l’existence d’un peuple mondial n’est pas davantage la condition préalable à une constitution mondiale. « On ne nait pas femme, on le devient » a écrit Simone de Beauvoir ; on ne nait pas citoyen du monde, on le devient par le geste constituant. La force du droit, reconnaissait Pierre Bourdieu est d’instituer, c’est-à-dire, de faire exister ce qu’il énonce, de donner vie à ce qu’il nomme. Ainsi en sera-t-il de la constitution mondiale qui en nommant le citoyen du monde le fera exister « en vrai ». C’est la force magique, souvent ignorée, des mots du droit et en particulier des mots de la constitution de faire advenir ce qu’ils énoncent.
La force du droit est d’instituer, c’est-à-dire, de faire exister ce qu’il énonce, de donner vie à ce qu’il nomme. Ainsi en sera-t-il de la constitution mondiale qui en nommant le citoyen du monde le fera exister « en vrai ». C’est la force magique, souvent ignorée, des mots du droit et en particulier des mots de la constitution de faire advenir ce qu’ils énoncent.
dominique rousseau
Reconnaissant en Siéyès le père de la théorie du peuple sujet du pouvoir constituant, Carl Schmitt, dans son ouvrage « La théorie de la constitution », réactualise et renforce les idées de l’abbé en considérant que si le peuple est le sujet du pouvoir constituant et si la constitution est l’acte du peuple capable d’agir politiquement, « il faut que le peuple soit existant et présupposé comme unité politique ». La notion de « peuple » n’est sans doute pas la même chez Siéyès et chez Schmitt ; elle est renvoyée à une origine et une homogénéité ethnique chez le second, au droit naturel chez le premier. Mais, les deux discours expriment cette même idée du peuple, quelle que soit son identité, au-dessus et avant la constitution.
Il faut convenir que cette représentation savante des rapports entre peuple et constitution a l’immense mérite de « faire vrai » en faisant spontanément écho au langage ordinaire qui présente généralement le peuple comme l’auteur de la constitution. L’efficacité des deux discours, savant et ordinaire, produit ainsi une vérité d’évidence, de bon sens, une « illusion bien fondée » selon la formule de Durkheim, qui renforce le système et qu’il parait évidemment absurde de discuter.
Et pourtant, il n’est pas interdit de déconstruire cette représentation et de soutenir que le « génie de la constitution c’est le peuple » ou, plus exactement encore, que « le génie du processus constituant c’est le peuple ». Le citoyen du monde, en effet, n’est ni une donnée immédiate de la conscience, ni une donnée naturelle ; il est le résultat d’un processus continu et souvent conflictuel d’intégration d’individus, de groupes, de communautés au départ étrangers les uns aux autres et qui, par l’action du droit et des institutions que la constitution établit, vont se trouver liés par des questions communes à débattre et à résoudre, par des valeurs communes, par des services communs qui, à leur tour, vont développer un sentiment de solidarité qui constitue l’Être historique mondial. Une constitution mondiale sera ce moment de cristallisation du processus de formation de l’Être historique mondiale offrant aux citoyens du monde l’instrument leur permettant de se voir comme tels. L’Être historique mondial existe mais il n’accédera à la vue que par le geste constituant qui lui donnera vie.
2. L’affirmation d’une nouvelle représentation de la légitimité démocratique d’une gouvernance mondiale
2.A. Le principe de l’en-commun mondial
L’inadéquation politique du principe de souveraineté. Les constitutions nationales se sont fondées et ont mis en œuvre le principe de souveraineté pour exprimer la légitimité d’un peuple national à déterminer lui-même les règles de son vivre-ensemble. Il ne peut être le principe qui fonde et met en œuvre la légitimité politique d’action de l’Être historique mondial. D’autant que ce principe est devenu vide et dangereux.
Vide d’abord parce que, selon les mots de Sandana Shiva, « la mondialisation a modifié génétiquement l’État ; il ne représente plus les intérêts des citoyens mais ceux des sociétés multinationales ». L’histoire du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est implacable : en son nom, un peuple revendique et se dote d’un État et ensuite cet État dispose de son peuple et cherche en plus à disposer d’autres peuples. Ce qui est en cause est donc le principe de souveraineté. Il a été inventé en 1576 par Jean Bodin comme une arme idéologique au service du Roi qui, à l’époque, cherchait un argument lui permettant en haut de contester le pouvoir du Pape et en bas de soumettre les seigneurs de son royaume. Sans doute utile à ce moment de l’histoire, il ne l’est plus aujourd’hui. Il est devenu un principe vide. La souveraineté nationale ne veut plus rien dire quand les grands contrats internationaux opèrent des transferts de technologie et que les produits ne sont plus fabriqués par et dans un seul pays mais à partir de composants venant de tous les continents. La souveraineté nationale ne veut plus rien dire quand les barrières commerciales sont abolies entre les États comme elles l’ont été autrefois entre les provinces du Royaume. La souveraineté nationale ne veut plus rien dire quand les communications tendent à universaliser les consciences.
Dangereux ensuite parce que le principe de souveraineté conduit l’État qui s’y réfère à vouloir s’assurer les moyens de vivre, à promouvoir sa liberté d’existence et, pour ce faire, à imposer sa domination sur les États plus faibles. Un exemple : la Catalogne veut devenir l’État du peuple catalan alors qu’elle vit dans un État, l’Espagne, dont la constitution reconnaît l’existence des peuples d’Espagne dont le peuple catalan qui, comme le peuple basque ou le peuple andalou, jouit d’une autonomie politique ! Autrement dit, la Catalogne ne veut plus vivre avec d’autres peuples au sein d’un État ; elle veut devenir un État-nation, l’État d’un peuple. Ainsi elle sera enfin souveraine, libre de s’organiser comme elle l’entend.
Dangereuse illusion souverainiste dont il est facile d’imaginer le déroulement catalan tant elle a produit et produit toujours et partout les mêmes résultats. À supposer que la Catalogne devienne un État souverain, au départ, le soleil brillera : celui de la République, du drapeau, de la langue, du mode de vie, du bonheur d’être enfin entre soi. Puis, rapidement, les nuages vont s’amonceler. À l’intérieur, Taragone, Lerida vont demander de pouvoir s’administrer librement. Mais surtout, à l’extérieur, la Catalogne va devoir promouvoir son existence, se préoccuper de son propre développement sans trop s’embarrasser des conséquences pour les voisins. Née pour se libérer du « joug » espagnol, la Catalogne deviendra un État-nation imposant son « joug » à l’intérieur et à l’extérieur.
L’émergence du principe de l’en-commun mondial. Comme la Renaissance a fait émerger le principe de souveraineté et l’État, la globalisation impose un autre principe d’organisation politique : la loi des multinationales, écrit Vandana Shiva, ne sera pas contrée par les États-Nations mais par un « réveil mondial des citoyens ». Avec la globalisation, un nouveau monde commence, fait du pluralisme des conceptions de vie, d’espaces post-nationaux de délibération, de revenus détachés de la force de travail, d’institutions mondiales de décision en matière de santé, d’environnement, de climat, d’alimentation… Il faut donc à ce monde qui commence un nouvel esprit-principe pour le guider : le monde qui finit avait pour principe la souveraineté ; le monde qui vient a pour principe la coopération loyale entre les peuples, le principe de l’en-commun pour reprendre la proposition de Monique Chemille-Gendreau, celui de biens communs que les peuples partagent et qu’ils doivent gérer en se dotant d’institutions post-étatiques. Et ce principe doit inspirer l’écriture de la prochaine constitution mondiale.
L’idée est loin d’être admise et certains à la manière de Finkielkraut, grognent, vitupèrent et anathématisent contre la disparition du principe de souveraineté. Ils ont tort. La posture angoissée au présent conduit toujours à une nostalgie du passé qui finit par alimenter le désir d’un retour à ce qui est présenté non comme l’ordre ancien des choses mais comme l’ordre vrai, l’ordre naturel et authentique de la réalité humaine. Le passé est transformé en mythe, le travail du sens est arrêté et les choses sont immobilisées à un moment de leur histoire. Qu’un monde finisse ne signifie pas que le monde est fini. Aux dernières lignes de ses Mémoires d’Outre-Tombe, Chateaubriand écrit : « on dirait que l’ancien monde finit et que le nouveau commence » …
Dans son ouvrage Politique, Aristote définit la Cité comme une communauté du bien vivre pour les foyers et les lignages en vue d’une vie accomplie et autosuffisante. Cette définition renvoie à trois fonctions de la Cité : une fonction économique – assurer la satisfaction des besoins de la collectivité – une fonction sécuritaire – assurer la défense contre les ennemis – et une fonction morale – permettre aux hommes de bien vivre ensemble. Et pour Aristote, c’est cette dernière fonction qui permettait de caractériser la Cité par rapport aux simples conventions d’utilité commune. Simple convention d’utilité commune, voilà ce qu’a été, globalement, le Monde jusqu’à présent. Cité constitutionnelle, voilà le Monde qu’une constitution mondiale instituera. Ce n’est pas en effet le même Monde qui est institué selon qu’il l’est par les catégories du droit international ou par les catégories du droit constitutionnel.
Simple convention d’utilité commune, voilà ce qu’a été, globalement, le Monde jusqu’à présent. Cité constitutionnelle, voilà le Monde qu’une constitution mondiale instituera. Ce n’est pas en effet le même Monde qui est institué selon qu’il l’est par les catégories du droit international ou par les catégories du droit constitutionnel.
dominique rousseau
Avec la catégorie Traité, les allemands, les italiens, les espagnols se perçoivent comme des étrangers appartenant à des États différents qui marquent leur identité et qui concluent entre eux des accords ; avec la catégorie Constitution, ils se perçoivent comme des membres d’une même famille aux histoires sans doute différentes mais réunis sous une même loi. Avec la catégorie Traité, peut se manifester, au mieux, une opinion publique mondiale qui exercera un pouvoir d’influence plus ou moins efficace ; avec la catégorie Constitution, l’opinion publique mondiale est transformée en communauté de citoyens du Monde et le pouvoir d’influence en pouvoir de décision politique. Avec la catégorie Traité, les individus sont pris comme des personnes et des consommateurs ; avec la catégorie Constitution, ils acquièrent la qualité de citoyen, c’est-à-dire, d’acteurs politiques. Si le « moment » constitution opère une rupture avec le « moment » traité, le passage de l’un à l’autre n’est pas nécessairement brutal ; il se fait, il se prépare, il se travaille sous l’empire des traités.
2.B. Le principe d’un jus-commun mondial
Les juges sont les acteurs principaux de ce constitutionnalisme transnational. L’internationalisation se manifeste, en effet, par une globalisation judiciaire suscité par la survenance presque simultanée devant différentes juridictions nationales ou/et régionales de questions juridiques identiques, le plus souvent dans le domaine des droits de l’homme et du droit pénal mais aussi du droit économique ou du droit des affaires. Les juges sont ainsi sollicités de prendre des décisions dont le champ dépasse largement les frontières de l’ordre juridique interne dans lequel ils opèrent et qui portent sur des questions impliquant des aspects de droit international ou de droit étranger ou des questions dont les juges savent qu’elles ont déjà été traitées par un tribunal étranger. Toutes ces circonstances encouragent les juges à examiner des solutions adoptées en dehors de leur ordre juridique national et à établir des relations avec les juridictions étrangères concernées.
Ce phénomène conduit les juges nationaux à travailler sur une base transnationale, à dialoguer et à s’emprunter les uns les autres, à rechercher des informations auprès de leurs collègues, à se rencontrer pour partager leur jurisprudence. Les juges ne subissent pas l’influence internationale ; ils sont les acteurs de ce transnationalisme juridique, de cette diplomatie juridictionnelle mondiale où se construit une communauté constitutionnelle mondiale. Ce dialogue est multiple, entre les juges nationaux et entre les juges nationaux et les juges régionaux ; il peut être tendue ou difficile comme le montre les relations entre la CEDH et la CJUE, entre la CEDH ou la CJUE et les Cours constitutionnelles nationales. Mais, au total, une jurisprudence constitutionnelle globale émerge faite par la participation des juridictions constitutionnelles à des réseaux juridictionnels.
D’où les inévitables questions : est-il légitime pour un juge national de consulter la jurisprudence étrangère pour décider d’une affaire interne et est-il légitime que cette construction des standards constitutionnels internationaux soit le fait des juges et non du peuple ou de ses représentants élus ? Ces questions légitimes ouvrent sur une reconsidération de l’exigence démocratique contemporaine qui ne résume pas ou plus au pouvoir de suffrage.
La garantie des droits est devenue un code d’accès à la qualité démocratique d’une gouvernance et les juges en sont les vecteurs.
Au demeurant, l’autorité des jurisprudences étrangères sollicitées par un juge national n’est qu’une autorité de persuasion en ce qu’elles peuvent offrir un éclairage ou un raisonnement plus convaincant sur des questions identiques ou similaires. Ensuite, cette construction par les juges d’un constitutionnalisme transnational s’appuie sur des standards constitutionnels issus des principaux traités et pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par les États. Enfin et en conséquence de ce qui précède, la légitimité de cette œuvre juridictionnelle repose sur le principe de bonne foi dans la mesure où il contraint les États à respecter les conventions, pactes et traités internationaux qu’ils ont signé et d’où sont issus les standards constitutionnels internationaux. Les juges cristallisent et donnent son effectivité au patrimoine constitutionnel mondial et participent ainsi à rendre la gouvernance mondiale démocratique puisqu’elle n’est plus seulement entre les mains des États mais aussi dans celles des citoyens par l’accès aux juges qui imposent aux États le respect des droits fondamentaux.
Conclusion
L’enjeu est donc important et le moment d’oser le choix de la voie constituante ne peut plus longtemps être différé. Car la situation actuelle n’est pas satisfaisante : les États ont transféré nombre de leurs compétences mais gardé la légitimité démocratique ; les organisations régionales et internationales ont reçu des compétences mais n’ont pas de légitimité démocratique. Dès lors, de quelque manière que l’on tourne les choses, ou bien il faut remettre les compétences où se trouve la légitimité, ou bien il faut porter la légitimité où se trouvent les compétences. Chacune des deux réponses possède sa logique et sa cohérence propres ; il est temps d’assumer un choix clair et radical sans se perdre dans un consensuel « bon petit mélange » des deux positions. Et, si on choisit la seconde – ce qui est mon cas – ouvrir maintenant le processus d’une constitution mondiale organisant une gouvernance mondiale démocratique.
De quelque manière que l’on tourne les choses, ou bien il faut remettre les compétences où se trouve la légitimité, ou bien il faut porter la légitimité où se trouvent les compétences. Chacune des deux réponses possède sa logique et sa cohérence propres ; il est temps d’assumer un choix clair et radical sans se perdre dans un consensuel « bon petit mélange » des deux positions.
dominique rousseau
« Un jour viendra, écrit Victor Hugo, où vous toutes, nations du continent européen, sans perdre vos qualités distinctes, vous vous fonderez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne et un jour viendra aussi où, plus transfigurée encore, elle s’appellera l’Humanité ». « Un jour viendra ». Le plus tôt serait le mieux pour éviter que vienne la nuit brune !
Notes
citer l'article
Dominique Rousseau, Pour une gouvernance mondiale démocratique, Groupe d'études géopolitiques, Juil 2021, 101-106.
à lire dans cette issue
voir toute la revue





