Travail, amour et (dé)colonialité dans les relations de travail

Flavia Souza Maximo Pereira
Professeure de droit du travail à l'Université fédérale d'Ouro Preto au BrésilIssue
Issue #4Auteurs
Flavia Souza Maximo Pereira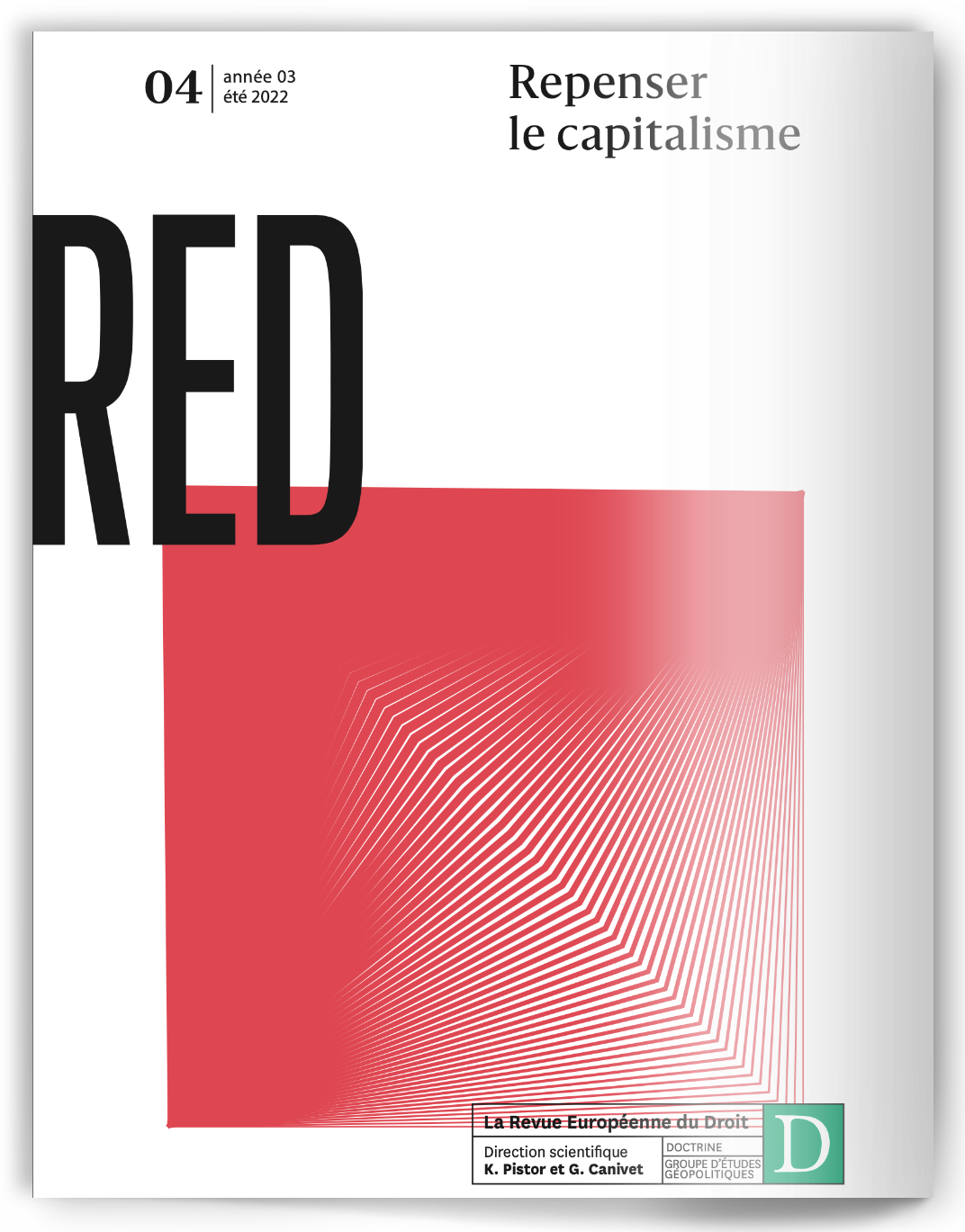
La Revue européenne du droit, été 2022, n°4
Repenser le capitalisme
Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem, quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas.
Conceição Evaristo
Travail et amour. Pour moi, c’est une combinaison intrigante. Ce sentiment est-il autorisé lorsque nous travaillons ? Lorsque je pense à l’amour, il est inévitable de penser à la liberté de choisir, de ressentir, de penser, de respirer en ces temps étouffants. Cette liberté est ce qui nous rend humains.
En théorie, cette liberté devrait être garantie par le droit du travail, qui a révolutionné dans la modernité le concept de liberté de choix. Le droit du travail a rendu intelligible l’asymétrie de la liberté humaine. Il a mis en exergue la façon dont cette asymétrie se manifestait dans le concret de la chair, comment elle devait être compensée par la construction juridique de la relation de travail, afin que les corps laborieux puissent être libres, afin que les corps de laborieux puissent être des humains.
Contrairement aux modèles de l’esclavage et de la servitude, le cœur du droit du travail est constitué par cette liberté dans la relation de travail. Le salarié vend sa force de travail – et non son corps – sous le pouvoir directif de l’employeur, dans une combinaison paradoxale de travail libre 1 et subordonné 2 . Mais dans quelle mesure ce corps laborieux est-il libre ? Est-il possible de séparer la force de travail du corps laborieux ? Existe-t-il une liberté de choisir le travail, d’aimer le travail ?
Nous savons que le droit du travail, dans les relations juridiques, est l’un des plus grands accomplissements de la modernité. La relation de travail elle-même représente une réalisation subalterne 3 . Elle est le résultat d’un savoir critique développé pour résister à l’oppression vécue par la classe ouvrière. Rien de tout cela ne se passe dans un espace de pure imagination, mais dans un espace de violence vécue collectivement 4 .
Et pourtant, cette réussite est constamment menacée par des politiques d’austérité 5 , axées sur la peur sociale, rendant la classe ouvrière responsable de sa propre pauvreté. Avec ces mensonges construits 6 , la relation de travail est considérée comme un obstacle à la croissance économique, à l’esprit d’entreprise et à la création d’emplois 7 . Par conséquent, un état d’exception dans le droit du travail est établi 8 . Ces politiques d’austérité ne peuvent qu’aboutir à des mesures antidémocratiques 9 qui renforcent les inégalités intersectionnelles dans le monde du travail.
Par conséquent, la relation de travail est une arme juridique contre-hégémonique en termes politiques et épistémiques. Et c’est pourquoi nous nous battons encore pour le droit du travail. C’est pourquoi nous travaillons toujours à défendre son épistémologie. Parce que la simple destruction de l’emploi protégé, comme cela s’est produit dans la plupart des juridictions, n’est rien d’autre qu’un nouvel approfondissement de la colonialité, du racisme, du sexisme et des LGBTphobies. Ce sont ces corps qui subissent fortement et en premier lieu les effets de la précarité au travail. Et c’est aussi pour cela que lorsque nous critiquons ici le Droit du travail, en pointant la colonialité juridique de la relation de travail, nous le défendons aussi. Avec affection. Avec amour. Malgré toutes ses contradictions.
Ces contradictions me laissent constamment perplexe. La perplexité, selon Priti Ramamurthy 10 , est le site de convergence de « multiples idéologies qui constituent des sujets – pratiques culturelles, temporalités et lieux ». Cette perplexité me fait remettre en question mon affection pour le droit du travail. Cette perplexité m’amène à me demander : à partir de quel point de départ épistémique les principales catégories du droit du travail ont-elles été créées ? Comment les catégories principales du droit du travail sont-elles traduites dans différents contextes géopolitiques ? Qui est le sujet épistémique du droit du travail ? Quelles sont les relations entre les spécificités du corps de chaque travailleur et sa protection juridique dans le droit du travail ?
La perplexité est la simultanéité des joies et des peines qui nous animent 11 . C’est ce que je ressens à l’égard du droit du travail. Est-ce de l’amour ? Pour aimer quelqu’un, il est nécessaire de se déshabiller. De révéler aussi ce que nous ne voulons pas montrer. De révéler nos parties les plus laides. Celles que nous nous obstinons à cacher, même à nous-mêmes. On aime quelqu’un quand on peut pénétrer au cœur de son être. En connaissant ses secrets les plus intimes. Malgré toutes ces contradictions.
Mais le droit du travail insiste pour garder ses secrets épistémiques 12 . Son sujet épistémique nous apparaît dépourvu de race, de genre, de sexualité, de langue ou de place dans une quelconque relation de pouvoir 13 . Pour se révéler, le droit du travail doit être vu sous l’angle géopolitique et dans sa relation aux corps – sous l’angle de la politique de la connaissance 14 . Il s’agit de reconnaître sa position économique, sociale, épistémique et ontologique. Comme l’a dit Sumi Madhok, la production juridique de connaissances situées doit tenir compte de « l’endroit d’où l’on regarde et de ce que l’on voit 15 ».
Pour aimer le droit du travail, il est nécessaire de comprendre pourquoi son corps épistémique reste si éloigné de la réalité du corps laborieux. J’ai besoin de comprendre pourquoi le droit du travail n’atteint pas le vendeur de rue brun, ou le travailleur domestique noir qui nettoie les maisons des blancs ; pourquoi il ne parle pas le langage du ramasseur de déchets dans le Sud global, ou du transsexuel qui travaille comme prostitué 16 . La plupart de ceux qui ressentent dans leur chair les exploitations les plus profondes du travail n’ont jamais connu la protection du droit du travail. Ils n’ont jamais été dans une relation d’emploi. Sous l’angle des catégories du droit du travail, leur activité est un travail « atypique ». Cependant, le travail salarié « typique », régi par la relation d’emploi standard, n’a jamais exprimé, et n’exprime toujours pas, l’étendue des relations productives, en particulier dans les pays du Sud global.
Comment aimer et se battre pour quelque chose d’inconnu ? Comment aimer quelqu’un qui n’a pas de couleur, pas d’identité, pas de désir ? Cette fracture entre l’épistémologie du droit du travail et l’expérience des travailleurs est-elle accidentelle ou s’agit-il d’un projet délibéré ?
Celui qui aime doit dire la vérité. Alors, écoutez-moi. Il y a une colonialité juridique dans le droit du travail 17 . Le droit du travail est aussi centré sur l’assujettissement des corps, sous le vernis de la subordination juridique, qui a toujours soutenu la colonialité du pouvoir.
Parmi les concepts centraux utilisés par les études décoloniales 18 , la colonialité du pouvoir démontre que les relations coloniales dans l’économie, la politique, la société et l’épistémologie n’ont pas pris fin avec la destruction formelle de la colonisation. La colonialité nous permet de comprendre la continuité des formes de domination coloniale au-delà de la colonisation.
Selon Quijano 19 , la modernité était caractérisée par un modèle de pouvoir mondial qui contrôlait diverses formes d’existence sociale. Il s’agissait d’un complexe de pouvoir structurel, caractérisé par la domination, l’exploitation et le conflit dans l’espace du travail, de l’autorité collective, du sexe et, enfin, celui de la production de connaissances.
Ce modèle de pouvoir moderne a imposé, comme moyen de contrôle du travail, le système de capitalisme racial 20 , pour établir une différence entre le colonisé et le colonisateur ; l’État-nation, comme forme centrale d’autorité collective ; la famille blanche bourgeoise, comme institution de contrôle de l’activité sexuelle 21 ; et, enfin, l’eurocentrisme, comme forme hégémonique de production du savoir 22 .
L’eurocentrisme 23 ne se réfère pas à toute l’histoire intellectuelle de l’Europe occidentale, mais à une forme spécifique de rationalité qui est devenue hégémonique au niveau mondial et a colonisé toutes les autres et leurs connaissances concrètes respectives, tant en Europe que dans le reste du monde.
La pensée décoloniale propose un projet de détachement du modèle de connaissance eurocentrique. Il ne s’agit pas d’une simple négation de toutes ses catégories dans une autre perspective totalitaire du savoir. Loin de là, la pensée décoloniale veut s’écarter du modèle rationalité-modernité-colonialité. En fin de compte, la décolonialité de la connaissance cherche à créer des stratégies pour restaurer « tout pouvoir qui n’est pas constitué par la décision libre d’un peuple libre, [car] c’est l’instrumentalisation de la raison par le pouvoir colonial, en premier lieu, qui a produit des paradigmes de connaissance déformés et l’échec des promesses libératrices de la modernité ».
Alors que nous discutons de la démocratisation des lieux de travail, rappelons que plus de deux milliards de travailleurs exercent des activités qui ne sont pas du tout protégées par des relations d’emploi formelles. 61 % des travailleurs dans le monde sont engagés dans des relations informelles 24 . En outre, les inégalités de revenus entre les travailleurs du Sud global et du Nord ont augmenté au cours des dernières décennies. Par conséquent, la démocratisation des relations de travail passe nécessairement par la décolonisation de la production de connaissances du droit du travail.
Nous savons que décoloniser l’épistémologie du droit du travail ne signifie pas revendiquer la supériorité des pratiques subalternes sur le savoir eurocentrique. Il s’agit de voyager entre les mondes et d’être conscient du voyage en soi, sans se précipiter vers une conciliation. Décoloniser, c’est savoir composer avec des épistémologies plurielles, non hiérarchisées. C’est se confronter à différentes aires de vie normatives, en sachant qu’elles vont se heurter et interagir. C’est à partir de ces chocs normatifs que pourra émerger une raison cosmopolite 25 .
Parce que décoloniser n’est pas diversifier. Ce n’est pas bouger à la surface. C’est théoriser dans les entrailles épistémiques. La décolonisation exige de poser des questions différentes, avec un véritable intérêt pour la théorie produite dans le Sud global. Cela implique de renoncer aux postes de direction universitaire, de reconnaître les privilèges de classe, de race, de sexe et de nationalité. Cela implique de révéler l’assise épistémique à partir de laquelle on parle. Cela implique de laisser tomber les revendications de diversité non performatives 26 . Cela implique de refuser les partenariats théoriques avec ceux qui ne sont pas engagés dans des pratiques visant à accroître la justice sociale dans le Sud global et le Nord. Cela demande des efforts et de la volonté pour changer le transit épistémique de la production de connaissances. Il faut du courage pour prendre des risques. Pour changer les flux de la division sociale du travail scientifique et la signification même de ce travail.
Décoloniser le Droit du travail est un pari difficile et douloureux car il s’agit de se défaire de catégories qui nous ont captivés et amenés ici. Si nous sommes ici, c’est parce que notre affection nous a amenés sur le territoire du droit du travail.
Cependant, qui aime doit dire la vérité. Alors, écoutez-moi. Il faut dénoncer l’assujettissement des corps que permet la colonialité juridique du droit du travail. Par le biais de la subordination juridique, le droit du travail prétend que la liberté d’une partie des corps laborieux existe dans le capitalisme. Et cela signifie également que cet assujettissement concret est plus violent pour certains corps que pour d’autres dans ce système moderne/colonial.
Comme le souligne Walter Mignolo 27 , au XVIIIe siècle, les philosophes laïques européens ont célébré l’abandon de la théologie et l’avancée en direction du monde scientifique rationnel de la modernité. Cependant, cette « nouvelle » rationalité scientifique était un modèle quelque peu totalitaire car elle niait le caractère scientifique à toutes les formes de connaissance qui n’étaient pas guidées par ses principes épistémiques eurocentriques d’ « universalité », d’ « objectivité » et d’ « impartialité 28 ». Contrairement au savoir eurocentrique, les formes de production scientifique créées par les peuples colonisés étaient jugées naïves, irrationnelles et non civilisées 29 . Même s’il prétendait que sa production scientifique était universelle, l’eurocentrisme se situait également dans des relations de pouvoir 30 . Et sa production de connaissances était auto-centrée, maintenant la division moderne capitaliste raciale-sexuelle du travail, y compris du travail scientifique.
Par conséquent, selon Mignolo 31 , la révolution scientifique, ainsi que le siècle des Lumières, malgré ses immenses contributions, peuvent être considérés comme une espèce de « révolution faite maison », car il y a une plus grande continuité paradigmatique qu’une rupture : un changement au sein de la même tradition blanche, masculine, chrétienne et occidentale, qui continue à rejeter les autres formes de connaissance non européennes.
Bien qu’établi dans la colonisation, l’eurocentrisme reste la référence de la production mondiale de connaissances ; d’où le terme de colonialité des connaissances. L’épistémologie du droit du travail, ses fondements et ses catégories clés sont imprégnés de cette colonialité.
Dans ce contexte eurocentrique, l’idée de la différenciation des relations de travail modernes apparaît. Le travail libre et subordonné semble établir un contrepoint aux formes de travail précapitalistes précédemment expérimentées, à savoir l’esclavage et la servitude 32 . L’aporie du travail libre et subordonné est également exaltée comme une forme de résistance à l’idée de pure autonomie de la volonté, incarnée par le Droit civil : le droit du travail a su reconnaître l’asymétrie de fait entre les parties, en accordant une protection juridique au salarié. C’est ainsi que se forge une autre idéologie : l’universalisation du système capitaliste, dont la régulation normative est centrée sur le travail libre et subordonné.
Le droit du travail latino-américain a importé cette théorie eurocentrique, reproduisant le parallèle temporel de l’esclavage et de la servitude, pour exalter la relation de travail comme une révolution de liberté dans la modernité pour tous les travailleurs, pour tous les humains, car tous devraient avoir le droit de choisir, de sentir, de penser, de respirer et d’aimer.
Cependant, en Amérique latine, les formes de contrôle du travail n’ont pas émergé de cette séquence historique. Aucune d’entre elles n’était une simple extension d’anciennes formes précapitalistes. Elles n’étaient pas incompatibles avec le capitalisme. La servitude, l’esclavage et le travail libre étaient exercés ensemble dans un système-monde capitaliste. Et ils ont été combinés avec l’idée phénotypique de la race, associée à la couleur de la peau, et avec le genre. Cela a été fait dans le but de légitimer les relations de domination entre colonisateur et colonisé, de naturaliser les fonctions inférieures dans la division sociale du travail et de classer les gens en humains et antihumains. Ces derniers n’avaient pas le droit de choisir, de sentir, de penser, de respirer ou d’aimer, car ils n’étaient que de la chair.
Les « indigènes » étaient confinés à la servitude, les « noirs » étaient réduits en esclavage ; les femmes blanches européennes étaient emprisonnées dans le travail reproductif ; les femmes « noires » et « indigènes » étaient sexuellement objectivées, violées et exploitées dans l’esclavage domestique ; les femmes « noires » étaient mortifiées dans l’esclavage rural et dans les mines.
Seuls les hommes blancs européens pouvaient effectuer un travail libre. Cela signifie que, lors de la colonisation de l’Amérique latine, la blancheur masculine a été exclusivement associée au travail libre et rémunéré. Ils incarnaient la norme de ce que signifiait être humain, et cela reste le cas encore aujourd’hui.
Le travail libre et subordonné, qui est au cœur de la protection du droit du travail, est une construction juridique fondée sur un seul type de travailleur, le seul considéré comme humain et méritant l’illusion de liberté de choix créée par la subordination juridique.
Qui aime dit la vérité. Alors, écoutez-moi. Il y a une colonialité juridique dans le droit du travail. La relation de travail se présente à travers une neutralité fictive qui égalise les inégalités. Et aujourd’hui encore, c’est ce discours eurocentrique créé par et pour le travailleur masculin blanc qui définit les contours du sujet épistémique du droit du travail. Cela naturalise et légitime la division sexuelle-raciale du travail dans le monde et en Amérique latine, à travers le droit du travail lui-même.
La norme du travail a une couleur, elle a une origine et elle est sexuée. L’épistémologie du droit du travail est constituée à partir d’un fondement antinoir, anti-indigène et anti-féminin, qui a émergé dans la modernité. Nous pouvons affirmer qu’en raison de la reproduction de ce discours eurocentrique de subordination juridique, sans traduction décoloniale appropriée, le lien entre la théorie du travail et son application dans le Sud global est radicalement rompu.
C’est précisément la raison pour laquelle la simple absorption juridique dans la relation de travail est insuffisante pour garantir le détachement de la condition de subalternité. Il s’agit d’une question extrêmement complexe, impliquant la pluralisation des fondements épistémologiques du droit du travail et du sujet épistémique dans le droit du travail, à propos du travail ontologique silencieux, de la géopolitique et de la politique-corps de la connaissance.
Et cela ne peut être réduit au discours moderne binaire du travail formel et informel, dans la quête exclusive de l’emploi protégé.
Un exemple est fourni par la loi 150/15 au Brésil, qui reconnaît tous les droits de la relation de travail pour les travailleurs domestiques. Il s’agit d’une immense réussite, obtenue par les travailleurs domestiques eux-mêmes, qui n’avaient aucune représentation syndicale reconnue avant cette loi. Toutefois, la reconnaissance de la subordination juridique n’a pas permis de surmonter les inégalités coloniales.
Premièrement, l’informalité du travail domestique au Brésil n’a pas diminué après la loi 150/15. Aujourd’hui, seul un tiers des travailleurs domestiques ont un contrat formel. Plus de 90 % des travailleurs domestiques au Brésil sont des femmes et 63 % sont des femmes noires. Lorsque ces travailleurs accèdent à la relation de travail, cela ne les empêche pas d’être brutalement discriminés, d’être traités comme des personnes asservies, d’utiliser des toilettes, de la vaisselle et des couverts séparés dans la maison afin de ne pas se mélanger aux espaces de leurs employeurs blancs. Environ 2 employés domestiques sur 10 au Brésil travaillent plus longtemps que les limites établies par la loi 150/2015, qui autorise des horaires de travail allant jusqu’à 44 heures par semaine ou 8 heures par jour. La subalternité coloniale n’est pas surmontée par la protection offerte par la subordination juridique.
Néanmoins, la plupart des travailleurs du Sud global, en particulier ceux qui ne sont pas blancs, cherchent toujours à obtenir une subordination juridique, comme moyen privilégié d’assujettissement dans un système capitaliste. Car actuellement, ils sont de la chair subalterne, de la chair non humaine, sans droit de choisir, de sentir, de penser, de respirer ou d’aimer. En Afrique, 85,8 % des emplois sont informels. Cette proportion est de 68,2 % en Asie et dans le Pacifique, de 68,6 % dans les États arabes, de 40,0 % dans les Amériques et de 25,1 % en Europe et en Asie centrale. Environ 93 % de l’emploi informel dans le monde se trouve dans les pays émergents et en développement.
La tâche de rendre visible la colonialité dans le droit du travail n’est pas facile, car nous ne savons pas quelle est la limite de la critique radicale. Néanmoins, il ne suffit pas de dénoncer la complicité des catégories modernes du droit du travail avec la logique de la colonialité. Car la pensée décoloniale, comme l’amour, en raison de sa nature radicale, implique des actes pratiques. L’amour est une action, jamais un simple sentiment, qui implique de rendre des comptes et d’assumer des responsabilités. La décolonisation est un processus qui nécessite des actions.
Nous devons agir. Nous devons assumer la responsabilité épistémique de notre production de connaissances en droit du travail. Il est donc crucial de décoloniser son sujet épistémique, son concept moderne de temps et de valeur, basé sur des critères purement mercantiles. Nous devons déplacer la centralité du travail productif, en démystifiant l’idée que seuls ceux qui effectuent un travail productif devraient avoir droit à un revenu minimum. Nous devons appliquer la méthode décoloniale dans l’éducation juridique du travail, qui implique une praxis de connaissance désobéissante ; élargir le concept de milieu de travail, qui va au-delà de la relation d’emploi et du monde du travail, mais qui doit faire partie du champ d’application du droit du travail. Nous devons nous réapproprier de manière critique les techniques de collecte de données, de plateformes numériques et de biosurveillance au travail, et mettre en place des grèves féministes intersectionnelles.
C’est ma recherche. C’est mon travail. Qui fait partie de moi. De ma chair. Ma subjectivité. Mon affection. Est-ce de l’amour ? Travail et amour. Pour moi, c’est une combinaison intrigante. Ce sentiment est-il autorisé lorsque j’accomplis mon travail ? Parce que pour avoir le droit d’aimer, pour être considéré comme un travailleur, je dois d’abord être considéré comme un humain.
Ain’t I a human ?
Je suis considérée comme une femme blanche riche et originaire du Sud global. La première partie de cette phrase fait que je sois considérée comme un être humain, qui a le droit d’aimer. Et la société brésilienne me fait penser que je suis digne d’être aimée. Ces privilèges ont fait de moi une jeune Professeure. J’avais la liberté de choisir mon travail.
Je travaille dans une université dans une ville appelée Ouro Preto. Cela signifie « or noir ». Cela fait référence à la valeur de la chair noire dans la colonisation brésilienne, comparable à l’or. Chaque jour, je passe devant cette ville historique, construite grâce au travail des Noirs, pour entrer dans une salle de classe remplie de Blancs. Cet embourgeoisement racial se traduit par un racisme épistémique sur mon propre travail universitaire : alors que les personnes considérées comme blanches – comme moi – produisent la théorie du droit du travail, on attend de la périphérie noire – en particulier des femmes noires – qu’elle fournisse simplement des études de cas : elles sont notre « objet » de recherche, sans droit de choisir, de sentir, de penser, de respirer ou d’aimer.
L’héritage colonial de la déshumanisation des femmes noires au travail se poursuit en ces temps de pandémie dans mon université. Elles sont obligées d’exercer des activités professionnelles précaires. Elles ne sont pas des Professeurs, elles ne sont pas des chercheurs. Elles ne sont pas des juristes ; elles n’existent pas dans la doctrine du droit. Elles ne sont pas la plupart de mes étudiants, bien qu’elles représentent la majorité de la population brésilienne. Celles qui ont pu être mes étudiantes sont à nouveau exclues. Parce qu’elles n’ont pas accès à l’internet, elles ne peuvent pas étudier à la maison, elles n’ont pas d’espace ni de temps. Elles doivent travailler, sans avoir le droit de choisir, de sentir, de penser, de respirer ou d’aimer.
Parce que tout le reste est prioritaire au détriment d’elle-même, elle n’a pas le privilège d’être prise en charge, de s’aimer, et la société brésilienne lui fait penser qu’elle n’est pas digne d’être aimée, parce qu’elle est une femme noire pauvre du Sud global, pas un humain. C’est son labeur ontologique.
Ain’t she a human ?
Je suis considérée comme une femme blanche et riche du Sud global. La deuxième partie de cette phrase fait de moi un humain incomplet. Dans cette réalité pandémique, j’ai – et toutes mes collègues chercheuses – travaillé plus, mieux, sans droit à la déconnexion, mais je suis moins reconnue que mes collègues blancs masculins. Parce que je suis une femme du Sud global, pas un humain. C’est mon labeur ontologique.
Dans cette réalité pandémique, je suis – comme toutes mes collègues chercheuses – épuisée par le travail de reproduction. Je me sens loin de l’amour, je m’en veux d’être Professeure de droit du travail. Parce que je ne peux m’empêcher de penser à ses insuffisances épistémiques concernant les concepts de temps, de valeur, d’environnement, d’enseignement, d’apprentissage, d’être humain.
Qui aime dit la vérité. Alors, écoutez-moi. Quand je critique ici le Droit du travail, je la défends aussi, avec affection et amour, malgré toutes ses contradictions. Parce que ce que je veux pour le droit du travail – et pour nous – c’est la liberté, le droit de choisir, de sentir, de penser, de respirer en ces temps étouffants ; le droit d’aimer ce que nous faisons.
Notes
- Voir E. Andrade, O direito do trabalho na filosofia e na teoria social crítica, São Paulo : LTr, 2014.
- Pour étendre la subordination juridique, les tribunaux du travail brésiliens ont créé la théorie de la subordination structurelle, qui se manifeste par l’insertion du travailleur dans la dynamique des services de l’employeur, sans recevoir d’ordres directs. Voir M.M. Mendes et J.E. Chaves Júnior. ‘Subordinação estrutural-reticular : uma perspectiva sobre a segurança jurídica’. Rev. Trib. Reg. Trab. 3ª Reg., Belo Horizonte, v.46, n.76, p.197-218, jul./dez. 2007.
- Voir G. C. Spivak. ‘Can the subaltern speak ?’ In Cary Nelson et Lawrence Grossberg (eds) Marxism and the Interpretation of Culture London : Macmillan, 1988. Voir F. Máximo et P. Nicoli. ‘Droit du travail et épistémologies dissidentes : démarcations théoriques pour une autre critique’. Revista Direito e Práxis, Ahead of print, Rio de Janeiro, 2022.
- Voir P. H. Collins, Black Feminist Thought : Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. Routledge, New York, 2000.
- Voir les dernières réformes du travail et de la sécurité sociale au Brésil (loi n° 13.467/17 et amendement constitutionnel n° 103/19, respectivement).
- Voir S. Deakin, ‘The contribution of Labour law to economic development & growth’. Centre for Business Research, Université de Cambridge, document de travail n° 4782016, 2016 ; CESIT, Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho. ‘Contribuição crítica à reforma trabalhista’. Campinas : Unicamp, 2017.
- Voir P. R. Tcherneva, The Case for a Job Guarantee, Cambridge, Polity Press, 2020.
- Voir A.C. Ferreira, ‘A sociedade de austeridade : Poder, medo e direito do trabalho de exceção’. Revista Crítica de Ciências Sociais, 95, 2011, p. 119-136.
- Voir I. Ferreras, Firms as Political Entities: Saving Democracy Through Economic Bicameralism, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.
- Voir P. Ramamurthy, ‘Material Consumers, Fabricating Subjects : Perplexity, Global Connectivity Discourses, and Transnational Feminist Research’. Cultural Anthropology Vol. 18, N. 4 (Nov. 2003), p. 525.
- Ibid.
- Voir F. Máximo et P. Nicoli. ‘The epistemic secrets of Labour Law’. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 10, n. 2, p. 511-536.
- Voir R. Grofoguel, ‘Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais : Transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global’. Revista Crítica de Ciências Sociais, 80, Março 2008, p. 115-147.
- Voir G. Anzaldúa. Borderlands/La frontera : the new mestiza. San Francisco : Aunt Lute Books, 1987.
- Voir S. Madhok, ‘A critical reflexive politics of location, ‘feminist debt’ and thinking from the Global South’, European Journal of Women’s Studies, Vol. 27(4), 2020, p. 396.
- Voir F. Máximo et P. Nicoli, ‘The epistemic secrets of Labour Law’. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 10, n. 2, p. 511-536.
- Voir A. Blackett, ‘Decolonizing Labour Law: A Few Comments’, in R. Blanpain ; F.Hendrickx (eds), Labour Law and Social Progress: Holding the Line or Shifting the Boundaries?, Pays-Bas, Kluwer Law BV, 2016 ; D. Muradas et F. Pereira, ‘Decolonial thinking and Brazilian Labour Law : contemporary intersectional subjections’. Rev. Direito Práx., Rio de Janeiro, vol. 9, n. 4, 2018.
- Voir C. Walsh, ‘Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamiento ‘otro’ desde la diferencia colonial’, in S. Castro gómez ; R. Grosfoguel. (Ed.). El giro decolonial : reflexiones para una diversidad epistémia más allá del capitalismo global. Bogotá : Siglo del Hombre Editores et al, 2007.p. 47 – 62 ; B. S. Santos M. P. Meneses (ed.). Epistemologias do Sul. São Paulo ; Cortez. 2010.
- Voir A. Quijano. ‘Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina’. Colonialidad del saber. Buenos Aires : CLACSO, 2000.
- Voir F. Fanon, ‘Black Skin, White Masks’, New York : Grove Press, 2008 ; Robinson, C. J., On Racial Capitalism, Black Internationalism, and Cultures of Resistance. Londres, Pluto Press, 2019.
- Voir R.L. Segato. ‘Gênero e colonialidade : em busca de chaves de leitura e de um vocabulário estratégico descolonial’. E-cadernos CES, n.18, São Paulo, 2013, p. 106-131 ; M. Lugones. ‘Rumo a um feminismo descolonial’. Estudos Feministas, Florianópolis, 22(3) : 935–952, setembro–dezembro/2014.
- Voir A. Quijano. ‘Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina’. Colonialidad del saber. Buenos Aires : CLACSO, 2000.
- Voir A. Quijano, ‘Coloniality and modernity/rationality’ in W. Mignolo, A. Escobar (ed.). Globalization and the Decolonial Option. Routledge, New York, 2010, p. 22-32.
- Voir BIT, ‘Perspectives de l’emploi et des affaires sociales dans le monde’ Tendances 2022. Genève : Bureau international du travail, 2022, p. 31.
- Voir B. S. Santos, ‘Towards a Sociology of Absences and a Sociology of Emergence’, Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 63, 2002.
- Voir S. Ahmed, Declarations of whiteness : The non-performativity of anti-racism, Borderlands, v. 3, n. 2, 2004.
- Voir W. Mignolo, ‘Os esplendores e as misérias da ciência : colonialidade, geopolítica do conhecimento e pluri-versalidade epistêmica’ in B.S. Santos (Ed.). Conhecimento Prudente para uma Vida Decente : ‘um discurso sobre as ciências’ revisitado. São Paulo : Cortez, 2006, p. 672.
- Voir B. S. Santos. Um discurso sobre as Ciências na transição para uma ciências pós-moderna. Estudos Avançados, Coimbra, 1988.
- Voir A. Quijano. Coloniality and modernity/rationality, dans W. Mignolo, A. Escobar (ed.). Globalization and the Decolonial Option. Routledge, New York, 2010, p. 22-32.
- Voir M. Lugones. Rumo a um feminismo descolonial. Estudos Feministas, Florianópolis, 22(3) : 935–952, setembro–dezembro/2014.
- Voir W. Mignolo, ‘Os esplendores e as misérias da ciência : colonialidade, geopolítica do conhecimento e pluri-versalidade epistêmica’, in B.S. Santos (Ed.). Conhecimento Prudente para uma Vida Decente : ‘um discurso sobre as ciências’ revisitado. São Paulo : Cortez, 2006, p. 672.
- Voir A. Quijano. ‘Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina’. Colonialidad del saber. Buenos Aires : CLACSO, 2000.
citer l'article
Flavia Souza Maximo Pereira, Travail, amour et (dé)colonialité dans les relations de travail, Groupe d'études géopolitiques, Août 2022,
à lire dans cette issue
voir toute la revue





