Le droit est plus que jamais le langage nécessaire de la mondialisation

Laurent Cohen-Tanugi
Avocat international et écrivainIssue
Issue #2Auteurs
Laurent Cohen-Tanugi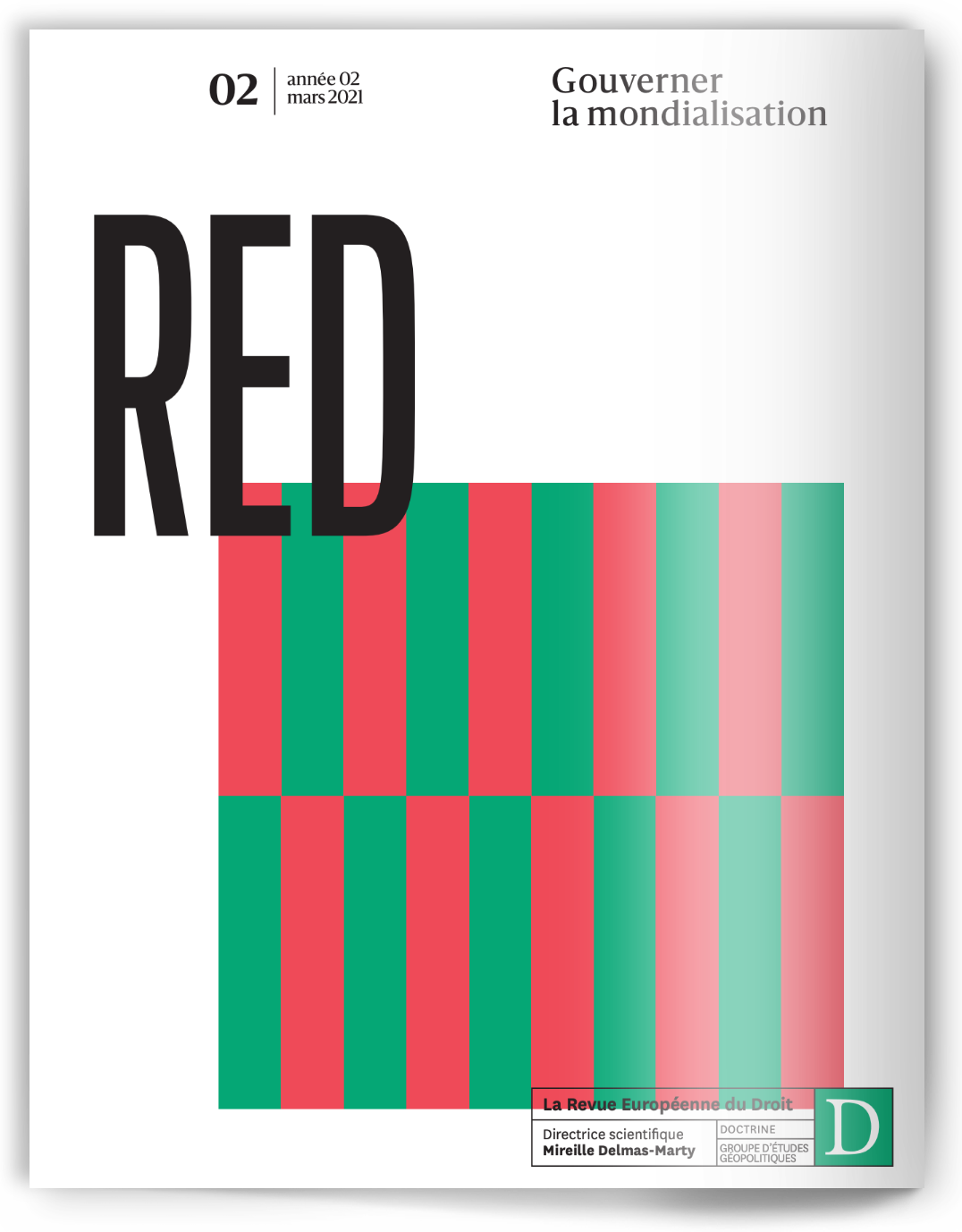
21x29,7cm - 186 pages Issue #2, printemps 2021 24€
Gouverner la mondialisation
Dans Le droit sans l’État, vous envisagiez la régulation juridique indépendamment d’un socle étatique. Cette analyse libérale permet-elle de comprendre la mondialisation comme la création d’un espace juridique sans véritable convergence politique ? Le modèle libéral est-il toujours un point de convergence dans la mondialisation ?
Laurent Cohen-Tanugi
Le droit sans l’État, paru en 1985, n’avait pas pour objet la mondialisation. Le titre visait à illustrer les différences de modes de régulation entre les États-Unis et la France, et j’y analysais l’importance du droit et des juristes aux États-Unis comme une sorte de pendant de l’État administratif et de la haute fonction publique en France. Pour la génération à laquelle j’appartiens, ce livre a contribué à une connaissance plus fine de la démocratie américaine, mais aussi et surtout à une puissante revalorisation du droit et à un renouveau du libéralisme politique en France.
De là, je suis passé à une réflexion sur la construction européenne, caractérisée par l’écart entre un système juridique très élaboré et intégré et une absence d’État, et même d’unité politique européenne, c’est-à-dire une autre figure d’un « droit sans État ». Ce n’est que par la suite, lorsque la mondialisation est devenue le phénomène central à partir des années 1990, qu’en l’absence d’État ou de gouvernement mondial, la régulation juridique s’est imposée naturellement comme l’instrument privilégié pour gouverner la mondialisation. On a alors commencé à parler de « gouvernance globale » – deux anglicismes – pour désigner une régulation juridique et institutionnelle de la mondialisation.
Ce qui a changé au tournant du XXIe siècle, et que j’évoquais dans mon livre Guerre ou paix, est la prise de conscience de ce que cette mondialisation, jusque-là considérée comme une force d’harmonisation et de pacification planétaire – souvenez-vous de The World Is Flat, l’ouvrage de Tom Friedman –, était également porteuse de fragmentation et de conflictualité, du fait de la montée en puissance de la Chine et autres grands pays émergents qu’elle favorisait, ainsi que des réactions identitaires et réactionnaires qu’elle provoquait un peu partout dans le monde.
laurent cohen-tanugi
Ce qui a changé au tournant du XXIe siècle, et que j’évoquais dans mon livre Guerre ou paix publié en 2007, est la prise de conscience de ce que cette mondialisation, jusque-là considérée comme une force d’harmonisation et de pacification planétaire – souvenez-vous de The World Is Flat, l’ouvrage de Tom Friedman, l’éditorialiste vedette du New York Times –, était également porteuse de fragmentation et de conflictualité, du fait de la montée en puissance de la Chine et autres grands pays émergents qu’elle favorisait, ainsi que des réactions identitaires et réactionnaires qu’elle provoquait un peu partout dans le monde. Le retour de la géopolitique inauguré symboliquement par les attentats du 11 septembre 2001 marque un changement de paradigme par rapport au moment libéral des années 1980-90, mais le discours sur la régulation juridique de la mondialisation a tardé à en prendre acte.
Vos ouvrages des années 1990 sont tributaires de notions dont l’objectivité est aujourd’hui en question. Pensez-vous que les concepts utilisés pour décrire le monde à cette époque demeurent pertinents ? Notamment peut-on encore faire usage des termes tels que « démocratie », « droits humains », ou « libertés » alors qu’ont émergé des modèles alternatifs niant le sens qui leur est donné en Occident ? Le langage juridique promeut-il des valeurs suffisamment universelles pour servir de lingua franca à la mondialisation ?
Il importe de bien distinguer deux choses. La première est l’assaut mené depuis plusieurs années contre le modèle libéral de l’État de droit, tant au sein des démocraties occidentales que dans le monde émergent. Au sein des démocraties occidentales, les mouvements populistes ont en ligne de mire l’État de droit, c’est-à-dire la limitation de la volonté populaire ou de la règle majoritaire par des principes fondamentaux. L’État de droit est ce qui différencie les démocraties libérales de la démocratie « illibérale » – une contradiction dans les termes – prônée par Victor Orban en Hongrie ou par les dirigeants polonais actuels. Mais cet assaut contre la démocratie libérale a pris une dimension nouvelle avec la montée en puissance des pays émergents, qui lui opposent avec une agressivité croissante leur propre modèle de gouvernance. Je pense naturellement à la Chine, à la Russie ou à la Turquie. Et là, la réponse à votre question est nette : nous devons défendre notre modèle démocratique et nos valeurs, qui sont universelles parce qu’ancrées dans l’humanisme. Nous devons les défendre d’abord chez nous, où ils sont attaqués de l’intérieur comme de l’extérieur, mais également autant que faire se peut en dehors du monde occidental, lorsque les droits humains fondamentaux sont violés ou pire encore. Le respect des souverainetés nationales et le relativisme culturel ont des limites.
Mais dans ce contexte de conflit de modèles de gouvernance et de valeurs – c’est le second volet de votre question –, le droit est plus que jamais le langage nécessaire de la mondialisation pour prévenir et résoudre les différends. Trouver un accord sur des normes communes devient dans ce contexte plus difficile, mais les acteurs étatiques agissant généralement de manière rationnelle, chacun a intérêt à parvenir à un tel accord, faute de quoi c’est la guerre.
Les valeurs libérales promues par le droit mondialisé entrent-elles en conflit avec les valeurs traditionnelles, en Occident comme à l’étranger ?
Je me méfie d’expressions trop générales comme « valeurs libérales » ou « valeurs traditionnelles ». Ce qui est certain, c’est que la mondialisation, dans toutes ses dimensions, économique mais aussi technologique, migratoire, culturelle, a engendré au sein des populations occidentales et extra-occidentales un certain nombre de réactions identitaires, nationalistes, ou de repli sur la religion et ce que vous appelez les « valeurs traditionnelles ».
Mais il faut bien voir que ce repli sur soi, et surtout l’essor des fondamentalismes religieux tant dans le monde arabo-musulman qu’en Occident, représentent une formidable régression par rapport à l’ouverture des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Il faut également être conscient de ce que ces réactions traditionnalistes ont été le plus souvent instrumentalisées, sinon orchestrées, par des autocrates et autres démagogues, qu’il s’agisse de la Russie de Poutine avec l’instrumentalisation de la religion orthodoxe, de la Turquie d’Erdogan avec l’islamisme « modéré », de l’Inde de Modi avec l’hindouisme anti-musulman, ou encore de la Pologne actuelle et de l’Amérique de Trump. Les « valeurs traditionnelles », tout comme l’appel à la nostalgie d’une grandeur révolue, sont ainsi l’un des instruments de l’assaut populiste et réactionnaire contre la démocratie libérale et l’État de droit, la science et le progrès, la philosophie des Lumières. Cela a produit le Brexit, la présidence Trump, ou encore le bilan catastrophique de la pandémie dans les pays gouvernés par des populistes : Royaume Uni, États-Unis, Brésil.
L’usage du droit comme outil de la mondialisation suppose-t-il une séparation du politique et de l’économique dans les rapports internationaux ?
La séparation du politique et de l’économique dans les relations internationales a coïncidé avec les premières décennies de la vague contemporaine de la mondialisation, marquées par la domination économique, politique et culturelle occidentale. Au cours de la décennie 1990, marquée par l’illusion de la « fin de l’histoire », du triomphe planétaire de la démocratie et de l’économie de marché et par l’harmonisation technologique, l’économie était en quelque sorte dépolitisée. Depuis le changement de paradigme que j’évoquais précédemment, c’est-à-dire le retour de la géopolitique au premier plan des relations internationales, la séparation de l’économique et du politique existe de moins en moins et l’on assiste à un phénomène inverse, à savoir la géopolitisation à outrance des relations économiques, illustrée notamment par l’agressivité de Donald Trump et en miroir la politique de Xi Jinping.
Depuis le changement de paradigme, c’est-à-dire le retour de la géopolitique au premier plan des relations internationales, la séparation de l’économique et du politique existe de moins en moins et l’on assiste à un phénomène inverse, à savoir la géopolitisation à outrance des relations économiques, illustrée notamment par l’agressivité de Donald Trump et en miroir la politique de Xi Jinping.
laurent cohen-Tanugi
Paradoxalement, comme je l’évoquais il y a un instant, cette géopolitisation de la vie économique internationale rend la régulation par le droit encore plus nécessaire.
Encore faut-il s’entendre sur le sens de cette régulation par le droit, car le droit lui-même peut être instrumentalisé à des fins géopolitiques. Je n’inclus pas dans cette catégorie le procès souvent intenté à l’application extraterritoriale du droit américain, dans des domaines bénéficiant d’un consensus international tels que la lutte contre la corruption, le blanchiment ou la fraude fiscale. Dans une économie mondialisée il est naturel que les législations nationales ou régionales aient un caractère extraterritorial, et c’est d’ailleurs le cas de plusieurs corpus juridiques européens. Ce qui est en revanche préoccupant est l’application arbitraire de textes de lois à des fins géopolitiques ou comme mesures de rétorsion, et c’est ce type d’instrumentalisation du droit qu’une régulation juridique d’une mondialisation devenue plus conflictuelle se doit de prévenir par des institutions et des règles de fond et de procédure consensuelles. Ce que l’on appelle le « lawfare » constitue une menace émergente pour la mondialisation.
L’Europe peut-elle être une puissance normative globale ?
Je le crois, à condition d’entendre « norme » au sens de règle plutôt que de standard industriel. Depuis sa naissance à Maastricht au début des années 1990, l’Union européenne s’est pensée et voulue comme une puissance normative globale, et elle l’est effectivement devenue dans un certain nombre de domaines-clé, notamment la réglementation des données personnelles. Cette ambition se trouve néanmoins entravée par le défaut d’unification politique de l’Europe, dans la mesure où une influence normative globale suppose un droit unifié par des règlements communautaires et des institutions intégrées. C’est ainsi dans les domaines les plus fédéralisés que l’Europe est la plus influente : commerce international, droit de la concurrence et politique monétaire. Une autre limitation à l’influence normative européenne est l’absence de bras armé pour faire respecter les normes, à l’image de ce qu’est la Commission en droit de la concurrence et à la différence du Département de la justice américain. Le parquet européen est un premier pas, encore insuffisant, dans cette direction.
Mais dans la mondialisation conflictuelle du XXIe siècle, l’Europe ne peut pas se contenter d’être une puissance normative, fût-elle globale. Dès 2008, à la veille de la crise financière mondiale, je plaidais en faveur d’une stratégie européenne ambitieuse pour la mondialisation dans le rapport de la mission sur l’avenir de la « stratégie de Lisbonne » – un fiasco – que m’avaient confiée Christine Lagarde et Xavier Bertrand. Certaines de nos propositions, comme la nécessité d’un contrôle communautaire des investissements stratégiques et d’une politique commerciale plus robuste, sont aujourd’hui reprises par la Commission von der Leyen, et trouvent notamment écho auprès de Thierry Breton. L’Europe doit également devenir une puissance politique et stratégique et renforcer ses capacités technologiques et militaires dans les années à venir.
Revenons à l’Amérique, à votre éloge de la démocratie américaine des années 80, et à votre dernier ouvrage, Résistances. Quel bilan faites-vous de la résistance de la démocratie américaine à la présidence Trump ?
J’ai eu l’occasion de dénoncer le recul de l’État de droit aux États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001, dans une postface à la réédition du Droit sans l’État vingt ans après. Mais l’attaque permanente contre la démocratie libérale et l’État de droit qu’a représenté la présidence Trump était d’une toute autre nature. C’est pourquoi sa défaite était un enjeu crucial pour les États-Unis, pour le monde et pour la démocratie libérale.
« La démocratie a triomphé », comme l’a salué Joe Biden, au double sens où le vote populaire et le système électoral ont été respectés et où le candidat anti-démocratique a été battu. Mais il s’en est fallu de peu, et la présidence Trump a révélé de graves et surprenantes faiblesses de l’État de droit et de l’équilibre des pouvoirs aux États-Unis, dans un contexte, il est vrai, où le Congrès était dominé par un parti qui n’a plus de républicain que le nom et dont la faillite morale est largement responsable de la dérive bananière, voire fascisante, que vient de connaître la démocratie américaine. J’ai été particulièrement surpris par la quantité de manquements au droit, à l’éthique et aux normes démocratiques qu’un président des États-Unis pouvait commettre impunément pendant son mandat, et par l’impuissance de la règle de droit face au politique dès lors que le parti majoritaire au Congrès tourne le dos à l’esprit des lois et aux valeurs de la démocratie américaine pour ne servir que son propre intérêt de court terme.
À défaut de pouvoir réformer la procédure d’impeachment ou le système électoral, la nouvelle majorité démocrate au Congrès va devoir s’atteler à mieux encadrer et sanctionner les pouvoirs du président, à renforcer l’indépendance du Département de la justice, et à rendre impossible à l’avenir les innombrables violations de l’éthique et des normes démocratiques commises par Donald Trump.
Malgré la démission coupable du Congrès républicain et l’affaiblissement consécutif des « checks and balances », la démocratie américaine a montré sa singulière capacité de résistance. Je ne suis pas sûr que les démocraties européennes auraient fait mieux face à un danger qui les menace également.
laurent cohen-tanugi
Cela dit, malgré la démission coupable du Congrès républicain et l’affaiblissement consécutif des « checks and balances », la démocratie américaine a montré sa singulière capacité de résistance, grâce aux grands médias traditionnels, aux tribunaux fédéraux, aux États et autres collectivités locales, à la société civile et à « l’État profond » dénoncé par Trump, y compris la haute hiérarchie militaire. Je ne suis pas sûr que les démocraties européennes auraient fait mieux face à un danger qui les menace également. Nous devons tirer toutes les leçons de l’expérience américaine, y compris de la journée du 6 janvier 2021 et de ses suites.
citer l'article
Laurent Cohen-Tanugi, Le droit est plus que jamais le langage nécessaire de la mondialisation, Groupe d'études géopolitiques, Juil 2021, 145-147.
à lire dans cette issue
voir toute la revue





