L’évolution de la position chinoise dans les COP et sur la scène géopolitique climatique mondiale

Amy Dahan
Directrice de recherche au CNRS au Centre Alexandre KoyréIssue
Issue #1Auteurs
Amy Dahan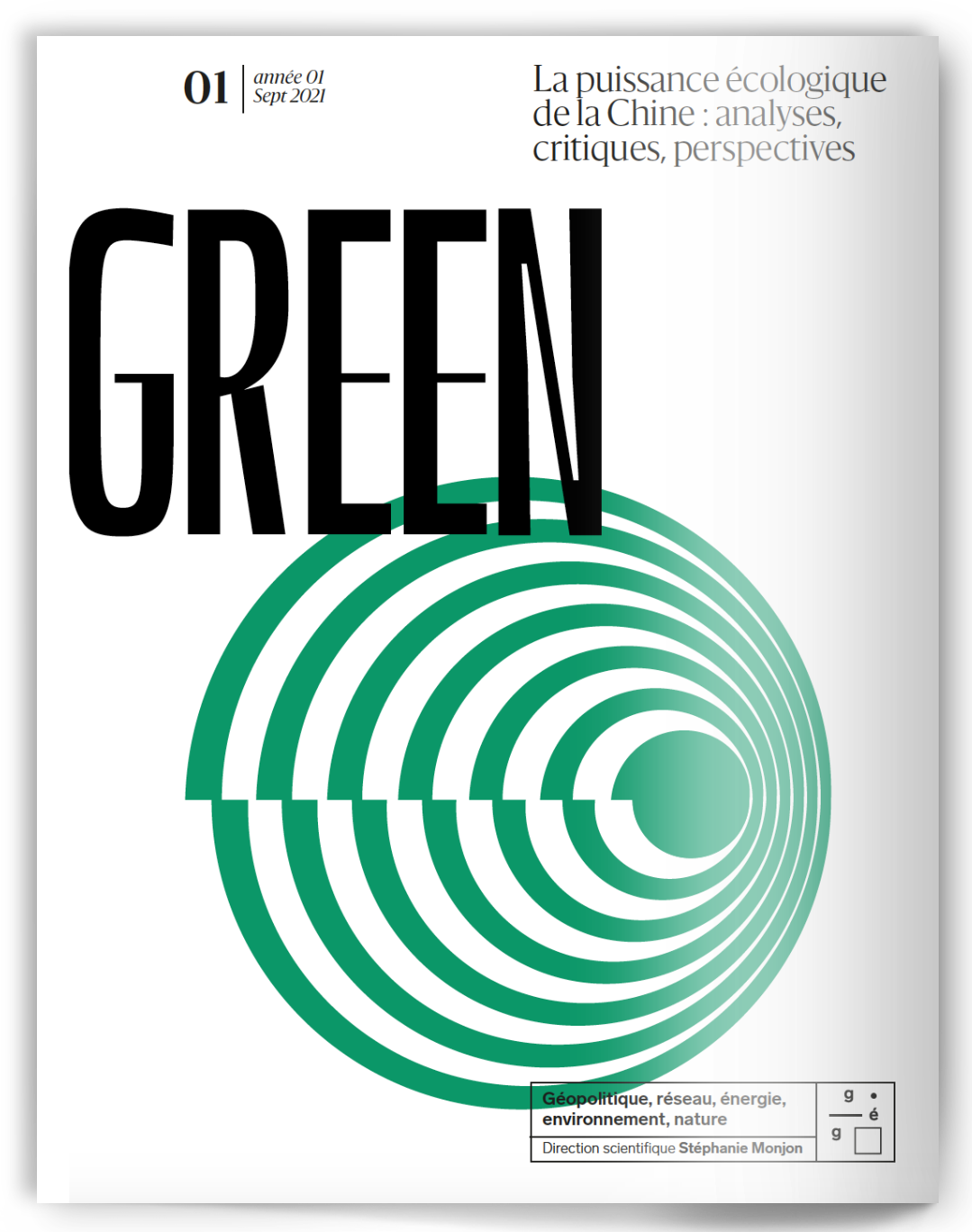
21x29,7cm - 167 pages Numéro #1, Septembre 2021
La puissance écologique de la Chine : analyses, critiques, perspectives
Léa Boudinet & Clémence Pèlegrin — Comment a évolué la position de la Chine au cours de ces trente dernières années en matière de géopolitique du climat ? 1
D’abord, l’expression de « géopolitique du climat » ne s’impose que très progressivement dans l’analyse de la question climatique. Elle n’existe pas dans les années 1990, que ce soit au Sommet de la Terre de Rio en 1992 ou lors de la ratification de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 1994. À ce moment-là, les négociations étaient Nord-Nord : les pays en développement y étaient invités et participaient au processus multilatéral pour se « familiariser au problème climatique », mais ils n’étaient pas censés s’engager formellement au même titre que les pays développés qui avaient la responsabilité historique du problème.
La négociation pour le protocole de Kyoto a porté sur la répartition de la réduction des émissions de gaz à effet de serre entre un petit nombre de pays : les États-Unis, l’Europe, la Russie, le Japon, l’Australie et le Canada. À ce moment-là, la Chine regardait la situation avec une certaine distance et commençait à s’intéresser au positionnement des pays en développement. Il faut se rappeler que dès 1996-1997, les États-Unis avaient affirmé que le mode de vie américain n’était pas négociable, et qu’ils n’envisageaient pas de contraindre leur croissance économique si les grands pays en développement, dont la Chine, ne le faisaient pas non plus (résolution dite de Byrd Hagel du Sénat américain). Ils ont très tôt anticipé le péril, c’est-à-dire la rivalité potentielle, que représentait pour eux la Chine, du point de vue démographique notamment. Depuis le début, et on a beaucoup d’indices pour le dire aujourd’hui, les États-Unis ne voulaient pas prendre d’engagement si les autres pays n’en avaient pas. Les démocrates, avec le président Bill Clinton, ont signé le protocole de Kyoto en 1997 ; mais dès l’élection du président Bush, ils se sont retirés du protocole de Kyoto. Pendant toute cette période, la Chine demeurait très en retrait du processus multilatéral. Les années 1990 correspondent au début de l’ouverture et de l’industrialisation effrénée de la Chine, et à l’échelle globale, à l’explosion des échanges et celle de la mondialisation financière et libérale. Elles sont cruciales, si l’on peut dire, dans l’accélération du changement climatique. De 1995 à 2010, la configuration de la question climatique a complètement changé pour devenir pleinement géopolitique. En 1992, je pense que la dimension planétaire de cet enjeu n’était pas clairement identifiée. On considérait volontiers qu’il concernait principalement la civilisation occidentale et les pays développés.
Après le retrait des États-Unis du Protocole de Kyoto, en 2002, les pays en développement et émergents vont occuper l’espace laissé vacant par les Américains. Il faut dire que dans la première décennie de négociations (1995-2005), les pays les plus pauvres sont encore relativement climato-sceptiques, ils ne croient pas à l’urgence de ce problème ; eux-mêmes jouent un rôle très marginal dans les débats, et suspectent que cet enjeu est monté en épingle pour limiter leur développement. De nombreux délégués des pays pauvres du Sud avec lesquels je me suis entretenue dans les années 2002 à 2004 me disaient : le langage de la modélisation numérique est un « langage du Nord » qui a eu ses mérites mais ne peut plus suffire. Cette expression surprend et pouvait inquiéter. En fait, dans le régime climatique, la méthode des modèles consiste principalement en la résolution numérique d’un problème mathématique d’évolution (sous la forme d’équations aux dérivées partielles) dont on fixe l’état initial. Or transférée et utilisée dans le cadre politique, la méthode efface le passé et naturalise le présent, qui devient un acquis donné, n’ayant plus à être interrogé en dépit des hétérogénéités et des inégalités qu’il embrasse. Dans la négociation de Kyoto, l’année 1990 est cet état initial. Enfin, la méthode globalise le futur : une molécule de CO2 émise n’importe où sur la planète, dans les rizières d’Asie ou sur les autoroutes américaines, est comptabilisée de la même façon. Inutile de préciser que la Chine quant à elle ne tenait pas ce type de discours, et voulait apparaître pleinement engagée dans le travail scientifique du GIEC 2 .
De 2002 à 2009, une alliance très progressive mais étroite s’est nouée entre le travail des ONG environnementales, qui ont tout de suite adhéré aux analyses scientifiques du GIEC, et les pays en développement pauvres, envers lesquels un travail de pédagogie et d’explication du problème a été mené. Il n’y avait cependant pas un enjeu de négociation très réel en l’absence des États-Unis, il était hautement improbable de définir un accord climatique ambitieux sans eux. L’Europe a un peu fait avancer les choses, comme quand elle a adopté le seuil des 2 degrés en 2002, à l’issue d’un vaste travail de co-construction entre les scientifiques et les politiques.
Au cours de la première décennie du XXIème siècle, les pays en développement ont progressivement changé de posture. Ils ont commencé à admettre que le changement climatique existait bel et bien, puis qu’ils en seraient les premières victimes. D’ailleurs les bouleversements climatiques commençaient à être de plus en plus perceptibles, et les événements extrêmes comme l’ouragan Katrina, en 2004, ou le tsunami de l’Océan Indien en 2004 ont contribué à infléchir leur perception. Un certain nombre de délégués des pays en développement, en particulier Saleemul Huq du Bangladesh, devenu leader des pays les moins développés, ont joué un rôle très important dans les négociations, d’abord en mettant en avant le thème de l’adaptation au changement climatique, puis celui dit des pertes et dommages (« Loss and damage ») en 2013, jusqu’à tenter de pousser l’objectif plus ambitieux du seuil (à ne pas dépasser) de 1,5° dans l’Accord de Paris.
Jusqu’en 2009, la Chine était donc présente mais discrète : elle n’était pas moteur des négociations. Pendant cette période, elle restait préoccupée avant tout par son propre développement et sa croissance historique à deux chiffres. Rappelons qu’elle devait dès 2007 dépasser les États-Unis en volume global d’émissions, alors que dans les années 90, on avait prévu ce dépassement vers 2030 ! Dans la grammaire du marché carbone 3 mise en place dans le Protocole de Kyoto – gigantesque usine à gaz faite de permis d’émissions, de critères d’additionnalité, de mécanismes de compensation économique ou de mécanismes de développement propre (MDP) entre le Nord et le Sud – la Chine a commencé par manifester une grande réticence vis-à-vis d’arguties permettant aux pays industrialisés de ne rien faire chez eux. Néanmoins sa position a changé radicalement quand elle a réalisé les bénéfices économiques que le MDP pouvait lui apporter : des rentrées d’argent non négligeables, une aide à l’investissement dans des projets qui réduisent les émissions de CO2 et celles d’autres pollutions, et surtout des possibilités de transferts technologiques stratégiques. En 2008, la Chine était le premier pays bénéficiaire de ce mécanisme MDP.
La Chine jouait en revanche un rôle majeur dans ce qui s’appelait le « G77+Chine », regroupement, dans les instances multilatérales, d’abord de 77 pays, puis énorme conglomérat hétérogène de 132 pays : pays en développement de toutes tailles 4 , pays émergents, jusqu’aux pays pétroliers. La Chine a réussi néanmoins à ne pas perdre son influence et même son leadership sur le G77 et à éviter les fortes hostilités des pays pauvres, jouant certaines alliances avec les pays pétroliers du Moyen-Orient. L’Inde, elle, était très dure dans les négociations, insistant sur les enjeux d’équité et la responsabilité historique des pays développés, prônant le budget carbone par tête, là où la Chine n’a jamais défendu de telles positions. Bien sûr, celle-ci avait encore un niveau d’émissions par personne beaucoup plus faible que celui des pays développés, mais elle anticipait sans doute que cela ne durerait pas.
Comment analysez-vous le tournant que représente la COP de Copenhague, à la fois pour les négociations climatiques mondiales et la position de la Chine ?
C’est seulement à Copenhague que la Chine est apparue comme une puissance déterminante, à la fois dans la mondialisation et dans la gouvernance climatique, en première ligne des négociations et qu’on a perçu clairement que les grands clivages géopolitiques s’étaient déplacés. La négociation va devenir Nord-Sud, dominée par la rivalité USA-Chine.
Dans les semaines qui ont précédé la COP 15, il y avait une véritable effervescence, un espoir de changer le monde, d’autant que les mouvements de la jeunesse et de la société civile commençaient à naître. C’était aussi la première année de présidence effective d’Obama. La douche froide a été à la hauteur des espoirs : rien ne s’est passé pendant les négociations, la présidente Danoise a reçu un camouflet et tout s’est discuté dans les hôtels entre Obama et le président chinois Hu Jintao. Mais, à Copenhague, les Chinois ont joué collectif avec les autres pays émergents, formant avec le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud, un groupe distinct (le BASIC) toujours associé aux contacts avec le président Obama. Tandis que du côté américain, démocrates comme républicains, le discours officiel s’est inscrit dans la continuité politique du refus de l’engagement américain sans obligation réciproque des autres parties prenantes. On sait aujourd’hui que la Chine n’est pas opposée au processus multilatéral, d’une certaine façon elle l’accepte : elle n’a jamais voulu se retirer des accords. Sans faire d’éclat, elle a au contraire joué la carte d’une très grande puissance responsable qui ne quitte pas la table des négociations. Comme les États-Unis, elle ne voulait pas d’un grand traité contraignant, pourtant elle s’est ralliée finalement à l’idée d’un accord volontaire et inclusif.
L’année suivante, à Cancun (décembre 2010), beaucoup ont craint que le processus multilatéral lui-même soit remis en question. L’Europe avait reçu un camouflet terrible et était hors-jeu. Le processus multilatéral a été sauvé par les pays les moins avancés qui sont, eux, viscéralement attachés à ce processus car c’est la seule arène qui leur donne a priori une place égale aux autres États. Un jeu politique extrêmement subtil et habile a été mené par la présidence mexicaine, tandis que l’Europe était aux abois et les États-Unis pas en position de faire avancer réellement les négociations. La Chine était toujours en retrait, comme si elle tentait de se faire oublier.
En 2011, à Durban, il y a eu la volonté de reprendre les négociations sur une base plus « bottom-up », basé sur des contributions volontaires pays par pays. Cela a donné lieu à un bras de fer mémorable entre l’Inde, très intransigeante dans sa position, l’Europe pleine de bonne volonté politique, avec la Chine toujours en retrait. Un différend a éclaté lorsque la délégation du Bangladesh a accusé l’Inde de négliger la menace climatique, et le risque d’élévation du niveau de la mer menaçant le Bangladesh, et in fine de laisser perdurer une situation dramatique. Face à cet ultimatum, l’Inde a capitulé.
En parallèle des COP où sa position est plus en retrait, la Chine joue un rôle très important au sein du GIEC : elle dispose de scientifiques de haut niveau qui ont depuis les années 2010 des responsabilités importantes dans la préparation et la coordination des rapports du GIEC. Elle possède son propre modèle global de climat — au total, il en existe 23 dans le monde, la France en possède 2 – et participe au sein de la communauté scientifique aux exercices d’inter-comparaison des modèles. Dans les séances de ratification des rapports du GIEC, éminemment politiques, les délégations de chaque pays discutent phrase à phrase du contenu des résumés pour les décideurs. Il est intéressant de noter que la Chine, présente à ces réunions, conserve un point de vue relativement scientifique : elle ne s’oppose pas aux formulations, comme le font plus systématiquement les pays pétroliers, qui agissent comme des forces d’obstruction incroyables. Dans l’ensemble, son attitude n’est pas obstructive.
Pouvez-vous revenir sur le moment si particulier de l’Accord de Paris et de sa préparation ?
Dans la période 2011-2015 de préparation de l’Accord de Paris, le deuxième sommet de la terre de Rio a eu lieu en juin 2012. Alors que climat était devenu l’enjeu majeur au niveau environnemental et géopolitique, et que la Chine aux côtés du pays hôte (le Brésil) jouait un rôle très important dans la préparation et la conduite de ce sommet de la Terre, j’ai été frappée que cette question soit tout bonnement absente des négociations ou comme un élément central du sommet de la Terre. C’était un moment absolument étonnant, 20 ans après l’apogée de la notion de développement durable et du processus multilatéral lancé en 1992, ce sommet de 2012 avait pour but de faire le point sur le développement durable des pays en voie de développement. L’immense majorité de ces pays dressaient comme priorités la pauvreté, l’accès à l’eau potable, la santé… mais le problème climatique était quasiment absent de cette liste et le bloc des émergents dirigé par la Chine avait contribué à cette occultation 5 .
En 2012, à Rio, l’Europe était toujours loin d’être en position de force : son idée de nouvelle organisation mondiale de l’environnement a été un échec. La crise financière de 2008, et le bilan morose de Copenhague l’avaient affaiblie, et elle apparaissait en retrait face aux États-Unis d’une part, au bloc des émergents d’autre part.
Entre 2012 et 2015, un travail énorme a été accompli par les négociateurs pour atteindre le résultat qu’a été l’Accord de Paris. De plus, à partir de 2013, l’économie chinoise franchit une nouvelle étape de son développement : la question de la pollution y est devenue particulièrement prégnante, elle inquiète profondément la population chinoise urbaine et l’État est obligé de s’y intéresser. En automne 2014, lors du voyage de Barack Obama en Chine, une déclaration commune lance le signal de la volonté mutuelle des deux puissances d’aller plus loin et de donner une issue à ce processus en stagnation.
À ce moment-là, de nombreuses organisations financières philanthropiques, des think-tank et des ONG ont voulu que l’Accord de Paris advienne, et ont organisé les changements d’opinions au sein des délégations des États, en particulier des pays en développement et émergents mais aussi parmi le personnel politique américain. Ce mouvement performatif a été très important et la présence de ces acteurs s’est renforcée lors des trois réunions préparatoires à l’Accord de Paris qui se sont tenues à Bonn 6 .
La Chine a-t-elle adopté un positionnement particulier dans la préparation de l’Accord de Paris vis-à-vis des autres pays en développement ?
Les pays les plus pauvres se sont organisés entre eux pour faire avancer leur propre agenda pour Paris, en faveur d’un scénario plus ambitieux que le seuil des 2 degrés, poussant les enjeux de l’adaptation et les aides financières aux pays les plus vulnérables. Ces pays étaient parfois perçus par les pays développés comme potentiellement du côté des forces obstructives ou de la Russie, des pays qu’il fallait encore convaincre de se rallier à l’effort collectif. De fait et avec surprise, quelques jours avant la signature de l’accord, ces pays ont collectivement avancé la volonté d’entériner l’objectif de 1,5 degré de réchauffement, sous peine de non-signature de l’accord. Or, en marge des négociations, de nombreux scientifiques affirmaient qu’ils ne croyaient pas à la faisabilité de cet objectif, et que 2 degrés était déjà un cap très ambitieux. J’ai moi-même écrit, à la suite de son adoption, que cela renforçait le schisme de réalité entre la gouvernance et le changement climatique en cours en annonçant des objectifs allant à l’encontre de la réalité climatique du monde 7 . Je ne sais pas si je me suis trompée, mais les émissions ont continué de croître. La Chine est restée en retrait de cette polémique.
L’idée générale finalement retenue lors des négociations a été d’inscrire dans le texte la phrase concernant le seuil (à ne pas dépasser) des 2 degrés et si possible des 1,5 degrés, et de demander au GIEC d’écrire un rapport sur la faisabilité des 1,5 degrés. Cette idée n’a pas fait consensus d’emblée, tant parmi les scientifiques que dans diverses délégations, mais le momentum des négociations et l’envie de signer un accord historique ont finalement abouti à l’adoption de cette formulation. Très rapidement, en 2016, le GIEC a produit un rapport changeant un peu la focale de la demande, en montrant qu’un monde à +1,5 degrés de réchauffement était déjà terriblement dangereux, que celui à +2 degrés le serait encore bien davantage, bref que chaque demi-degré compte. De plus, alors que le GIEC avait toujours conservé sa posture historique « policy-relevant » plutôt que « policy-prescriptive », en restant loin des solutions politiques, il a adopté pour le Rapport 1,5 degrés une méthodologie novatrice, faisant travailler de manière conjointe et interactive les scientifiques des trois groupes, dans une recherche de solutions et de politiques climatiques plus concrètes.
Lors de la COP 21, il était impensable d’avoir un accord sans la Chine, car elle était déjà le premier émetteur mondial. Elle ne s’est pas engagée à réduire ses émissions d’ici 2030 : elle a affirmé au contraire qu’elle augmenterait ses émissions pour continuer sa croissance et sortir son pays de la pauvreté. En revanche, elle s’est engagée à réduire l’intensité carbone de son économie. Mais tout pays réduit l’intensité carbone de son économie en se développant, du fait principalement de l’innovation et des progrès technologiques et de la tertiarisation croissante des activités. Ce n’était pas un engagement très risqué de la part de la Chine.
De façon générale, avant ou après Paris, la Chine a toujours œuvré, comme les États-Unis et les autres grands acteurs de la gouvernance multilatérale pour que la question de l’extraction des énergies fossiles et des subventions qui leur sont accordées reste un impensé des négociations.
Comment analysez-vous la notion de civilisation écologique vis-à-vis de la Chine ? En quoi cette notion influence-t-elle le modèle de développement de la Chine ?
J’ai constaté depuis 2008 que la Chine était toujours très réticente face à la rhétorique du « développement durable », qui est fondamentalement associé à un projet social-démocrate issu des utopies occidentales des années 1980. Les dirigeants ou les responsables chinois ont préféré évoquer (ceci dès 2008) une « société bas-carbone », dans laquelle la dimension technologique est centrale : technologies alternatives aux énergies fossiles et à leurs techniques associées, innovations technologiques de nouveaux processus industriels (fondés sur l’ammoniac, l’azote, l’hydrogène etc.) permettant d’éviter les émissions de CO2. Le développement économique et matériel de la Chine n’est pas vraiment celui d’une civilisation qui se voudrait écologique, proche de la Nature, respectueuse des ressources, des équilibres et des rythmes naturels, c’est au contraire une croissance urbaine tous azimuts, et une société très inégalitaire qui ont été privilégiées. La Chine possède une classe moyenne (de 3 à 400 millions d’habitants) dont le niveau d’émissions par tête est comparable à celui des États-Unis. La Chine s’est développée en bétonnant de vastes terres arables, en promouvant un modèle de consommation effréné… La population chinoise demeure fascinée et attirée par le mode de vie occidental, d’un point de vue alimentaire notamment. Dans ce cas, le pouvoir essaie de réagir face à la croissance rapide de l’obésité, et heureusement les traditions culturelles chinoises demeurent très prégnantes. Les dés ne sont donc pas encore jetés de ce côté.
Il faut souligner que la Chine promeut activement la reforestation comme politique de compensation au service de l’objectif de neutralité carbone. Pourtant, il faut considérer très prudemment les résultats de cette politique, tant d’un point de vue climatique qu’environnemental. Il y a eu aussi de récentes annonces très inquiétantes de géo-ingénierie : changer les pluies, détourner les nuages, infléchir les cours d’eau qui descendent de l’Himalaya… La Chine est trop puissante, souvent brutale, trop peu transparente et respectueuse des droits individuels pour ne pas craindre des pratiques d’apprentis sorciers.
Aujourd’hui, la Chine investit diverses arènes multilatérales, comme la Food and Agriculture Organisation (FAO) qu’elle dirige. Cela illustre son grand intérêt pour ces thématiques, pour les enjeux de ressources agricoles dont elle a un immense besoin, alors même qu’elle continue de développer un mode de culture intensif. Dans le Livre Blanc (écrit par la Chine dans ce cadre) sur la coopération internationale, il s’agit de se démarquer des modèles antérieurs de coopération Nord-Sud et de montrer que la Chine, en tant que plus grand pays en développement, a une légitimité naturelle à dialoguer avec les autres PED. Le discours reste très productiviste : beaucoup d’engrais, de produits phytosanitaires, des pesticides, des insecticides… L’ouvrage prône le suivi par drones, l’usage des nouvelles technologies et des nouveaux systèmes d’informations géographiques. Bref, l’agro-business doit aider les pays africains à sortir de la pauvreté, et la FAO veut jouer un rôle intermédiaire entre États et investisseurs privés. Je ne vois ici aucune référence particulière à l’agroécologie, ou aux vertus d’une transition écologique. De nombreuses directions du développement contemporain de la Chine semblent décidément contraires à la notion de civilisation écologique.
Que penser de la place de l’écologie dans la politique de puissance de la Chine aujourd’hui ?
En matière de lutte contre le changement climatique, la Chine communique sur le potentiel de la technologie et de l’innovation pour résoudre la crise climatique. Il s’agit bien sûr d’un discours politique et la quête de compétitivité industrielle et technologique sous-jacente semble évidente. Je reste réservée quant à la faisabilité des engagements de neutralité carbone de la Chine pour 2060 : quand on constate que 60 % de son électricité provient du charbon, et que les sources dé-carbonées de production ne représentent que 13 % de la production électrique, on ne peut que se dire que cela ne va pas assez vite.
À l’étranger, en Indonésie par exemple, la Chine continue d’exporter à la fois des centrales de charbon et des énergies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque. Et le projet des Nouvelles Routes de la soie n’a pas été conçu comme un projet de développement écologique, mais comme un projet d’expansion économique et d’échanges commerciaux. Pour l’Europe, il ne s’agit pas de vouloir déclarer une guerre économique à la Chine : il y a un espace pour de l’intérêt mutuel, pour certains investissements. Mais il ne faut pas non plus être naïf : l’Europe a intérêt à développer son unité face à la Chine. Dans une certaine mesure, les États-Unis ont une conception très pragmatique de leurs intérêts économiques, et ne font de cadeaux ni à la Chine ni à l’Europe.
Comment percevez-vous la dynamique entre l’Europe et la Chine autour du climat ?
L’Europe a une relation importante à développer avec l’Afrique, du fait de sa proximité géographique, des liens linguistiques qui existent avec de nombreux pays africains… et elle n’y consacre sans doute pas assez de moyens. La Chine est aujourd’hui beaucoup plus agressive et efficace en la matière. Or, le continent africain joue un rôle crucial dans l’équilibre climatique mondial et donc dans la lutte contre le changement climatique. Les démographes prédisent une population de 2,5 milliards de personnes en 2050.
Rappelons-nous qu’en Chine, les déplacements massifs de population, le modèle productiviste, la capacité à créer de l’emploi pour assurer la stabilité sociale, les gaspillages et les duplications industrielles (1200 usines à charbon !), la conversion du foncier etc., tous ces facteurs de la croissance chinoise qui ont exacerbé les choix énergétiques mais aussi les inégalités sociales, se sont décidés dès les années 1980 et ont été liés aux économies politiques régionales chinoises. Pour le climat, le temps presse sur le continent africain comme ailleurs. L’Afrique est la seule partie du monde dont le développement est principalement encore devant nous, qui dispose potentiellement de beaucoup de richesses naturelles, de soleil, de réserves pétrolières aussi (très inégalement réparties). L’usage des sols y est encore très peu rationalisé : rendement des terres faible, brûlage de la biomasse, sécheresses et déforestation, développement anarchique et polluant des villes et immenses poches de pauvreté. Sans prétendre dire aux Africains ce qu’ils doivent faire, une intensification d’initiatives Europe-Afrique doit intervenir sur les énergies renouvelables et l’accès à l’énergie, pour optimiser l’usage des terres entre les divers impératifs de sécurité alimentaire, de climat et de développement, sur des programmes d’accès à l’éducation, etc. L’invention de voies originales de développement pour l’Afrique, différentes des chemins destructeurs de l’environnement qui furent les nôtres en Occident, est un enjeu stratégique de la stabilisation du climat au cours de la seconde moitié du XIXème siècle dont l’Europe doit s’emparer.
Autre point noir : l’Accord signé le 30 décembre dernier entre l’UE et la Chine qui anticipe un vaste traité commercial et d’investissements. Cet Accord semble devoir fragiliser inévitablement l’édifice européen –l’Allemagne en est la principale gagnante en Europe – car la Chine a toujours agi en jouant les rivalités et les concurrences économiques entre pays. De plus, elle ne fournit aucune garantie véritable de loyauté et de transparence dans ses engagements vis-à-vis des investisseurs sur son sol, sans parler de ses comportements autoritaires vis-à-vis des mouvements populaires d’émancipation (les Ouïgours, Hong Kong, Taïwan…). Cet Accord manifeste surtout le manque de vision géostratégique de l’UE qui avait la possibilité de se positionner comme la 3ème force stratégique, entre les États-Unis et la Chine, garante tant des libertés démocratiques que de la cause climatique 8 .
Il faut aujourd’hui que l’Europe « déniaise » l’idée de civilisation écologique. Il ne faut pas se leurrer : nous ne parviendrons pas à vivre de la même façon, en consommant autant et en imaginant pouvoir tout substituer à tout : les renouvelables au charbon, l’ammoniaque au carbone, l’hydrogène au pétrole… Je ne crois pas que cela soit crédible ; il faut faire mûrir un autre projet, intellectuellement, culturellement, et le faire émerger dans la société. Pour ce faire, il est nécessaire de connecter les questions techniques et les projets culturels. Le modèle de la Chine n’est pas et ne peut pas être le modèle de l’Europe.
Je suis personnellement déchirée par le constat qu’en Europe, nous (intellectuels, ONG, mouvements sociaux) avons été pour le moment incapables d’élaborer une vision du futur, épaisse, plurielle, aussi éloignée de la collapsologie décroissantiste d’une part, que du tout-technologique de l’autre. Nous n’avons pas encore réussi, me semble-t-il, à faire de la lutte contre le changement climatique un projet de société, culturel, politique, et économiquement crédible, afin de le rendre attractif dans le débat public, et capable d’embarquer la majorité du peuple.
L’émergence ces dernières années de la Chine comme une puissance économique mondiale s’est accompagnée d’un rôle croissant sur la scène climatique mondiale. Cela n’allait pas forcément de soi, la lutte contre le changement climatique n’ayant pas toujours figuré parmi les priorités de Pékin et pouvant même apparaître comme en contradiction avec ses objectifs nationaux.
Notes
- Cet entretien a eu lieu en avril 2021.
- A. Dahan, S. Aykut, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, chap. 2, Presses de Sciences Po, 2015.
- A. Dahan, S. Aykut, op. cit., chap. 3.
- Dans l’ensemble des Pays en Développement, plusieurs sous-groupes très actifs se sont organisés de manière autonome ; citons les Pays les moins avancés (PMA, une cinquantaine dont 34 en Afrique, 9 en Asie, 5 dans le Pacifique, 1 en Caraïbe), les petits états insulaires (AOSIS, une quarantaine) et depuis 2005, une coalition crée à l’initiative de la Papouasie-Nouvelle-Guinée de pays avec des forêts fluviales, qui a pour objectif de faire reconnaître les efforts déployés par les PED pour ralentir les émissions dues au déboisement. Voir A. Dahan, S. Aykut, op. cit., chap. 6.
- A. Dahan, S. Aykut, op. cit., chap. 7.
- E. Morena, « The Price of Climate Action : Philanthropic Foundations in the International Climate Debate », Palgrave Macmillan, 2017.
- A. Dahan, « La gouvernance climatique : entre climatisation du monde et schisme de réalité », L’Homme et la Société, no 199, p 79-90, 2016.
- Voir aussi : AITEC, ATTAC, « Note de décryptage de l’Accord », 2021.
citer l'article
Amy Dahan, L’évolution de la position chinoise dans les COP et sur la scène géopolitique climatique mondiale, Groupe d'études géopolitiques, Sep 2021, 13-18.
à lire dans cette issue
voir toute la revue





